 De la solitude contemporaine dans une grande ville
De la solitude contemporaine dans une grande ville
Sous-titre : métamorphose d’une jeune fille en jeune femme, d’un statut d’objet à celui de sujet.
C’est l’histoire de Paula ( magistralement interprétée par Laetitia Dosch ) trentenaire qui vient d’être larguée par son compagnon Joaquim Deloche ( photographe à la cinquantaine célèbre ) après dix années passées au Mexique et alors qu’ils sont revenus dans la ville – lumière.
Plan d’ouverture : Paula au fond d’un couloir gueule » ouvre-moi » et tambourine de toutes ses forces avec ses poings puis son front qu’elle blesse ( une jolie cicatrice témoigne de ces tragiques instants).
Résultat, une suite de plans aux urgences face à un médecin psy qui pour lui remonter le moral lui balance: » vous êtes une jeune femme libre » phrase qui déclenche un nouvel élan de violente colère ( elle casse une vitre). Mais d’où vient cette violence ? de Paula ou de son ex qui l’a jetée comme un kleenex ? elle explique au médecin que sa vulnérabilité est banale, normale, issue des violences ( familiales, masculines ) qu’elle a subies.
Ensuite nous assistons à la déambulation de Paula ( et du chat persan/chinchilla blanc aux trois milliards de poils qu’elle a volé sciemment à Joaquim) à travers un Paris hivernal, venteux et peu accueillant à ceux qui n’ont ni gîte ni couvert !
Paula, grande rousse élancée, énergique, qui parle vite et de façon heurtée. Paula c’est une silhouette solitaire, vêtue d’un imper brique, son sac à l’épaule et le chat persan dans les bras.
Paula déambule, dort dans de minables chambres d’hôtel et rencontre plein de gens. Mais chaque nouvelle rencontre débouche invariablement sur un plan où Paula se retrouve à la rue avec imper, sac et chat.
Paula n’est pas une victime, elle se bat, elle apprend de ses rencontres, elle se corrige et se construit au gré de ses erreurs. Paula est généreuse, sincère, et pleine d’empathie pour les humains qu’elle croise.
Elle s’interroge sur elle-même et sur les autres, certes de façon peu conventionnelle, cherche-t-on à connaître les états d’âme de sa gynécologue ? à voir ce qui se cache derrière la peau noire du vigile ( ils sont tous noirs les vigiles ) qui se révèle super-diplômé et authentique.
Toutes ces rencontres révèlent la solitude de Paula mais aussi ce qu’elle est ou pas.
Ainsi lorsqu’elle garde Lilas, la petite fille d’une bourgeoise qui vit dans un appartement cossu ( qu’elle aime davantage que le père de l’enfant ) Paula se rend compte sincèrement qu’elle ne répond pas aux attentes normées de la mère ( moins de bonbons et de sorties et plus de travail scolaire ).
Sa sincérité et son attachement aux autres éclate quand elle demande à Lilas pourquoi elle ne l’aime pas ou quand elle joue avec ses cheveux pour cacher son désarroi lorsque Lilas lui dit que sa mère cherche une nouvelle baby-sitter.
Paula veut rompre avec sa solitude, elle s’engouffre dans toutes les brèches qui s’ouvrent, une jeune inconnue croisée dans le métro, la rampe d’escalier chez sa mère ( scène très forte entre la fille et la mère ) elle s’accroche au chat..qui ne la quitte plus.
Mais peu à peu elle apprend à se connaître, à s’estimer elle qui prétendait être » limitée intellectuellement « .
Dans le dernier tiers du film Paula s’affirme, se construit, sans violence.
Quand l’amie rencontrée dans le métro qui l’a hébergée découvre que Paula n’est pas son amie d’enfance, Paula répond à sa colère par des gestes doux, elle passe sa main dans les cheveux de son amie pour découvrir sous la perruque ses cheveux crépus.
Elle devient capable de résister à son ex compagnon, alors qu’elle est enceinte de lui, et d’affronter son passé de façon critique. » Dix ans et tu ne me connais pas » » tu aurais pu m’apprendre quelque chose en dix ans au lieu de me photographier ».
Paula prend la décision d’avorter et de tourner la page avec Joaquim qui lui s’accroche..
Elle devient ce qu’elle est, sans accepter les normes des autres ( normes qui imposent un bon travail, un bon couple, une bonne relation de famille ).
Paula est vivante sous nos yeux et peut maintenant vivre sa vie à elle.
Françoise
 On entre dans cette histoire, par la fenêtre.
On entre dans cette histoire, par la fenêtre.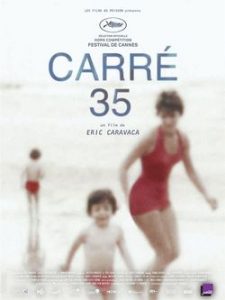 RETOUR SUR CARRE 35, UNE SI BELLE OEUVRE.
RETOUR SUR CARRE 35, UNE SI BELLE OEUVRE. Caméra d’or au Festival de Cannes 2017
Caméra d’or au Festival de Cannes 2017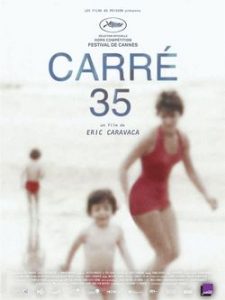 Film français (novembre 2017, 1h07) de Eric Caravaca
Film français (novembre 2017, 1h07) de Eric Caravaca Primé au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2017
Primé au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2017 Primé au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2017
Primé au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2017 A serious man
A serious man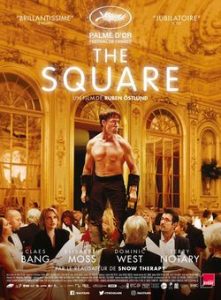 Palme d’or au Festival de Cannes 2017Du 30 novembre au 5 décembre 2017Soirée débat mardi 5 à 20h30
Palme d’or au Festival de Cannes 2017Du 30 novembre au 5 décembre 2017Soirée débat mardi 5 à 20h30 Des frères Coen, comme beaucoup d’entre nous, j’ai vu certains de leurs films plusieurs fois, sur grand écran et à la télé. Mais un festival, un grand écran dans une belle salle, c’est autre chose vraiment. Ajoutons, voir ces fims à la suite, présentés, commentés, éclairés par Thomas Sotinel, critique de cinéma au journal Le Monde, pour le public des cramés de la Bobine à Montargis et pour l’amour du cinéma, c’est inespéré.
Des frères Coen, comme beaucoup d’entre nous, j’ai vu certains de leurs films plusieurs fois, sur grand écran et à la télé. Mais un festival, un grand écran dans une belle salle, c’est autre chose vraiment. Ajoutons, voir ces fims à la suite, présentés, commentés, éclairés par Thomas Sotinel, critique de cinéma au journal Le Monde, pour le public des cramés de la Bobine à Montargis et pour l’amour du cinéma, c’est inespéré.