 Durée 115 mn
Durée 115 mn
.Nationalité : Grande-Bretagne – Etats-Unis
Avec Frances Mac Dormand (Mildred Hayes) , Woody Harrelson (Bill Willoughby) , Sam Rockwell…
Genre Drame
Nationalités : Britannique, Américain
Synopsis : Après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville.
Après avoir fait sensation au BAFTA en ne remportant pas moins de quatre prix, je ne voudrais pas que Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, renommé en français Les panneaux de la vengeance, échappe à un article sur le blog des Cramés de la Bobine, je veux dire un vrai article, un plein article. Un article où lui seul a la vedette. Car il le mérite.
Ce film nous présente les trajets de vie de trois personnages d’Edding, une petite ville du Missouri, essayant tant bien que mal de trouver des réponses et un sens aux éventements traumatiques qui les a touchés. Le scénario se cristallise autour de trois panneaux dont le rouge va faire saigner cette petite route déserte du centre des États-Unis, panneaux dont la violence va trancher avec la tranquillité des paysages brumeux et impassibles, panneaux incriminant la police, et notamment son chef, de ne pas avoir arrêté le bourreau d’ Angela Hayes, violée et assassinée sept mois auparavant.
Dans un film classique, les personnages de la petite ville se demanderaient : « Mais qui a bien pu poser ces panneaux ??? », une enquête serait menée et à la fin du film, on trouverait le coupable. Mais pour son réalisateur, Martin McDonagh, la question n’est pas de savoir qui est coupable, ni pour les panneaux, ni pour le meurtre, mais comment on survit au traumatisme.
Et en effet, pas la peine de se demander qui a commandé cet affichage funèbre, puisque la réponse est évidente, la police, les élèves du lycée, les médias qui viennent l’interroger le savent, seule la mère d’Angela, Mildred Hayes est capable d’un tel passage à l’acte. Et même elle, lorsqu’elle est interrogée ne s’en cache, elle veut faire avancer l’enquête, que le criminel soit enfin trouvé, arrêté et jugé et pour se faire, l’omniprésence médiatique est sa seule arme pour que l’affaire ne sombre pas dans l’oubli.
 Cette femme, dont l’interprétation de Frances McDormand est absolument remarquable – on a eu la chance pendant le week-end de rétrospective des frères Cohen de la voir dans des films déjantés tels que Sang pour Sang et Burn After Reading, elle livre ici une prestation subtile et dramatique – a une révélation en empruntant sa route quotidienne, celle où sa fille a été violée pendant son agonie avant de mourir. Utiliser les vieux panneaux publicitaires abandonnés quand cette route a arrêté d’être fréquentée et mettre en valeur pour y inscrire les messages : « RAPED WHILE DYING », « AND STILL NO ARRESTS » et « HOW COME, CHIEF WILLOUGHBY? » (« VIOLÉE PENDANT SON AGONIE », « TOUJOURS AUCUNE ARRESTATION » et « POURQUOI, CHEF WILLOUGHBY ? ». Elle va donc faire une offre que le publicitaire propriétaire des panneaux ne peut refuser (pour l’argent mais aussi par empathie, cette histoire a vraisemblablement marqué douloureusement toute la ville).
Cette femme, dont l’interprétation de Frances McDormand est absolument remarquable – on a eu la chance pendant le week-end de rétrospective des frères Cohen de la voir dans des films déjantés tels que Sang pour Sang et Burn After Reading, elle livre ici une prestation subtile et dramatique – a une révélation en empruntant sa route quotidienne, celle où sa fille a été violée pendant son agonie avant de mourir. Utiliser les vieux panneaux publicitaires abandonnés quand cette route a arrêté d’être fréquentée et mettre en valeur pour y inscrire les messages : « RAPED WHILE DYING », « AND STILL NO ARRESTS » et « HOW COME, CHIEF WILLOUGHBY? » (« VIOLÉE PENDANT SON AGONIE », « TOUJOURS AUCUNE ARRESTATION » et « POURQUOI, CHEF WILLOUGHBY ? ». Elle va donc faire une offre que le publicitaire propriétaire des panneaux ne peut refuser (pour l’argent mais aussi par empathie, cette histoire a vraisemblablement marqué douloureusement toute la ville).
C’est comme ça qu’elle se lance dans ce qu’on pourrait appeler la BillboardsGate, sans vraiment réaliser la souffrance qu’elle va occasionner, ou pire, en la faisant passé au second plan. Au second plan de sa douleur, de son désir de justice, de son besoin de savoir qu’on n’oublie pas.
Car, certes les policiers incriminés vont en souffrir, la ville va la détester, mais c’est sur les amis de Mildred, le publicitaire, et surtout son fils que ça va retomber.
Son fils, qui fait face à la mort de sa sœur, explique ainsi au révérend qui vient faire la morale à sa mère, que la journée a été difficile au lycée, que les élèves sont choqués du comportement de sa génitrice et lui font payer à lui. Mais là n’est pas le plus important, il souffre lui-même de ces panneaux. Il explique dans une magnifique scène de huis clos forcé par les trajets en voiture sur cette fameuse route, que leur présence, plusieurs fois par jour, le ramène aux conditions horribles dans laquelle sa sœur a été tuée, détails qu’il aurait préféré ne pas connaître. Sa souffrance est immense, mais contrairement à sa mère qui explose de violence, il se replie dans sa coquille et essaye de ne pas faire de vagues qui dévoileraient sa colère. Pour éclairer les rapports entre lui, sa mère et sa sœur une scène de flash-back nous donne à voir ce qui s’est passé juste avant le meurtre. Ce qui aurait pu être une scène de dispute banale avec l’éclairage que nous connaissons de la fin qu’elle va prendre, devient terrible. Difficile pour la mère de ne pas culpabiliser quand elle a laissé partir sa fille à pied en lui disant « J’espère aussi que tu te feras violer. » Cette phrase résonne. Pour le spectateur, pour cette mère, mais aussi pour son fils qui l’a entendu, qui sait, et qui sait aussi que la dernière chose que lui a dite sa petite sœur c’est « Pourquoi n’es-tu jamais de mon côté ? ».
Mais le réalisateur n’en rajoute pas, il laisse juste cette brèche ouverte. La violence de cette famille est autrement plus compliquée. Notamment par le père des enfants, un policier violent, qui a visiblement tâché de se racheter une conduite en s’amourachant d’une gamine et en convainquant sa fille de venir vivre avec lui. Et ces panneaux vont inévitablement le toucher et le ramener dans la vie de Mildred, ce qu’elle avait cru pouvoir éviter…
Pourtant, si des plaintes sont posées et que tous lui en veulent, elle n’est étonnamment pas inquiétée par le chef de la police qu’elle cite pourtant nominativement sur un panneau. Et c’est là, la grande force du film : ne pas tomber dans les clichés, jamais. Les choses sont toujours radicalement différentes de ce qu’on connaît, et de ce qu’on s’imagine, comme dans la vie. Et si c’est souvent une grande force, c’est malheureusement aussi de ce côté que le film pêche un peu. Certains lui ont trouvé des lourdeurs, je préfère penser que le film a un problème de rythme. Que trop de choses sont amenées et que le réalisateur aurait pu arrêter le film avant. Mais en étant tout à fait honnête, oui, on doit pouvoir appeler cette démesure lourdeur… À chaque rebondissement je priais pour que le film s’arrête tellement on avait atteint une justesse qui inévitablement retombera comme un soufflet si on continue à souffler sur les braises de cette tragédie déjà trop développée. Et pourtant, à chaque fois Martin McDonagh arrive à nous faire découvrir une réelle subtilité amenée précisément par cette démesure. C’est fort. Très fort.
Alors même si je n’ai pas été toujours d’accord avec l’ajout d’un événement, finalement, en comprenant la possibilité sous-jacente qu’il implique, je ne peux que m’incliner.
Et pour l’expliquer, il ne me reste qu’à développer les deux autres personnages principaux.
Face à ce personnage de Mildred Hayes, il y a donc la police, et plus particulièrement deux hommes : le chef de la police : Willoughby, respecté de tous et mourant, et le policier américain lambda (non ce n’est pas à souhaiter) : violent, raciste et alcoolisé : Dixon. On a donc le bon policier et le mauvais policier… – Ça aurait pu être un sketch des inconnus, le bon policier, bon il mène son enquête et il boit, alors que le mauvais policier, il fait son enquête et bon, il boit !
Mais non, aucune caricature. Il faut s’enfoncer dans le film pour comprendre les subtilités des rapports entre ces deux-là.
 Le film s’attarde d’abord sur le personnage de Willoughby, le chef de brigade, celui qui est responsable de l’enquête qui n’aboutit pas. Mildred cite son nom sur les affiches sans pourtant sembler avoir vraiment quelque chose à lui reprocher. Alors, il va venir la voir, lui expliquer une fois de plus qu’il n’y a pas d’élément et que dans ces conditions, l’enquête ne peut aboutir. Il est à l’écoute, presque réconfortant. Il finit par lui dire qu’il est mourant, espérant ainsi trouver chez elle l’empathie qui lui fera enlever ces panneaux. Qu’il puisse mourir en paix, sans ombre au tableau, en tout cas publiquement parce qu’il aurait vraiment aimé résoudre cette enquête. Mais alors là, elle lui rit au nez en lui répondant que toute la ville le sait, et que ce n’est pas ça qui va l’arrêter.
Le film s’attarde d’abord sur le personnage de Willoughby, le chef de brigade, celui qui est responsable de l’enquête qui n’aboutit pas. Mildred cite son nom sur les affiches sans pourtant sembler avoir vraiment quelque chose à lui reprocher. Alors, il va venir la voir, lui expliquer une fois de plus qu’il n’y a pas d’élément et que dans ces conditions, l’enquête ne peut aboutir. Il est à l’écoute, presque réconfortant. Il finit par lui dire qu’il est mourant, espérant ainsi trouver chez elle l’empathie qui lui fera enlever ces panneaux. Qu’il puisse mourir en paix, sans ombre au tableau, en tout cas publiquement parce qu’il aurait vraiment aimé résoudre cette enquête. Mais alors là, elle lui rit au nez en lui répondant que toute la ville le sait, et que ce n’est pas ça qui va l’arrêter.
Alors, pour que sa famille ne le voie pas décliner, il décide de mettre fin à ses jours, finir dignement, dans la joie d’une belle journée arrosée et en famille. Et dans un rebondissement génial, il explique dans une lettre à Mildred qu’il a payé pour que les panneaux continuent à afficher son inaptitude à boucler l’affaire. Il dit le faire avec beaucoup d’humour pour que tout le monde la pense coupable de son suicide, mais on sent bien qu’il l’a fait à la fois pour se racheter de son impuissance et parce qu’il a entendu la démarche de Mildred. Cette affaire lui tient à cœur, et plus elle fera parler, plus la police aura une chance de coffrer le meurtrier. Ce sera son dernier geste dans l’affaire, comme un coup de pouce posthume. Et en effet, par deux fois, titillé par la médiatisation, un odieux personnage va se mettre dans la peau du tueur pour titiller son ego et se faire mousser. C’est lui le vrai méchant de l’histoire.
Et non pas cet horrible policier, réputé pour avoir tabassé des noirs parce qu’ils étaient noirs – comme quoi, Détroit, bien que film historique résonne toujours fort dans l’actualité du pays. Mais petit à petit, la personnalité de ce Dixon s’affiche dans ses failles et ses faiblesses. On le pardonnerait presque d’être violent et raciste aux vues de cette mère castratrice, violente (c’est elle qui lui souffle presque toutes ses mauvaises idées) et elle aussi alcoolique. Les chiens ne font pas des chats…
À l’annonce du suicide de son chef, qui on le comprend, est plus qu’un simple patron mais un véritable mentor qui le tient et le maintient à son poste pour ne pas qu’il plonge définitivement, il décide d’agir, de prendre les choses en main, «d’être un bon flic, d’aider les gens.». Et là. À l’écran, chose géniale qui ne se passe que trop rarement, la voix off est totalement opposée à ce qui se passe sur l’écran. Le personnage explique qu’il va être honorable, et on le voit dans un débordement de violence défenestrer le propriétaire des panneaux. Il n’a pas besoin de le chercher bien loin puisque son bureau est en face du sien. Il est fier de son acte, il explique même à sa victime «Tu vois, j’ai des problèmes avec les blancs aussi…». Ensuite, en effet, ça déborde de tous les côtés, il est viré, quelqu’un brûle les fameux panneaux, et Dixon se retrouve dans le commissariat alors que Mildred y met le feu.
Mais, comme je le disais, cette lourdeur n’est pas totalement veine, parce qu’il lit la lettre que son feu mentor lui a écrite pour lui dire qu’il pouvait devenir un bon flic, et qu’il avait besoin qu’enfin quelqu’un lui fasse confiance. Et à partir de là il va se donner totalement pour améliorer les choses. Pour commencer, il sauve le dossier (en effet bien maigre pour un homicide sur une adolescente) des flammes. Ça aurait pu être niaiseux, plein de bon sentiment, mais non, quand Mildred le voit, le visage et le corps brûlé, et découvre qu’il a sauvé le document, on comprend, sans le moindre mot, sans le moindre regard, qu’elle lui pardonne. Le film aurait pu (dû ?) s’arrêter là. Mais non, il se retrouve dans la même chambre que celui qu’il a lui-même défenestré, et il s’excuse. Mais genre sincèrement. Et on a envie de le croire tant on a l’espoir que sa vie a basculé entre ces deux instants. Mais l’autre ne pardonne pas. Pourtant, en bon samaritain, sans le moindre mot, avec un mépris tellement compréhensible, il lui offre un verre de jus d’orange.
J’ai envie de m’arrêter là dessus, sur cette sublime faculté de l’auteur à faire évoluer ses personnages, à les rendre plus humains qu’il ne l’était au début, de nous surprendre aussi en toute subtilité, alors qu’il déployait précédemment la grosse artillerie.
Mais ce serait oublier l’humour… Les touches d’humour dans cet univers tragique sont incroyablement succulentes. La rupture avec le drame est finement mise en œuvre pour nous faire sortir de tout le pathos qui se joue à l’écran. Et immanquablement, on suit. Ça tient surtout à deux personnages, James, Peter Dinklage qu’on adore dans Game of Thrones et qui manie l’autodérision de manière sublime, mais surtout, surtout, par la magie de celle qui joue Pénélope, Samara Weaving, la nouvelle petite amie de l’ex-mari de Mildred (tout est devenu tellement compliqué depuis que le divorce s’est démocratisé…). Cette fille a une capacité à capter l’attention pour déblatérer des absurdités déconcertantes avec une aisance absolument fabuleuse. Même si son petit ami étrangle son ancienne femme, lui-même menacé par son fils avec un couteau, elle arrive avec ses histoires de zoo et de chevaux pour handicapés, et on rit. Espérons la revoir dans d’autres rôles car sa prestation est incroyablement prometteuse.
Bref, Trhee Billboards nous plonge dans un drame d’une puissance dévastatrice et le réalisateur arrive à nous surprendre par sa justesse et son sens de l’humour qui rompent avec une certaine démesure narrative, le tout est brillamment interprété. Martin McDonagh nous offre un regard complexe sur la violence qui entache les États-Unis et sur la manière dont chacun gère personnellement le problème.
 Ours d’Argent de la Meilleure actrice
Ours d’Argent de la Meilleure actrice
 Durée 115 mn
Durée 115 mn Cette femme, dont l’interprétation de Frances McDormand est absolument remarquable – on a eu la chance pendant le week-end de rétrospective des frères Cohen de la voir dans des films déjantés tels que Sang pour Sang et Burn After Reading, elle livre ici une prestation subtile et dramatique – a une révélation en empruntant sa route quotidienne, celle où sa fille a été violée pendant son agonie avant de mourir. Utiliser les vieux panneaux publicitaires abandonnés quand cette route a arrêté d’être fréquentée et mettre en valeur pour y inscrire les messages : « RAPED WHILE DYING », « AND STILL NO ARRESTS » et « HOW COME, CHIEF WILLOUGHBY? » (« VIOLÉE PENDANT SON AGONIE », « TOUJOURS AUCUNE ARRESTATION » et « POURQUOI, CHEF WILLOUGHBY ? ». Elle va donc faire une offre que le publicitaire propriétaire des panneaux ne peut refuser (pour l’argent mais aussi par empathie, cette histoire a vraisemblablement marqué douloureusement toute la ville).
Cette femme, dont l’interprétation de Frances McDormand est absolument remarquable – on a eu la chance pendant le week-end de rétrospective des frères Cohen de la voir dans des films déjantés tels que Sang pour Sang et Burn After Reading, elle livre ici une prestation subtile et dramatique – a une révélation en empruntant sa route quotidienne, celle où sa fille a été violée pendant son agonie avant de mourir. Utiliser les vieux panneaux publicitaires abandonnés quand cette route a arrêté d’être fréquentée et mettre en valeur pour y inscrire les messages : « RAPED WHILE DYING », « AND STILL NO ARRESTS » et « HOW COME, CHIEF WILLOUGHBY? » (« VIOLÉE PENDANT SON AGONIE », « TOUJOURS AUCUNE ARRESTATION » et « POURQUOI, CHEF WILLOUGHBY ? ». Elle va donc faire une offre que le publicitaire propriétaire des panneaux ne peut refuser (pour l’argent mais aussi par empathie, cette histoire a vraisemblablement marqué douloureusement toute la ville). Le film s’attarde d’abord sur le personnage de Willoughby, le chef de brigade, celui qui est responsable de l’enquête qui n’aboutit pas. Mildred cite son nom sur les affiches sans pourtant sembler avoir vraiment quelque chose à lui reprocher. Alors, il va venir la voir, lui expliquer une fois de plus qu’il n’y a pas d’élément et que dans ces conditions, l’enquête ne peut aboutir. Il est à l’écoute, presque réconfortant. Il finit par lui dire qu’il est mourant, espérant ainsi trouver chez elle l’empathie qui lui fera enlever ces panneaux. Qu’il puisse mourir en paix, sans ombre au tableau, en tout cas publiquement parce qu’il aurait vraiment aimé résoudre cette enquête. Mais alors là, elle lui rit au nez en lui répondant que toute la ville le sait, et que ce n’est pas ça qui va l’arrêter.
Le film s’attarde d’abord sur le personnage de Willoughby, le chef de brigade, celui qui est responsable de l’enquête qui n’aboutit pas. Mildred cite son nom sur les affiches sans pourtant sembler avoir vraiment quelque chose à lui reprocher. Alors, il va venir la voir, lui expliquer une fois de plus qu’il n’y a pas d’élément et que dans ces conditions, l’enquête ne peut aboutir. Il est à l’écoute, presque réconfortant. Il finit par lui dire qu’il est mourant, espérant ainsi trouver chez elle l’empathie qui lui fera enlever ces panneaux. Qu’il puisse mourir en paix, sans ombre au tableau, en tout cas publiquement parce qu’il aurait vraiment aimé résoudre cette enquête. Mais alors là, elle lui rit au nez en lui répondant que toute la ville le sait, et que ce n’est pas ça qui va l’arrêter.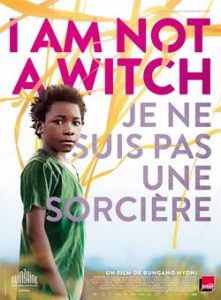 Nominé à la Quinzaine des Réalisateurs
Nominé à la Quinzaine des Réalisateurs réalisation et scénario : Sofia Djama
réalisation et scénario : Sofia Djama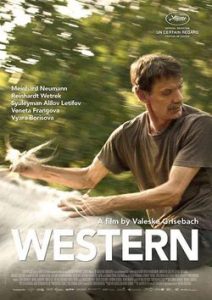 Du 1er au 6 février 2018
Du 1er au 6 février 2018 LA DOULEUR
LA DOULEUR


 Dans le cadre du Festival Télérama
Dans le cadre du Festival Télérama