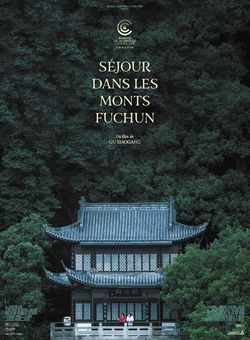4 prix au Festival International des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz 2019, 4 prix au Festival de Waterloo 2019
Film français (novembre 2019, 1h40) de Guillaume de FontenayAvec Niels Schneider, Ella Rumpf, Vincent Rottiers et Clément Métayer
Présenté par Georges Joniaux, le 25.02.2020
Synopsis : Sarajevo, novembre 92, sept mois après le début du siège.Le reporter de guerre Paul Marchand nous plonge dans les entrailles d’un conflit fratricide, sous le regard impassible de la communauté internationale. Entre son objectivité journalistique, le sentiment d’impuissance et un certain sens du devoir face à l’horreur, il devra prendre parti.
31 films sont recensés avec pour toile de fond la guerre en Yougoslavie, et Guillaume de Fontenay en réalise un de plus ! Projeté en 2020, il se déroule sur la période 1992, 1993 ». Chaque film est au service de son présent.
En 1994 on est dans l’évènement, Marcel Ophuls réalise « Veillée d’armes » qui comme son titre l’indique est dedans, on va y aller, et on regarde alors derrière soi, la comparaison avec le nazisme et son cortège est au premier plan.
En 2006, on est juste derrière, avec « Sarajevo mon amour » de Jasmila Zbanic, c’est la traumatologie de guerre qui est traitée, celle directe des adultes et celle indirecte des enfants.
En 2019, avec Guillaume de Fontenay cette guerre agit autant comme un passé refoulé, que comme une actualité potentielle. Une guerre entre des gens qui s’entendaient bien, savaient vivre ensemble sans se sentir menacés dans leur identité, où les traditions religieuses se perdaient un peu, où les mariages inter-religieux étaient courants, serait selon son point de vue, une menace présente tant les nationalismes, les replis identitaires de toutes obédiences inquiètent. Le réalisateur fait donc d’une pierre deux coups, un film souvenir, car Sarajevo n’intéresse plus grand monde, est actuel, d’autant que désormais, les revendications identitaires s’accompagnent de beaucoup de bruits de bottes.
Mais ce film vaut autant pour son HISTOIRE en forme d’avertissement que pour la petite histoire de son personnage, Paul Marchand. La manière dont le réalisateur a vécu cette guerre de Sarajevo l’a été sous le prisme des éditoriaux et témoignages de Paul, reporter free-lance pour les Radio Francophones du Canada et d’Europe.
Guillaume de Fontenay écoutait Paul à la radio, et en 1997, il a lu son livre. Après un temps de dégoût et de rejet, cette lecture a fait son chemin. Il a rencontré Paul. C’était un écorché vif, intelligent et engagé qui écrivait d’une manière fulgurante. Il y a certainement eu chez le réalisateur une sorte de fascination pour cet homme et une amitié aussi d’ailleurs.
Paul Marchand appartient aux journalistes engagés, à ces témoins qui sont parfois acteurs, n’hésitant pas par exemple à transporter des détonateurs. En cela il n’est pas exceptionnel. John Laurence qui fut journaliste pour CBS au Vietnam entre 1965 et 1970 décrit des faits semblables au Vietnam. Ce qui est moins courant, c’est le rapport de Paul au danger. « Dans l’odeur du sang et de la poudre, je m’épanouis enfin. Je suis dans la ligne de mire de la mort, c’est un bonheur exceptionnel » écrit-il. Son exposition courante au danger, son refus de porter un casque ou de se déplacer en véhicule blindé, son rodéo en vieille ford sur la « Sniper alley », ne sont pas seulement des attitudes de bravoure et de provocation, elles sont d’abord un rapport aux mondes, son monde intérieur et le monde tel qu’il est. «Il avait trouvé la paix dans le chaos, la destruction, et le désespoir » estime Jean Hasfeld lui-même reporter à Sarejevo.
Paul Marchand est de ces personnages malades qui justement parce qu’ils sont malades savent mieux que quiconque voir et exprimer avec force et sagacité les réalités dérangeantes. Ce n’est pas tant par sa bravoure de kamikaze qui révèle un rapport au monde assez distordu que par son courage de dire et d’obliger à entendre des vérités dérangeantes, que ce personnage se distingue.
Guillaume de Fontenay fait un film juste du point de vue du personnage, et juste sur la situation, on est immergé dans cette histoire dont il a su rendre la violence la douleur et l’angoisse, la mort et la survie, son cadre, son ambiance.
D’autant que ce film est tourné sur place dans un pays qui n’a pas encore fini de panser ses blessures. Ni de les penser au demeurant ! Et c’est par ce talent à immerger le spectateur, à produire des émotions de toutes sortes que le cinéma est un art. (Quand je pense que c’est un premier film !)
Un point me semble constant qui forme un trait d’union entre les films que j’ai vu sur ce sujet, la dénonciation du nationalisme des Serbes. Oui il fut et continue de l’être. Mais, il faudrait vérifier qu’il n’y a pas un biais de perception de milieu artistique et de l’opinion dans cette manière de décrire la genèse de cette guerre. Elle n’intervient pas seulement par le réveil d’une génération dormante de nationalistes extrême droitistes, elle intervient dans un contexte historique de déstabilisation globale, on peut nommer 1980, la mort de Tito, 1989, l’implosion de l’URSS, 1992, la préparation de Maastrich. Il y a aussi une situation économique désastreuse après la mort de Tito, le pays a une lourde dette de près de 20 milliards, et une inflation insensée. La machine à produire de la pauvreté est une machine très inégalitaire. Et le nationalisme est le refuge et le cache-misère de cette situation. Les solutions « bouc émissaire » sont typiques des situations anomiques. En d’autres termes, j’aimerais qu’on me confirme que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes avant le siège de Sarajevo et que donc les éléments de dissociation et de dislocation n’ont été que le fait de nationalistes serbes, je crois que ce serait difficile. Sur ce plan, Boba Lizdek, (la fixeuse d’alors) dans une interview donnée à la « revue internationale » en 2012 ne dit rien d’autre.
Pour finir, chapeau bas à Niels Schneider qui une fois de plus, et peut-être davantage encore, grâce à ce film et à ce rôle, démontre qu’il est un acteur exceptionnel. Je range ce film parmi les films importants de nos projections aux cramés de la bobine. Un film qui compte.
Georges