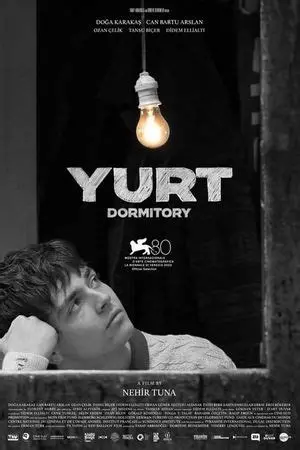Vertiges de l’identité, héritage ou invention de sa vie, réflexion spéculaire sur le cinéma – Marcello mio, le huitième film de Christophe Honoré avec Chiara Mastroianni, qui rend ici hommage à son père Marcello Mastroianni et plus indirectement à sa mère Catherine Deneuve, est une divine suprise de comédie nostalgique et poétique, d’élégante fantaisie montrant, s’il en était besoin, que la légèreté n’est pas l’ennemie de la profondeur.
Evacuons d’emblée les quelques réserves que l’on pourrait émettre à une première vision, ce film gagnant sans doute à être goûté et mûri comme un bon vin, à être aussi commenté et apprécié lors d’un débat comme celui qu’anima Marie-No mardi soir. Quelques longueurs, suggéra Chantal : il est vrai et nombre de critiques le constatent mais cette impression tient sans doute aux flottements de l’identité, au rythme paresseux et inattendu d’une métamorphose (celle de Chiara en son père) et de ses avatars, domestiques (dans sa chambre ou sa salle de bain), urbains (dans la rue, un restaurant, dans la fontaine de la place Saint-Sulpice à Paris qui rappelle la fontaine de Trevi à Rome), voire télévisuels : on se régale de cette satire de la télévision et des émissions de télé-réalité avec cette scène où défilent 7 possibles (ré)incarnations de Marcello Mastroianni, au terme de laquelle Chiara se voit sommée de décliner sa véritable identité, dénoncée comme un reflet imposteur alors qu’elle est l’image la plus fidèle de son père et bientôt poursuivie par la bande des techniciens et des clones de Mastroianni frustrés du spectacle refusé et de l’audimat en berne. Satire de la télévision qui miroite d’images et de spectaculaire, entretient l’immédiateté d’une prétendue révélation, le voyeurisme tonitruant d’une émotion convenue – là où le cinéma cultive la distance, crée l’émotion vraie, tend le miroir palpitant d’une identité incertaine, douloureuse, parfois même éclatée, entre aurthenticité et cabotinage, quête et conquête de soi.
Film dont plusieurs critiques regrettent l’entre soi germanopratin : la critique peut à première vue sembler recevable si l’on considère que le film qui flirte avec La dolce vita de Fellini ou La Nuit américaine de Truffaut ne prétend pas et n’atteint pas à la force esthétique ou dramatique de ses illustres références ou que le cinéaste fait défiler les figures bien connues du cinéma français et du milieu parisien – Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Melvil Poupaud, Nicole Garcia ou Stefania Sandrelli. Pour autant, ces artistes ne se prennent pas au sérieux, jouent leur propre rôle et se prêtent de bonne ou de mauvaise grâce aux transformations de Chiara en son père – émouvante réincarnation pour Deneuve qui se surprendra à embrasser sur la bouche de sa fille le fantôme de son défunt mari, transformisme surprenant pour Benjamin Biolay et choquant pour Melvil Poupaud, métamorphose artistique ouvrant tous les possibles de l’amitié masculine et du rêve inassouvi de jouer avec le grand acteur italien pour Luchini. L’entre soi apparent devient complicité et facétie, jeu de miroirs et troubles de l’identité dans lesquels se perdent et se retrouvent les personnages embarqués dans le délire de Chiara – au prix d’une ridicule mais amusante partie de volley, d’une course-poursuite dans les couloirs d’un hôtel de luxe ou d’une baignade finale lustrale où chacun recouvrera son moi, Chiara nageant dans la mer, quasi nue, enfin elle-même, délivrée de ses fantômes, alors qu’elle s’échinait pour un spot publicitaire à rejouer Anita Ekberg et La dolce vita grimpant sur une fontaine parisienne avec une perruque blonde peroxydée, une robe sans fin et des cuissardes de pêche orange. Jouer, rejouer, n’est-ce pas rechercher un difficile équilibre entre la théâtralité et la spontanéité, le naturel et l’artifice ? C’est peut-être en se jouant des codes, en multipliant les surprises, les saynètes improbables que Christophe Honoré nous amuse et nous touche le plus.

On peut certes se sentir un peu frustré de ne pas voir un biopic de Mastroianni, même si Deneuve confie à sa fille dans leur ancien appartement que son latine lover de mari n’était pas facile à vivre ni des plus fidèles ; on peut regretter de ne pas retrouver les grandes scènes qui hantent nous mémoires, la loufoquerie du Divorce à l’italienne, ou de La grande bouffe, la souffrance impuissante du pudique Bel Antonio ou homosexuelle du sublime Une journée particulière mais, outre les clins d’oeil télévisuels ou cinéphiliques à ces films – le pont des Nuits blanches de Visconti, les lunettes noires, le chapeau de Huit et demi, film de Fellini sur le cinéma et l’identité où Mastroianni joue son propre rôle, le smoking queue-de-pie, souvenir de Ginger et Fred, arboré par Chiara dans l’émission de télé – le film, en déjouant notre attente, nous propose tout autant sinon mieux : une réflexion sur le genre et le sexe mais aussi et surtout sur sur la filiation et la difficulté d’être fille de… Marcello Mastroianni, mort en 1996, et qui aurait eu 100 ans en cette année 2024. Dur d’hésiter entre hétéro, homosexualité, voire transsexualité entre le charme nonchalant d’un Benjamin Biolay, l’ex de Chiara, le coup de foudre pour un soldat anglais dépressif et… homosexuel, qu’elle sauve du suicide du haut d’un pont, et l’amitié masculine et nostalgie cinéphilique de Luchini, homme marié qui se lève en pleine nuit du lit conjugal pour retrouver Chiara ou rêver de patinage artistique. Sans oublier cette nuit en prison où Chiara se retrouve placée par le carabinier pour le moins déconcerté dans la cellule des transsexuels… Cette indistinction des sexes et la confusion des sentiments qui en résulte rappelle Victor Victoria de Blake Edwards et suggère la fragilité de la prétendue virilité : quel plus bel hommage au fond que ce trouble identitaire au latine lover Marcello Mastroianni qui fut aussi l’homme déchiré d’Une journée particulière et impuissant du Bel Antonio.

Chiara Mastroianni joue superbement le trouble de l’identité, la difficulté d’être soi -surtout quand on se réveille un matin en découvrant le visage de son père dans le miroir – avec l’élégance viscontienne d’un Helmut Berger dans Ludwig ou le crépuscule des dieux et la mélancolie clownesque d’un Charlie Chaplin dans Les Feux de la rampe (Limelight). Comment se définir tout en assumant l’héritage comme le suggérait Nietzsche dans Le Crépuscule des idoles : « Tout ce qui est bon est héritage, ce qui n’est pas hérité est imparfait, n’est qu’un commencement » ? Peut-être par ce mélange de gravité et de légèreté qui caractérise le jeu de Chiara, ces jeux de physionomie si mobiles et déconcertants, entre folie et mélancolie, cette indolence qui semble chez elle plus naturelle que jouée – et par quoi sans doute elle ressemble le plus à son père, à son corps défendant.
Bonheur de cinéma, le film nous propose comme par inadvertance une réflexion amusée mais sérieuse sur le septième art, sans didactisme ni prétention, dans l’ espace rêvé et symbolique pour l’acteur de l’ubiquité entre Paris et Rome, loin de l’onirisme de Huit et demi ou des drames de La Nuit américaine. Il interroge aussi les limites souvent floues entre la vérité et la fiction, avec ce baiser volé de Deneuve à Chiara-Marcello, la voix de la Callas dans l’ancien immeuble des Mastroianni ou ce prétendu mariage de Deneuve et Luchini dans la vraie vie, fiction à laquelle je me suis un instant laissé prendre, oubliant l’hilarante comédie de François Ozon, Potiche, où les deux acteurs étaient mari et femme, film d’ouverture en 2010 à Montargis du 1er rendez-vous de l’association des Cinémas du Centre. Belle réflexion aussi sur la nécessité et le courage d’être soi, entre les injonctions de l’actrice – ici réalisatrice – Nicole Garcia suggérant à Chiara de jouer avec plus de rythme, d’être « moins Deneuve que Mastroianni » et la troublante méditation, dans sa loge, de Fabrice Luchini en vieil acteur fatigué et grimé, filmé de trois quarts, conseillant à son amie d’être une actrice banale, se laissant imprégner par son rôle, habiter par son personnage au lieu d’imposer sa personnalité au personnage. Curieux et difficile chemin de crête entre l’admiration et l’incarnation, entre l’identité et l’altérité.
Claude