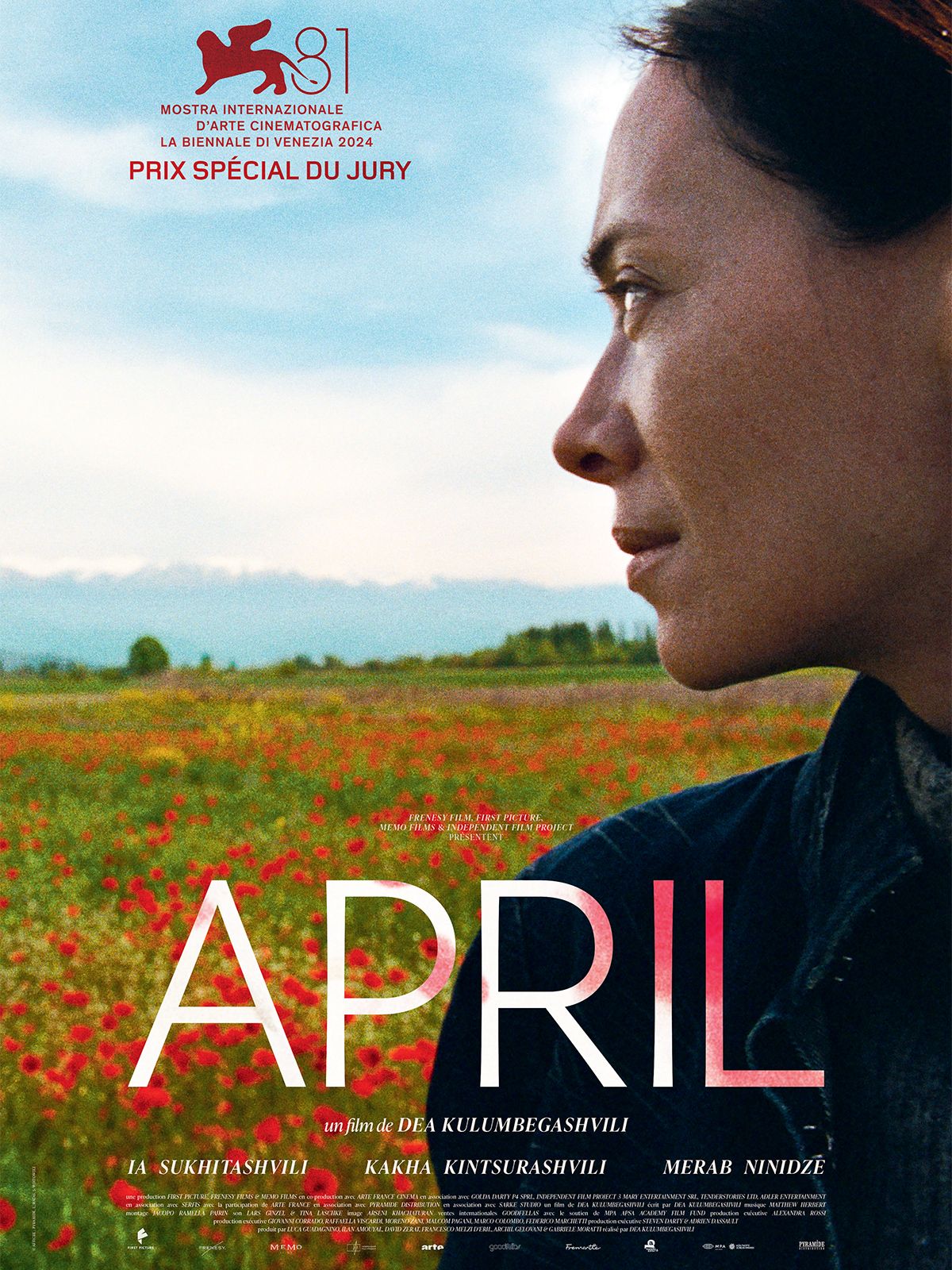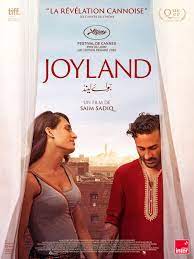Je m’étais promis il y a longtemps de ne jamais dézinguer un film, ne pas prendre de temps pour écrire sur une toile qui ne m’a pas plu. Et puis, cette nuit je fais ce rêve étrange d’un écran qui se déforme, les images ne disent pas grand chose, plutôt des tâches de couleurs aux contours mobiles et psychédéliques. Je suis seul dans une salle de cinéma à l’ancienne « Empire of Light ». Je sais qu’il y a des odeurs indistinctes peut être de cuisine épicée, pourtant ça ne me dérange pas. L’image me captive, je suis sur mon siège et l’idée de me lever pour bouger et sortir de la salle ne me vient pas.
Je me réveille avec l’idée persistante d’un kaléidoscope, celui que mon parrain m’avait offert quand j’avais huit ans, et dont les fractales colorées du tube en carton me faisaient voir des formes, des personnages qui disparaissaient à chaque mouvement donnant lieu à des nouvelles féeries polychromes.
J’ai retrouvé ces mêmes sensations au début des 80’s avec Étienne-Jules Marey et son chronophotographe qu’avait réveillé Cédric Klapisch dans son court-métrage Ce qui me Meut (1989), et peu de temps après dans une installation rétrospective de Eadweard Muybridge au Royaume-Uni. Les origines de l’image en mouvement exerçant la même fascination, la même attirance d’une scène de quelques secondes d’un mouvement qui se répète à l’infini en ne menant nulle part. Ça m’attire et ça aimante ma rétine ; comme si je m’attendais à ce qu’il se passe quelque chose dans la répétition sérielle ; le cheval au galop pourrait-il tomber, cet autre lanceur de poids viendrait-il à se le mettre sur le pied… Allez savoir.
Et puis eurêka ! Mais oui, mais c’est bien sûr ! Mon rêve vient de reconstituer dans ses motifs les Feux Sauvages de Jia Zhang-ke2025) que je n’ai pas aimé (du tout !). Je relis l’article de Marie-Annick, repense à sa présentation en saluant son talent de défendre ce long métrage comme elle le fait.
Un film de bric et de broc, fait de bouts d’essais ou de fin de bobines, tournés sur différents supports à différentes époques sur fond d’histoire d’amour absconse et hermétique —entre Qiaoqiao (Zhao Tao) et Bin (Li Zhubin)— qui se fait et se défait, je te cherche, tu me trouves, je t’aime et je t’oublie, je ne t’aime pas et je te recherche…

C’est long, ça montre le temps qui passe, comme ailleurs. Les vieux quartiers rasés pour y bâtir les parallélépipèdes vitrés tels ceux de toutes les mégalopoles du monde. On noie des villages, comme ça se faisait du temps des Grands Travaux ici jusqu’aux années 70.
« Il faut que tout change pour que rien ne change », nous annonçait Le Guépard de Luchino Visconti (1963). Alors voilà ite missa est !
Pourtant c’est une intervention qui a éveillé mon attention pendant le débat. Ce qui a changé est montré dans le premier et le dernier plan du long métrage, tournés à vingt ans d’intervalle. On voit au début des femmes plaisantant en s’invitant à chanter, se moquant les unes des autres, un gynécée choral daté (pourtant pas si ancien), si ce n’est caricatural. À la toute fin c’est Qiaoqiao, amoureuse transie qui se retrouve de nuit au milieu de la rue à l’approche de coureurs de marathon hommes et femmes tenues couleurs fluo. Sera-t-elle emportée par le flux humain suggéré plus tôt par la force de l’eau du Barrage des Trois-Gorges aux villages inondées. Non, Qiaoqiao se joindra résolument à la foule en mouvement, en levant le poing fermé et en criant un grand NO magistral ! Elle reprenait sa voix qu’on entend très peu dans son parcours à travers les époques et les régions d’une Chine qui continue sa transformation perpétuelle. Pour qui, pour quoi ?
L’intervenante au débat attirait notre attention sur l’aspect majeur d’une femme seule s’autorisant à prendre la parole parmi la foule, contrastant avec le premier plan du film voyait les femmes réunies et deviser ensemble, tenues à l’écart des formes de pouvoir et des des activités décisionnelles des hommes. Et bien voyez-vous, c’est cette simple phrase qui m’a fait aimer Les Feux Sauvages.
J’ai vu de mauvais films, ce qui ne m’a jamais empêché de retourner au cinéma… j’en verrai d’autres. Ce que j’ai aimé en revanche c’est l’intelligence du débat, la richesse des propos qui permettent d’ouvrir ma réflexion au delà de ce que nous venons de voir à l’écran et de ce qu’on peut en dire. Ce n’est pas tant le film que la prise de paroles au débat, face à l’œuvre dans notre position partagée de « regardeurs ».
Chacun voit le film avec ses propres référents, son histoire personnelle , les émotions que cela convoque, des sensations physiques ou psychiques percues pendant la projection.
L’œuvre devient alors le support d’autre chose, un artefact qui convoque les regardeurs à ce qu’ils ont à en dire. C’est la triangulation entre l’artiste / son oœuvre / les regardeurs, ce qu’ils ont retenu de ce que je n’avais pas vu, pas compris ou considéré de moindre importance d’un film “inconfortable” pour moi.
Si c’est ce que recherche l’artiste, alors il a gagné, c’est à partir de son œuvre que nous commençons de penser…. Et ça marche ! C’est ça qui nous anime dans nos débats, alors longue vie à tous les E.J. Marey et Jia Zhang-ke qui fixent le temps qui passe en le déroulant à l’infini. Et surtout merci à tous ceux qui nous aident à en décrypter les messages parfois subliminaux qu’ils délivrent.
J’aime le cinéma ! Et qu’on me laisse retourner à mes rêves, de ceux qui sont revisités de films Bons ET mauvais !
Pierre