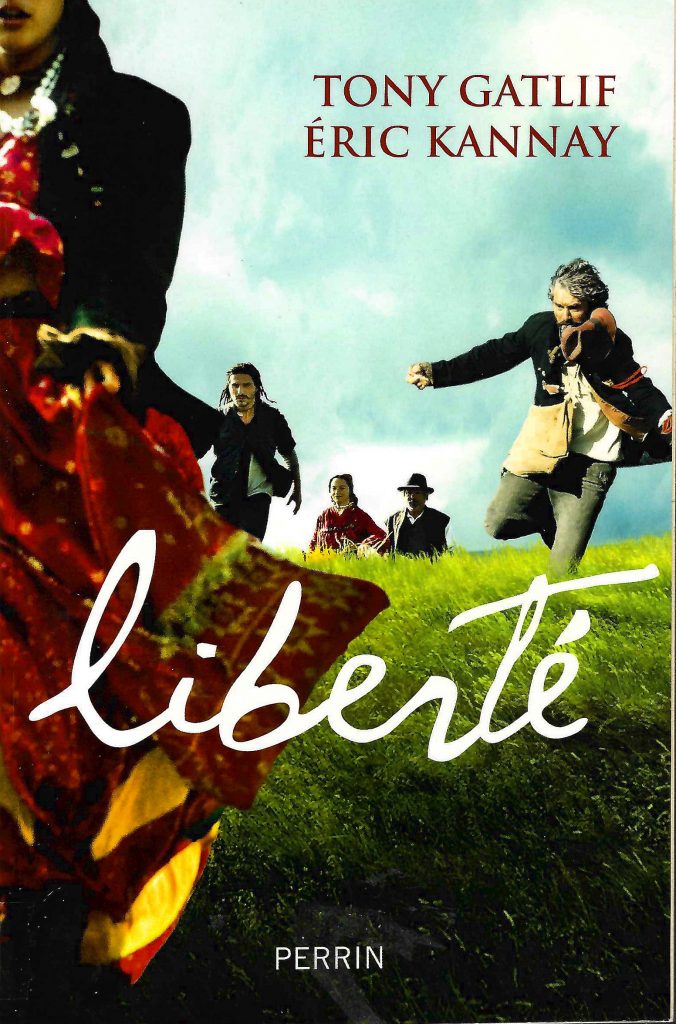COSTA BRAVA LEBANON, LUTTES ECOLOGIQUES, PATRIARCAT, LIBERTÉ

Costa brava Lebanon est un film de Mounia Akl, réalisatrice et scénariste libanaise de 33 ans, sorti le 27 juillet 2022 en salles. Le titre est énigmatique et la réalisatrice quasiment une inconnue du grand public.
C’est en effet son premier long-métrage, tourné pendant trente-six jours en novembre-décembre 2020, dans le cadre de la résidence Ciné Fondation de Cannes. Ciclic, l’agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique du Centre-Val de Loire, dont le siège est à Château-Renard a soutenu l’écriture du scénario.
Nous connaissons la Costa Brava, la côte catalane espagnole. Et c’est une catalane, Clara Roquet, qui est co-scénariste du film. Mais le titre renvoie à la décharge « Costa Brava » au sud de Beyrouth, à l’embouchure du fleuve Ghadir, à proximité immédiate de l’aéroport international, ouverte en avril 2016 et présentée par le gouvernement libanais comme une solution à la crise des déchets provoquée par la fermeture d’une grande déchetterie en 2015. Les manifestations s’étaient multipliées contre la crise sanitaire et aboutirent en 2019-2021 à une révolte contre les inégalités. La pandémie de Covid et l’explosion meurtrière sur le port de Beyrouth le 4 août 2020, qui trouve un écho dans le film avec l’explosion dans la décharge, ont fini de plonger ce pays dans la crise.

Mounia reprend avec ce film le sujet des déchets six ans après son court-métrage Submarine sélectionné à Cannes 2016 qui était déjà une fiction et non un documentaire, un film d’anticipation d’une vingtaine de minutes, tourné en pleine crise des déchets. Vous pouvez le voir ici : https://ciclic.fr/ciel17-submarine-de-mounia-akl-film-court-metrage-en-ligne.C‘est l’histoire d’une jeune femme, Hala. qui ne se résout pas à partir tandis que les ordures ménagères inondent la ville, que les autorités organisent l’évacuation des habitants, et que les risques d’épidémie sont présents partout.
Au sens propre comme au figuré, la réalisatrice met en scène l’idée que nous sommes submergés par nos ordures. Submarine pose la question du départ forcé, de l’exil, mais aussi celui de la marge de liberté de chacun pour s’opposer à la décision des autorités.
PARTIR OU RESTER
« Partons, on ne peut pas fuir toute notre vie » (Soraya). « J’ai évacué l’espoir depuis longtemps » (Walid)
On retrouve dans Costa Brava Lebanon, ces thèmes des déchets et de l’exercice contrarié de la liberté. On pourrait m’objecter que dans Costa Brava Lebanon, la famille a choisi de quitter Beyrouth pour une vie meilleure et plus saine, le début du film nous les présente comme des Robinsons suisses dans une campagne libanaise idyllique, vivant en autarcie heureuse dans une île de verdure, ayant coupé les ponts avec la capitale que l’on voit au loin (de fait le téléphone ne marche pas et il n’y a pas d’internet). Beyrouth était invivable de par la saleté des ordures et la répression de la contestation.
Mais l’obligation de partir est vécue différemment selon les personnages, car si c’est un choix pour le père, Walid, qui dit qu’il serait devenu fou s’il était revenu à Beyrouth et qu’il faudrait un an pour la nettoyer, c’est le seul à en être réellement convaincu et continue à le vouloir même lorsque la décharge les envahit.
Soraya, son épouse, propose plusieurs fois de retourner à Beyrouth et regrette sa vie de chanteuse à succès. Sa carrière a été brisée par leur départ : elle a arrêté de chanter car ils avaient des rêves et des espoirs de changer le monde mais ils ont tout perdu : « Ils nous ont brisés » dit-elle. Mais elle regrette y compris les inconvénients de Beyrouth, elle rechante pour ses filles « Beyrouth mon amour, j’ai autant de bleus que toi » et réentend avec nostalgie le bruit de la ville : les spectacles, la scène, les manifs, la ville…
La grand-mère, Zeina, n’avait certes plus qu’une année à vivre à Beyrouth et respire mieux à la campagne depuis huit ans mais elle fume en cachette pour se sentir vivante. Pour elle aussi Beyrouth c’est la vraie vie.
On comprend peu à peu que le père a imposé son choix à son épouse et à toute sa famille, au point que le thème du patriarcat monte en puissance dans le film jusqu’à la révolte de Soraya, qui finit par exprimer ce qu’elle ressent vraiment, libérer sa propre parole : « les lumières me manquent, les manifestations me manquent, notre ancienne vie me manque ». « Je m’en vais » dit Soraya, et cette fois elle ne quitte pas Beyrouth, au contraire elle y revient, elle quitte Walid car elle n’est pas heureuse. « On n’est pas heureux ici ? » disait Walid, silence en réponse de Soraya.
LA DENONCIATION DU PATRIARCAT
Je pense pour toi (Walid à Soraya). Qui t’a demandé de nous protéger, on étouffe (Soraya à Walid)
Lorsque le choix de fuir une ville polluée devient absurde puisque le site de la décharge est encore plus polluant que Beyrouth (« ils seront bientôt dans notre chambre » dit Soraya), l’acharnement du père à rester devient du pouvoir patriarcal : il interdit pratiquement à Soraya d’aller à Beyrouth pour rencontrer l’avocat, il interdit à sa fille aînée d’avoir un smartphone où elle voit la vie à Beyrouth. Il vocifère des ordres de plus en plus durs au fur et à mesure que la situation se dégrade : « Tu ne sors pas sans masque ». Il devient violent et se défoule en tirant sur les oiseaux charognards qu’il appelle des rats volants, c’est une image très dure. Il commande. Sa mère le traite alors de « fasciste ».
Rim, semble échapper à la violence et au pouvoir patriarcaux, à première vue seulement car elle ne connaît de Beyrouth que la vision de son père à laquelle elle adhère sans avoir les moyens de la discuter. Mais cette vision est faussée de mauvaise foi dans le sens de l’épouvante, pour la mettre de son côté et qu’elle ne veuille pas repartir. Soraya crie à Walid d’arrêter de lui raconter des mensonges, en effet on craint pour la santé mentale de cette enfant dans le film.
La sœur de Walid, Alia, venue pour l’enterrement de la grand-mère, résume bien cela quand sa nièce lui dit : « Papa dit que tu ne sais pas ce que tu veux », et qu’elle répond fort justement « c’est parce que je ne veux pas ce qu’il veut lui ».
Soraya explose (« j’ai perdu le compte de tout ce que tu détestes ») et décide de partir, le quitter et revenir à Beyrouth : dans une belle image, les manifestations venues de Beyrouth arrivent sur la décharge au moment où elle part les rejoindre.
OÙ VIVRE COMMENT VIVRE
La vie est passée tandis que j’attendais (Zeina).

Mounia a participé activement aux manifestations lors de la crise des déchets de 2015 dans le pays. « C’est la première fois que j’ai eu le sentiment d’appartenir à un mouvement, parce qu’il était en quelque sorte sans leader », explique Akl en évoquant les manifestations qui ont secoué le Liban il y a six ans. « J’ai grandi après la guerre civile dans un pays où l’on ne compte que lorsqu’on suit un certain leader ou un parti politique. Ce n’est pas mon cas. Je n’ai jamais senti que j’appartenais à ce monde-là. Lorsque la crise des déchets a éclaté, j’ai eu l’impression que les rues appartenaient à ma génération. Cette crise était aussi une métaphore des dysfonctionnements dans le pays. Il ne s’agissait pas seulement d’une catastrophe environnementale qui a transformé notre ville, mais aussi de corruption politique ».
Mounia Akl semble dire que la vie dans un monde en crise, la ville de Beyrouth, était la vraie vie, cette famille a renoncé non seulement à sa vie antérieure mais à vivre, en prenant le parti de s’éloigner des problèmes au lieu de chercher à les résoudre. La fuite vers une pureté de vie conduit à une autarcie qui n’est pas une vraie vie, à savoir vie sociale dans son temps, dans un contexte bon ou mauvais. Mounia, militante, défend le choix de la lutte politique qui est celui de son personnage, Soraya, être dans le monde pour essayer de le changer et non hors du monde pour se préserver. De plus, Soraya considère qu’ils sont « favorisés » car ils peuvent s’isoler des problèmes, vivre dans une île. Et elle admet que la réalité les a rattrapés et que leur solution a atteint sa limite. Le père ne comprend pas car il répond que cette bicoque (et une vieille voiture), c’est tout ce qu’ils ont et qu’ils n’ont que « le fruit de leurs efforts ». Lui pense que « les manifestations n’ont jamais rien changé », il croit aux actions légales ou à la pression internationale pour venir à bout de cette décharge, Soraya croit encore à la lutte directe ou en tout cas elle veut être avec ceux et celles qui essayent.
FAMILLE ET SOCIÉTÉ
J’ai toujours été obsédée par la famille et par la façon dont, en observant sa structure, on peut comprendre les failles d’une société. (Mounia Akl)
« En grandissant, j’ai toujours pensé que c’était à cause du Liban que mes parents se disputaient. J’étais convaincue qu’il existait une relation entre la pression extérieure qu’ils subissaient et leurs moments de vulnérabilité. Je voulais donc réaliser un film sur cette friction, sur la manière dont les contraintes au Liban font que les personnes qui y vivent n’ont pas le temps d’exister ou de prendre soin d’eux-mêmes. Cela fait ressortir nos propres démons parce que nous sommes toujours en état de crise ».
Il est frappant de voir dans le film que ces parents qui se disputent de plus en plus durement au fur et à mesure que la décharge avance et les divise, n’ont pas appris à leurs enfants à vivre comme êtres sociaux dans leur nouvelle vie depuis 8 ans : Rim 9 ans, qui n’en a pas connu d’autre, vit dans un monde imaginaire et tout inconnu est un extraterrestre qu’elle voit et élimine, croit-elle, en fermant les yeux (sur la réalité !), ou en jetant des pierres si ces étrangers sont identifiés comme tels. Tala 17 ans ne sait pas comment vivre le passage de la puberté. C’est Zeina qui la conseille et lui conseille une sexualité libre. Tala et Rim ne savent pas résoudre leurs interrogations car elles sont hors du monde qu’elles ignorent, qui tente Tala et effraie Rim. Rim, par manque de clés d’appréhension du réel, tombe dans l’irrationnel, elle vit casquée à cause des rats de Beyrouth et passe son temps dans une pensée magique à compter et à répéter que tout ira bien pour exorciser les problèmes de plus en plus angoissants, Tala, par manque de conseils pour conduire sa vie, se jette dans les bras d’un employé servile de la multinationale, l’ennemi de la famille. Ce n’est pas un échec de la lutte de cette famille mais un échec de la solution individualiste que constitue la fuite, ce qui écorne au passage certaines solutions de purisme écologique proposant de vivre en marge du monde au lieu de vouloir le changer collectivement.
Mounia Akl dit de Costa Brava Lebanon : « Le plus important est que certains personnages de ce film sont en accord les uns avec les autres pour dire que la situation doit changer. C’est important, parce que quand on croit qu’on peut changer, cela veut dire qu’il y a peut-être un peu d’espoir ».
LA LIBERTÉ
Je ne pense pas que les cinéastes doivent transmettre des messages dans leurs films, mais plutôt soulever des questions(Mounia Akl)
Avec le thème au premier plan de l’écologie, celui des moyens de lutte qui en découlent, celui du patriarcat qui s’affirme comme étant majeur au cours du film, il y a, de façon continue mais plus en filigrane, le thème de la liberté. Dès la première scène, un dîner plein de rires, est-on libre à table de manger comme l’on veut, dans la petite société de la famille, le père dit que Rim est libre. Mais vers la fin du film quand il dit à sa mère, Zeina, au cours d’une dispute cette fois, : « tu es libre de partir », et que Zeina dit qu’elle partira, on sait que sa seule liberté de partir sera celle de mourir. C’est d’autant plus terrible que c’est le personnage le plus épris de liberté. Et de fait elle accepte de partir dans la scène suivante (suivante ou presque puisqu’il y a uns semblant de réconciliation avec son fils, une scène affectueuse où Walid l’aide à se nourrir mais qui ne résout pas leurs différends).
La sœur de Walid, Aila, a vraiment changé de vie en changeant de pays (la vente ou expropriation de son terrain, cause du problème, n’est plus un problème pour elle), elle n’est pas une militante (elle semble travailler en entreprise en Colombie) et pourtant c’est la seule qui a exercé sa liberté. La grand-mère veut d’ailleurs la rejoindre. Mounia veut-elle dire que soit on reste et on milite soit on part, vraiment ailleurs, dans un contexte réel ? Le pire serait de rester un pied dedans et un pied dehors, en marge de tout (le capitalisme d’un côté et la contestation de l’autre) comme Walid et Soraya, qui ne sont pas vraiment partis puisque tous les matins, Beyrouth est à l’horizon.
Nous avons vu un beau film en effet qui nous interroge et pas seulement sur ce qui s’est passé au Liban, mais sur ce qui se passe partout et arrive à nos portes, tels les déchets de Costa Brava Lebanon. Où aller, que faire, comment lutter contre la démesure du désastre écologique causé par la puissance du capitalisme, ses gouvernements et ses multinationales ?
Monica Jornet