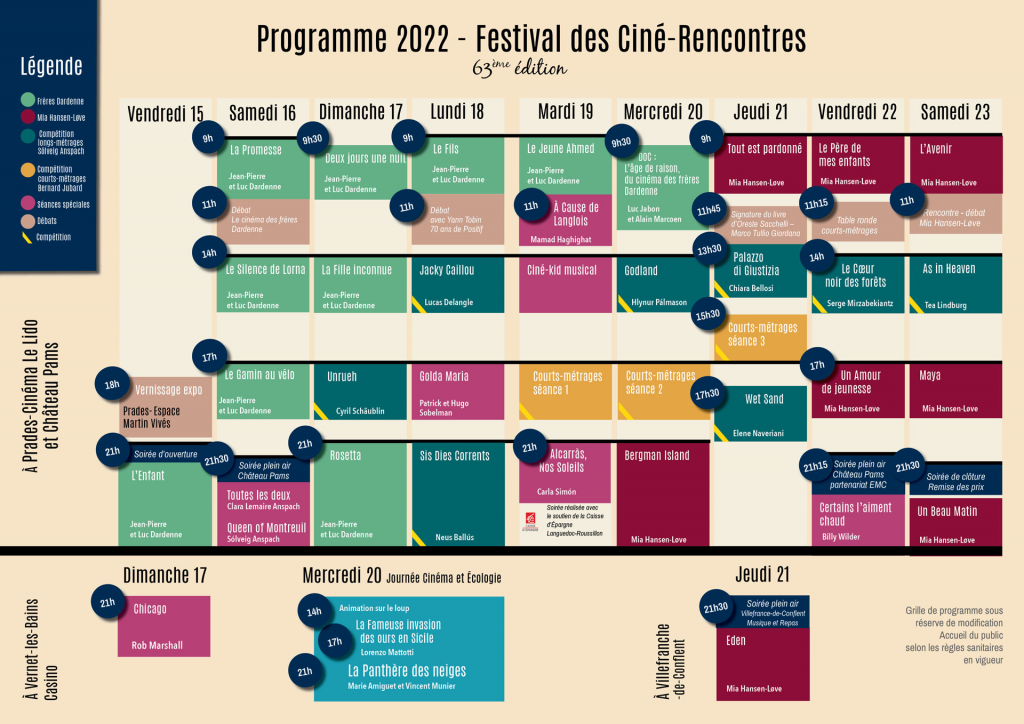Une démarche trottinante comme une course empêchée, un élan têtu contre la souffrance, un bouquet de roses rageusement (et impossiblement) jeté, en s’y piquant, dans une poubelle, un chat noir ronronnant – la vie qui va – au creux d’une femme en larmes, reprise par son passé : ce sont autant d’images fortes, émouvantes de L’Avenir de Mia Hansen-Love, ours d’argent au festival de Berlin 2016.
Isabelle Huppert, tout en retenue fébrile et abandon maîtrisé, y campe Nathalie, professeure de philosophie épanouie dans un lycée parisien, mariée et mère de deux ados, soudain frappée au cœur par trois coups du sort : son mari, sommé par sa fille de clarifier la situation, la quitte après vingt-cinq ans de mariage ; sa mère, aussi capricieuse et tyrannique que malade et dépressive, qui la réveille en pleine nuit, l’appelle en plein cours, meurt dans l’Ephad où on l’a placée ; moins grave certes, écrivant pour des éditions universitaires, elle se voit reprocher un travail trop érudit, pas assez attrayant et finalement remerciée pour n’être pas assez flashy ni synthétique dans son approche philosophique. (Mia Hansen-Love, même si ce n’est pas son propos majeur, offre ici une belle satire du monde de l’édition !)
Ce film tout en finesse, doux-amer et lumineux, sur le deuil (d’une mère, d’un amour, d’un projet éditorial) préfère aux éclats d’une rupture, aux portes qui claquent, aux reproches torturés la douceur de l’amitié, la vie rêvée d’une ferme communautaire dans le Vercors et le bonheur de la transmission enseignante. Il nous offre un chemin de résilience ou plutôt, car le terme est un peu convenu et psychologisant, de reconstruction personnelle, inconsciente, par les mots, les gestes, les choses surtout au fil des jours. Un cheminement fait d’élans et de régressions, de projets de voyage et de colères rentrées, entre mouvement fébrile (continuer pour ne pas sombrer, sans trop savoir où l’on va) et arrêts douloureux sur image. Les larmes, langage du silence et de la solitude, fluctuent au gré des circonstances, de la maîtrise ou de l’abandon avec lesquels on réagira : larmes mêlées de surprise accablée et persifleuse lorsque Nathalie reconnaît à travers une vitre de bus la jeune maîtresse de son mari, pleurs réprimés, bercés et comme sublimés par la musique folk dans la voiture de Fabien, ancien élève et ami philosophe de Nathalie, qui les mène à la ferme du Vercors, sanglots irrépressibles près du chat ronronnant. (A noter le nom délicieux de ce chat noir, de la mère de Nathalie (Edith Scob), Pandora, cherchant sans cesse sa place comme sa nouvelle maîtresse, inquiétant comme le vampire du même nom ou s’enfuyant dans la ferme du Vercors une fois sorti de son panier tel une boîte de Pandore !).
Dans ce très beau film sur la douleur, la dépossession et le dessaisissement de soi pour mieux se retrouver et se réinventer – qu’on subisse d’abord la situation ou qu’on l’ait choisi tel Fabien renonçant à sa vie bourgeoise et parisienne pour faire du fromage dans le Vercors – Isabelle Huppert oscille entre chagrin, humour et amertume. Poussant la maîtrise de soi jusqu’au stoïcisme (elle n’est pas intellectuelle et philosophe pour rien…), elle ne cède jamais, ou que fort rarement, au désespoir ou à l’aigreur. Apprenant que son mari (André Marcon) la quitte, elle ne proteste ni n’éclate, n’exprimant qu’étonnement navré et désillusion accablée, dans un curieux mélange d’incrédulité et d’acceptation, comme pour apprivoiser, déjà, la douleur… »Et moi qui croyais que tu m’aimerais toujours ! » s’écrie-t-elle lorsqu’il lui avoue sa liaison et son désir de la quitter. Ses rares reproches ou bouffées d’amertume concernent des livres (lui aussi est professeur de philosophie), un Levinas emporté, un Schopenhauer (maître en pessimisme) réclamé par lui, tout Kant disparu, lecture pourtant aride et peu consolante. Une telle maîtrise de ses émotions, une telle intellectualisation des situations peuvent paraître peu vraisemblables, relever d’un milieu bourgeois – reproche injuste ou faiblesse du film ? Il n’empêche que cette attitude illustre parfaitement, en toute circonstance de rupture, plus encore que de deuil, le combat entre l’orgueil et l’amour, la pudeur et la souffrance, la dignité à préserver au regard de l’autre comme à ses propres yeux et le besoin de comprendre, de s’expliquer, de s’exprimer. Combat sans fin le silence et la parole, le travail sur soi et l’abandon aux sentiments, l’amère noblesse de l’esprit et le cycle sans fin des émotions, des explications, des reproches. Dans un rare moment d’aigreur, Nathalie venue voir sa fille à la maternité, découvre le bébé bercé par son ex-mari et insiste pour le porter ; quand le nouveau grand-père s’en va enfin, elle a ces mots malheureux et un peu fielleux, comme un retour du passé, un sursaut de rancœur : « ah ! celui-là, je pensais bien qu’il ne partirait pas. » La jeune femme se met alors à pleurer : souffre-t-elle de la maladresse de Nathalie qui vient entacher son bonheur de jeune mère en lui rappelant ce passé qu’une nouvelle génération devrait oublier et dépasser ? Se culpabilise-t-elle en se rappelant qu’elle est à l’origine de la séparation de ses parents puisqu’elle a demandé à son père de prendre enfin une décision courageuse, de quitter sa mère pour sa maîtresse ? Douceur et douleur de la vie, réversibilité entre la mère et la fille : si Nathalie, comme tournée vers l’avenir, chante soudain dans la voiture de Fabien pour enchanter sa souffrance, la jeune mère, tirée vers son passé, pleure au cœur de son bonheur d’enfanter.
Se remettre de la douleur, retrouver le goût de vivre, ne passe pas seulement par un travail sur soi, ou le travail du temps. On pourrait s’attendre à un nouvel amour, l’espérer avec et pour Nathalie, qui n’en est pourtant pas encore là – on ne se remet pas si vite : la force du film est justement de déjouer cette attente facile d’une relation amoureuse entre Nathalie et Fabien, à laquelle Mia Hansen-Love préfère l’admiration familière et la complicité caustique de l’ancien élève pour sa professeure de philosophie.
Non, c’est plutôt le réel qui viendra à notre secours car la nature nous enveloppe autant qu’elle nous environne : « les choses ont leur secret, les choses ont leur légende et les choses murmurent si nous savons entendre » – chantait Barabara dans « Drouot ». A Isabelle Huppert, la nature apporte apaisement et consolation – pelouse des Buttes-Chaumont où elle socratise avec ses élèves, rocher du Grand Bé, déjà, où la famille encore unie était placée pourtant d’emblée sous le signe de la mélancolie romantique face à la tombe de Chateaubriand, champs du Vercors propices aux lectures et terrasse au clair de lune où résonnent encore tard dans la nuit les échos assourdis d’une conversation politique sur l’adéquation entre les idées et les actes, le mode de vie bourgeois de Nathalie et le choix bucolique et libertaire de Fabien.
Oui, les choses nous entourent et nous parlent. Elles nous aident à reprendre pied, même si elles nous rappellent le passé et qu’il faudra bien un jour les abandonner concrètement, à moins que, dans un mouvement dialectique, on ne parvienne, faute de les oublier ou de les faire revivre par le souvenir, à les intégrer à notre nouvelle vie : qui de nous, après une séparation ou un deuil, et ce triste solde de tout compte des objets de l’amour défunt, n’a pas finalement gardé tel tableau, tel bibelot, tel livre d’abord détesté comme un souvenir de l’autre et de la relation avortée pour réapprendre à l’aimer, lui sourire à nouveau un beau matin ? Etrange combat de la possession jalouse et du délaissement salvateur, où l’on emporte un livre ou s’en débarrasse, où la maison familiale de Saint-Malo, appartenant à la famille de l’ex-mari, et où l’on pourrait continuer d’aller en vacances, devient soudain insupportable à Nathalie, qui y récupère toutes ses affaires…
Le livre est sans doute l’objet le plus emblématique de cette relation viscérale aux choses, le plus paradoxal aussi car il pourrait n’être que le véhicule banal, fort remplaçable de la pensée et de la culture d’Isabelle ou de Heinz, son mari. Non qu’il s’agisse de livres prestigieux, ou d’une édition de luxe auxquels on tiendrait particulièrement pour leur valeur marchande : ce sont plus simplement des compagnons de vie, sur lesquels on a travaillé pour ses élèves ou dont le message, les valeurs nous ont portés au fil de notre vie, nourrissant nos interrogations, répondant parfois à nos doutes ou nos angoisses : La Mort de Jankélévitch face à la folie, à la dégradation d’Yvette, la mère de Nathalie, Les Pensées de Pascal qui irriguent le film et dont la lecture devant une classe suscite le questionnement sur le sens de la vie, la misère de l’homme sans Dieu, le pari gagnant de la foi – surtout quand on est athée, que notre vie bascule et qu’il faut lui redonner sens et se réinventer ; mais surtout ce titre oxymorique d’Emmanuel Lévinas, Difficile liberté, écho direct de l’angoissante nouvelle vie de Nathalie.
La culture et le métier, si on le vit avec passion, ici l’enseignement, nous sauvent -nous l’avons tous mesuré dans les circonstances difficiles – ils nous structurent, ils donnent sens et rythme à nos vies – fussent-elles par ailleurs parties en lambeaux. Du sujet de philosophie qui ouvre le film : « peut-on se mettre à la place des autres ? » aux débats animés entre Fabien et Nathalie (et quel plus beau rêve pour un enseignant que de transmettre non seulement son amour des mots et de la pensée, mais jusqu’à son métier même, et son goût de l’écriture !?), la vie de la pensée anime et scande les étapes douloureuses d’une existence, d’une correction de copies sur un bateau empiétant un peu (trop ?) sur la vie familiale, à ce cours buissonnier, abandon bucolique et concentration rêveuse, sur les collines des Buttes-Chaumont, lui-même interrompu par l’appel d’Yvette, cette mère si possessive. Un fil rouge parcourt ces scènes, ces moments d’échange ou de réflexion, de lecture solitaire : la question de la vérité, au cœur du film et d’un cours de Nathalie. La vérité, en amour, en politique, en philosophie même existe-t-elle, ou ne faudrait-il pas s’interroger plutôt sur les critères qui la fondent ? Tout n’est-il pas plutôt affaire de désir, ou d’urgence intérieure, de vérité intime, pour tout dire, de cheminement pour revivre et se réinventer encore une fois pour Nathalie.
La dernière scène, bouleversante, du film, résume tous ces questionnements et réconcilie les éléments épars de ce drame intime, sous la lumière du monde – un monde intériorisé, un appartement avec sa lampe orangée au fond de la pièce, ses étagères en bambou et ses livres au premier plan, une bibliothèque témoin du temps et de la permanence, de ce qui demeure quand tout semble se déliter : le dîner de famille vient de réunir Nathalie et ses enfants, son gendre et sa petite-fille qu’elle berce dans ses bras. Un lent travelling arrière sur le salon ramène aux marges du cadre le fils de Nathalie et, de l’autre côté, l’héroïne elle-même entrevue dans l’entrebâillement de la porte voisine, puis les met hors-champ, comme pour dire la force des choses qui nous enveloppent et nous sauvent, qui, seules, demeurent et nous préservent lors même qu’elles semblent nous évacuer.
Au son du sublime lied de Schubert Auf dem Wasser zu singen, une certitude nous gagne et nous foudroie : ce sont nos enfants, ce sont les choses qui nous sauvent. Grâce à eux, la vie est enfin réconciliée.
Claude