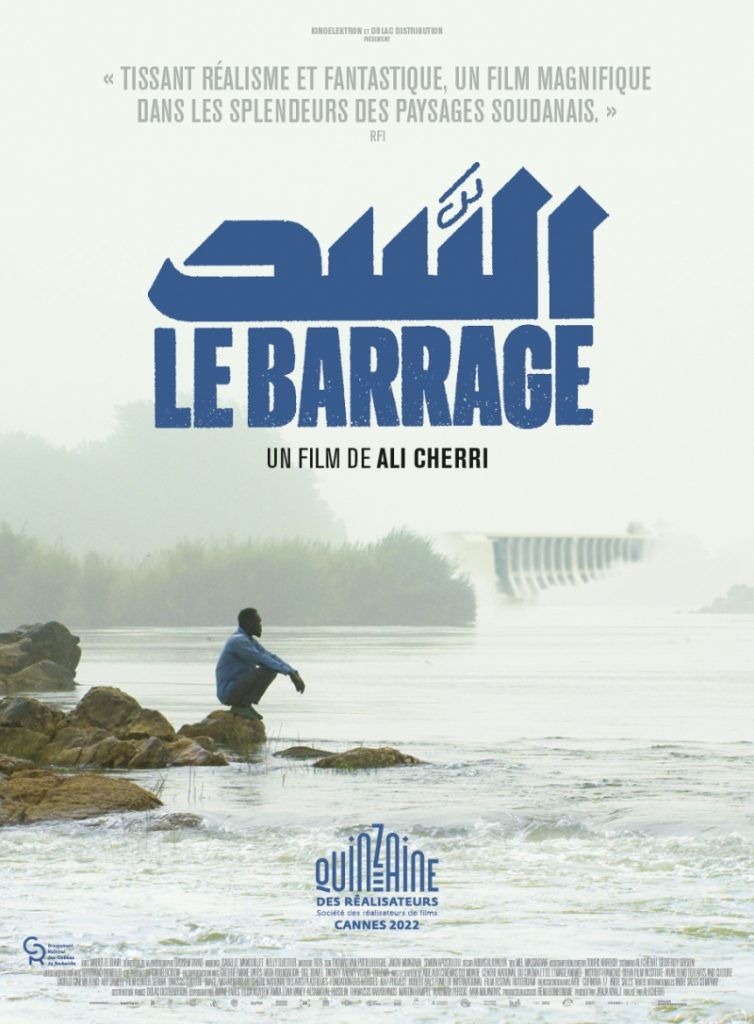Espace, temps, amour et révolution au coeur du Jura suisse
Comment et pourquoi raconter l’Histoire au cinéma ? Ces deux questions traversent « Désordres », deuxième long métrage de Cyril Schäublin, jeune réalisateur suisse de 38 ans, né à Zurich. Artiste/cinéaste/polyglotte, il en avait 35 quand il s’est lancé dans ce projet, avec pour résultat un objet cinématographique non identifié, qui balance entre récit, évocation et documentaire.
Unrueh, titre original choisi par ce petit-fils et arrière petit-fils d’ouvrières-régleuses, désigne tout à la fois le balancier des horloges et l’agitation, le trouble qui peuvent faire balancer les êtres humains. Le choix francophone, « désordres », semble plus se rattacher aux effets supposés de l’anarchisme…
Nous sommes donc dans le Jura suisse, au mitan des années 1870, après la guerre franco-prussienne qui fonde les nationalismes maléfiques pour les siècles suivants ; après la Commune de Paris du printemps 1871 (proclamée aussi ailleurs en France comme à Montargis), tentative de démocratie directe, sociale et politique ; après les grands procès russes de 1872 et 1873 qui envoient en Sibérie de nombreux jeunes idéalistes russes, femmes et hommes, issus de l’aristocratie pour la plupart, tandis que d’autres s’enfuient vers l’Europe occidentale, principalement en Suisse. Avec la Commune, ils et elles seront nombreux à bouger à nouveau et à rallier Paris avant de repartir vers la Suisse après l’écrasement des Communards par les Versaillais.
Au delà des costumes, des décors, de la référence à Piotr Alexeïevitch Kropotkine, prince, révolutionnaire, anarchiste, qui voulait « aller vers le peuple », Cyril Schäublin emprunte à deux autres révolutions, technologiques, pour nous ramener à l’espace/temps de ces années 1870 : la photographie et le télégraphe. En dehors d’un seul mouvement de caméra, à la toute fin du film, le recours aux plans fixes et aux cadrages emprunte beaucoup aux photographes de l’époque en général et à ceux de la Commune de Paris en particulier.
Il suffit de se plonger dans les scènes immortalisées par Bruno Braquehais lors du printemps 1871 à Paris : considéré comme l’un des premiers documentaristes par l’image, il immortalisait les fédérés installés en bas du cadre, souvent à mi-jambe, tandis qu’au dessus d’eux le ciel, les immeubles, les avenues ouvraient des perspectives, vers d’autres personnes, d’autres scènes. Et il n’est pas indifférent que l’un des portraits les plus saisissants de Kropotkine fut réalisé par Nadar, autre photographe de la Commune.

L’histoire se raconte aussi par le son. La bande sonore de Unrueh-Désordres conjugue en permanence les bruits du télégraphe, autre révolution technologique de la deuxième moitié du 19ème siècle, ceux des balanciers des horloges, du cliquetis des outils maniés dans le silence des ateliers, aux langues parlées, le français, le russe, l’allemand et l’anglais – parfois une phrase s’engage dans l’une pour traverser et s’achever dans d’autres.
Ces espaces lieux et temps ainsi définis renvoient à l’évidence à la seule référence cinématographique dont Schäublin se revendique : « La Commune (Paris, 1871) » de Peter Watkins, autre objet cinématographique non identifié, d’une durée de six heures, tourné dans un immense entrepôt de la banlieue Nord-Est de Paris, avec des interprètes tous amateurs, parti pris également choisi par le cinéaste suisse. « Ce que je voulais raconter, c’est comment on construit le passé pour définir le présent. Je crois que c’est une grande question de notre époque : quelle information choisit-on pour définir notre présent. » Les mots de Schäublin entrent en résonance avec ceux de Peter Watkins voilà plus de 20 ans : « Nous sommes dans notre histoire aujourd’hui, même si un nombre croissant de gens, particulièrement les jeunes malheureusement, sont en train de perdre leur histoire ou ne la découvrent jamais. Nous appartenons tous à l’histoire ; c’est un processus en mouvement perpétuel. », écrivait le cinéaste britannique en 2001
Schäublin revendique aussi une réalisation économe, avec des petits budgets, des films « zéro carbone » en quelque sorte, en écho à ses préoccupations de cinéaste « engagé » : « Le temps est l’un des ingrédients essentiels du capitalisme industriel. C’est assez bizarre parce que le temps est une mesure des événements totalement imaginaire et pourtant il influence nos vies et nos corps depuis les débuts de cette industrie horlogère. On suit cet imaginaire alors que l’on pourrait organiser nos vies d’une manière tout à fait différente. Ce que cela signifie d’être soumis à la loi des cadences, comme l’avait été ma grand-mère ouvrière. Puis j’ai pensé que cela me permettrait de raconter comment le capitalisme s’est installé chez nous, à travers la mesure du temps et de l’argent. »
Le calme cinématographique choisi, sans mouvements intempestifs de caméra, sans bruits stridents, rend encore plus criante la violence sociale exercée par les patrons et les contre-maîtres sur les ouvrières et les ouvriers, virés d’un instant à l’autre s’ils ne respectent pas le rythme.
L’oeuvre de Schäublin est politique jusque dans sa vision amoureuse, qui s’incarne dans la dernière séquence du film, celle où Joséphine déclare sa flamme à Piotr et l’invite au plaisir. Un renvoi direct aux deux philosophes russes des années 1860-1870, Alexandre Herzen et Nikolaï Tchernychevski, qui pensaient la révolution comme une totalité : politique, sociale, économique, mais aussi amoureuse et sexuelle.
Sylvie

Pour aller plus loin sur Unrueh/Désordres, un entretien de la RTS :
Et pour en savoir plus sur l’approche du cinéma de Peter Watkins : http://derives.tv/peter-watkins-sur-la-monoforme/