 Nominé au Festival d’Angoulême et de CannesDu 28 septembre au 3 octobre 2017Soirée débat mardi 3 à 20h30
Nominé au Festival d’Angoulême et de CannesDu 28 septembre au 3 octobre 2017Soirée débat mardi 3 à 20h30Film français (août 2017, 1h30) de Hubert Charuel avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners et Isabelle Candelier
Distributeur :
Pyramide Distribution
Présenté par Laurence Guyon
Synopsis : Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver
« Petit paysan » était un film attendu, on a refusé du monde dans la salle. Un film que des paysans éleveurs, sont venus voir, et l’émotion de l’un d’eux, lors du débat, bouleversante pour nous aussi, indiquait à quel point ce film était une sorte de nécessité. Dans cette salle comble, des paysans donc, mais pas qu’eux, car cette histoire nous concerne tous, d’autant que son sujet est d’actualité.
Pour un premier film, c’est un coup de maître, s’il y a un public nombreux pour les films qui nous parle des éleveurs, on se rappelle de « Béliers » en début 2016, « petit paysan » est d’une autre nature parce qu’il choisit de montrer la relation de l’éleveur à ses vaches. Une relation dans un jeu complexe, qui concerne un éleveur, ses bêtes, l’institution sanitaire, et la circonstance d’une épidémie.
Au préalable, il faut remarquer ce que le film élude dans son scénario, c’est-à-dire les causes de la maladie des vaches. En d’autres termes, le film reprend un scénario réel et dramatique de la crise de la vache folle en modifiant les symptômes. « La vache folle », est un terme qui évite d’en penser l’horreur, un maquillage. De même que dans le « café gourmand » de nos restaurants préférés, ce n’est pas le café qui est gourmand, mais le client, ici ce n’est pas la vache qui est folle ce sont les pratiques industrielles donc l’homme (du moins certains). Ajoutons qu’on observe que les grandes épizooties, si elles ne prennent pas toujours leur source dans la production industrielle animale sont fortement amplifiées par elle. Ajoutons qu’il faut bien distinguer la production industrielle de l’élevage, nous dirons en quoi.
Ce que montre « petit paysan », remarquablement interprété par Swann Arlaud, Sara Girodeau et l’ensemble du casting, c’est à la fois l’histoire d’un malheur et de son engrenage sous une forme thriller, et en même temps une histoire d’une souffrance affective. H.Charuel filme l’attachement de l’éleveur (Pierre) à ses vaches, les rapports qui les unissent, (les vaches portent un nom, il leur parle, les caresse, leur manifeste de l’attention, de la tendresse et de la reconnaissance, il leur donne tout son temps, elles ne sont pas le numéro qu’on leur place sur l’oreille, le numéro c’est utile pour le boucher). Cet attachement est connu dans la réalité, il est parfaitement décrit par Jocelyne Porcher*, une agronome qui fut d’abord éleveuse. Cet attachement n’est donc pas seulement celui du paysan à son gagne-pain, il est le sens même de sa vie.
Tout d’abord Pierre a un pressentiment, une intuition , en observant Griotte,un peu comme une mère avec son enfant. Griotte n’est pas encore malade, mais Pierre sent qu’il se passe quelque chose, il est inquiet. La théorie du care conviendrait bien pour décrire cela. Autrement dit, la manière de prendre soin des bêtes, d’être en empathie avec elles, ressemble à ce que font les bons parents avec leurs enfants et les bons soignants parfois avec les malades, (quand la division des tâches et la charge le favorisent). Jocelyne Porcher dit que c’est la théorie du don (donner-recevoir-rendre) qui rend le mieux compte du rapport entre l’éleveur et les animaux. Elle nous dit que l’éleveur offre à ses bêtes une vie bonne, ou elles peuvent ne pas être aux aguets et tranquillement brouter, gambader, voir le soleil, respirer le bon air, vivre paisiblement ensemble, être soignée, assistée etc. elle ajoute : « La mort des animaux est acceptable par nous si les animaux ont une chance de vivre leur vie et si cette vie a été bonne autant qu’elle peut l’être, et en tout cas meilleure qu’elle l’aurait été en dehors de l’élevage, meilleure qu’elle ne l’aurait été sans nous, plus paisible, plus intéressante, plus riche de sens et de relation. »
En somme, c’est le traumatisme de la rupture violente et obligée de ce contrat tacite entre l’éleveur et ses bêtes dont il est question dans ce film. Il y est aussi question d’amour, on ne peut pas élever des bêtes sans les aimer. Deux scènes le soulignent : Pierre présente un symptôme psychosomatique comme on dit, c’est à dire qu’il a comme ses vaches des lésions sur le dos. Pierre traduit avec ou dans son corps, sa souffrance et celle de ses bêtes. Ensuite, Pierre essaie de soustraire un veau à l’abattage obligatoire vient nous rappeler son lien affectif sincère.
Ce film nous montre aussi autre chose que l’on doit aux paysans. La vache que regarde Pierre dans un champ à la fin du film est dans un paysage. Ce paysage nous l’aimons, que deviendrait-il sans eux et leurs troupeaux ? Chiche ?
Certains s’y essaient. Aujourd’hui une ferme-usine de 1000 vaches ici, demain 4000 là-bas. Des lieux clos où l’animal nait, vit jusqu’à l’abattage. Il faut être bien indigne, faire des efforts de déni monstrueux pour réduire l’animal à ce qu’il produit, du lait, de la viande, du cuir. Il faut mépriser toutes les recherches actuelles sur l’intelligence et la sensibilité animale. Il faut aussi considérer que le travail humain est réductible à une série de tâches, qu’il n’y a pas dans ces conditions de souffrance au travail et donc de maltraitance animale ou pire encore mépriser ces inconvénients. Bref, pour envisager cet « avenir radieux », il faut être un prédateur.
« Petit paysan » vient donc aussi nous rappeler que ce qui fait la vie, ce que nous aimons, demain peut-être détruit par la religion du profit… Et si les petits paysans sont les premiers dépossédés de leur culture, de leur travail, de l’environnement qu’ils ont façonné, du sens de leur vie, nous le serons aussi.
*Jocelyne Porcher Vivre avec les animaux La découverte 2014
 Film français (septembre 2017, 1h37) de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani et Aurore Clément
Film français (septembre 2017, 1h37) de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani et Aurore Clément  Il sait de quoi il parle, lui qui à l’âge de douze ans a quitté son pays natal, l’Algérie pour une terre inconnue, la France et ses grandes villes. Il dit se souvenir des milliers de » pieds noirs » débarquant à Marseille avec juste une valise, seul héritage de plusieurs générations d’instituteurs, de petits employés, petits fonctionnaires, pour qui l’Algérie était leur patrie.
Il sait de quoi il parle, lui qui à l’âge de douze ans a quitté son pays natal, l’Algérie pour une terre inconnue, la France et ses grandes villes. Il dit se souvenir des milliers de » pieds noirs » débarquant à Marseille avec juste une valise, seul héritage de plusieurs générations d’instituteurs, de petits employés, petits fonctionnaires, pour qui l’Algérie était leur patrie.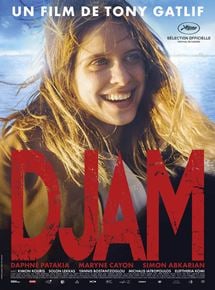
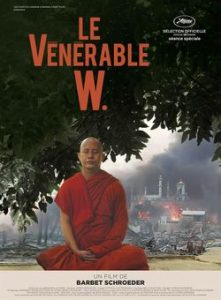 Ce film a été présenté en Séance Spéciale au Festival de Cannes 2017 Semaine du 12 au 17 octobre 2017
Ce film a été présenté en Séance Spéciale au Festival de Cannes 2017 Semaine du 12 au 17 octobre 2017 A 28 ans, on se croit encore immortel.
A 28 ans, on se croit encore immortel.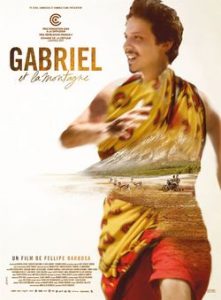
 Norma est un opéra de Bellini (1801-1835), en deux actes sur un livret de Felice Romani d’après le tragédie d’Alexandre Soumet. L’Opéra fut créé le 26 décembre (!) 1831 à la Scala de Milan.
Norma est un opéra de Bellini (1801-1835), en deux actes sur un livret de Felice Romani d’après le tragédie d’Alexandre Soumet. L’Opéra fut créé le 26 décembre (!) 1831 à la Scala de Milan. Nominé au Festival d’Angoulême et de Cannes
Nominé au Festival d’Angoulême et de Cannes