Il y a huit ans disparaissait Claude Chabrol et c’était beaucoup trop tôt.
Le dossier Mona Lina
 Nominé au Festival du film policier de Beaune et au festival de Valenciennes 2018
Nominé au Festival du film policier de Beaune et au festival de Valenciennes 2018
Film israëlien (vo, juillet 2018, 1h33)
de Eran Riklis avec Golshifteh Farahani, Neta Riskin et Yehuda Almagor
Distributeur : Pyramide
Présenté par Sylvie Braibant
Synopsis : Mona, libanaise, est soupçonnée par le Hezbollah d’être une informatrice des services secrets israéliens. Craignant qu’elle soit démasquée, le Mossad l’exfiltre vers l’Allemagne et lui fait changer de visage. Pendant deux semaines, le temps de se remettre de son opération, ils la cachent dans un appartement à Hambourg. Naomi, agent du Mossad, est chargée de lui tenir compagnie et de la protéger. Mais le Hezbollah est à la poursuite de Mona et la planque ne s’avère pas aussi sûre que prévu…
Qu’est-ce-que c’est que cette histoire ?
Un exemple de scénario plein de « trous dans la raquette » !
Par exemple dès le début, même sans être expert en espionnage, on se dit que la surveillance de Mona/Lina, un poisson de cette trempe, ne peut quand même pas être confiée à une seule Claudia/Naomi toute super qualifiée soit-elle ! Attends voir : là, elle part tranquillement faire ses petites courses en laissant Mona, convalescente, s’occuper de la fuite d’eau et descendant « en l’état » c’est à dire avec ses bandages et son déshabillé en soie rouge sang, chercher le gardien qui quand Claudia revient, a déjà bien avancé la réparation …
On comprend à la fin que Mona a tout orchestré donc cet homme a sûrement un rôle dans « l’opération Naïm » et il faut bien que l’histoire se trame …
Sur les bandages de Mona/Lina, on s’interroge … le nez, OK, rhinoplastie oblige, mais pourquoi le crâne ? On lui a juste coupé les cheveux, non ?
Et ces postures ! ce cou étiré en permanence ! Elle ne tourne jamais la tête mais le buste en entier pour regarder à gauche, à droite. Une cervicale déplacée, peut-être ?
Mais non, c’est pour exacerber le port altier de Mona/Golshifteh Farahani, son regard hypnotique au cas où on n’aurait pas capté la fascination qu’elle opère sur tous ceux qui l’approchent, son côté Mata-Hari. A cela s’ajoutent ses propos exaltés genre « Dieu gagne toujours », tu parles … Et on ne comprend pas pourquoi elle s’inquiète sur sa nouvelle apparence physique après retouches donc en tout et pour tout avec un petit nez à la place de sa « patate » (et les maquilleurs n’ont pas lésiné sur le latex pour le grand gros nez de Lina !)
Les deux femmes s’apprivoisent et l’amitié naît et grandit nourrie dans l’idée de la maternité empêchée et blessée … et aussi avec leurs maquillages, perruques, robes à paillettes qui sortent du placard.
Ben oui, on a beau être espionne, on n’oublie pas les bases de la féminité !
Autre exemple de fil blanc : à la fin, Naïm (croit) rencontre(r) Lina au cimetière pour enfants, et lui qui est toujours entouré de gardes du corps armés jusqu’aux dents, là il vient tout seul, les mains dans les poches avec son couteau, et encore, et il se fait dégommer facile par une Naomi très remontée contre ce traître, vengeant celle qui est devenue son amie « à la vie, à la mort » depuis le huis clos hambourgeois.
Pour moi, la sauce n’a pas pris et Golshifteh Farahani m’a horripilée
mais j’ai beaucoup aimé la quartier, l’air de Hamburg, l’immeuble ancien avec ascenseur à clé d’époque, l’appartement.
Et la scène où la bonne soeur referme la lourde porte sur Naomi/Mossad et Naïm/Hezbollah, les enfermant dehors au milieu de leurs morts innocents, genre débrouillez-vous entre vous …
Et la scène aperçue furtivement à la télé, Romy/Lina dans « La passante du Sans-souci ». Un regard de mère à jamais bouleversant posé sur un enfant qui n’est pas le sien, quelques temps après « Une histoire simple » avec David, un autre enfant. Le sien.
Marie-No
Cinéma d’ailleurs
Ailleurs qu’à l’Alticiné et cinéma d’ ailleurs puisqu’il s’agit de deux films allemands!
 Vu à l’Ermitage de Fontainebleau :
Vu à l’Ermitage de Fontainebleau :
« Une valse dans les allées », un film de Thomas Stuber, avec Franck Rogowski (Christian) que les cramés ont pu voir dans Victoria et Sandra Hüller (Marion), l’actrice principale de Toni Erdmann. Un film qui se passe dans un supermarché discount au milieu de pas grand-chose, parking, banlieues lointaines. C’est une histoire d’apprentissage, celui de Christian et une histoire d’amour pudique et chaste. Une Valse montre la manière dont le travail et son lieu affectent, absorbent, déterminent sa vie. Le supermarché c’est une famille où la parole et rare (mais signifiante) et grande la solidarité, y compris pour les petites transgressions. Un film objectif, délicat et beau, que ne verront peut-être pas les employés de supermarché discount, ni beaucoup d’entre nous au demeurant, et c’est vraiment dommage.

Vu au Méliès de Nemours :
Inespéré, la Révolution Silencieuse de Lars Kraume, un film qui a déjà quelques mois, le synopsis : Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s’apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l’armée soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d’Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les menaces et rester solidaires.Une histoire vraie. Ce n’est pas un acte de résistance tel « la Rose Blanche ». C’est juste le début d’une prise de conscience de jeunes lyceéens allemands et pourtant… Cet excellent film retrace comment la machine stalinienne à broyer les enfants fonctionnait : Intimidation, désinformation, chantage, délation, répressions zélées etc. Le temps était à la peur…Le plus petit acte de résistance exigeait le plus grand courage, à Stalinstadt la bien nommée, comme dans tout le bloc de l’Est. Ce film rappelle aussi qu’en 1956, curieusement, les Hongrois aspiraient à la liberté et à la démocratie…Un film bien mené qui a quasiment fini de passer en salle et qu’il faut guetter sur nos écrans de télé pour ne pas le louper.
Georges
« Le monde est à toi » de Romain Gavras


 C’était sûr que j’allais y aller, alléchée par la distribution, par les 4 nominations à la Quinzaine des Réalisateurs, par le nom du réalisateur et par la bande annonce aussi. Je suis une proie facile …
C’était sûr que j’allais y aller, alléchée par la distribution, par les 4 nominations à la Quinzaine des Réalisateurs, par le nom du réalisateur et par la bande annonce aussi. Je suis une proie facile …
Et qu’un film ait réussi à se faire, à sortir est déjà un exploit.
Bon, quand on s’appelle Gavras, ça aide … Mais seulement au début.
Après on sort les chiffres.
Oui, je suis contente d’avoir vu ce film.
Le sujet de départ, assez fourre-tout, semble aussi, de prime abord, assez bateau.
« François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour se refaire. Mais quand tout son entourage : Lamya son amour de jeunesse, Henri un ancien beau-père à la ramasse tout juste sorti de prison, les deux jeunes Mohamed complotistes et sa mère chef d’un gang de femmes pickpockets, s’en mêle, rien ne va se passer comme prévu ! »
Le film ne se passe pas non plus comme prévu. Il se déroule en rythme, sans temps mort, chaque plan est travaillé, chaque image léchée, un peu « surléchée » peut-être parfois, antécédents de faiseur de clip oblige.
La bonne surprise c’est que chaque personnage existe et que le tableau des lascars de banlieue est plus subtilement brossé qu’attendu. Il y a des jeunes, certains très doux, vrais gentils, d’autres vrais vrais méchants, il y a aussi des vieux, attardés, englués, pitoyables. Un avocat véreux, Philippe Katherine décidément bon acteur, un business man redoutable, François Damiens, heureusement contenu.
Tous sont crédibles. Tous sont vrais.
La distribution est d’enfer !
Isabelle Adjani, la belle, figée pour l’éternité dans sa beauté reconstituée, se moquant ouvertement de sa condition de condamnée à rester jolie, dans le rôle de Dany la déjantée, voleuse classe, du Chanel, du Gucci et leurs cousins sinon rien, menteuse, joueuse, Vincent Cassel « en bouc » visiblement postiche, le gag !, dans le rôle d’Henry, un gugusse qui sort juste de taule, scotché aux fake news étalées sur sa tablette,enchaîné dehors. Cassel, émouvant, formidable, si juste, dans un rôle de beauf sans cervelle, vieillissant.
Et puis il y a François, banlieusard traité à tout va de « sale bicot », grandi et gardé jalousement par sa mère qui lui passe encore la main dans les cheveux et lui tapote la joue comme quand il avait 5 ans, qui le garde jalousement dans son giron pour l’empêcher de sortir de sa condition.
Il la trahira et ce ne sera pourtant pas pour son salut car Lamya l’a pris dans ses filets et elle sait les gestes « cheveux, joue » qui le cloue sur place !
Alors pas de bol, François ? ou bien veut-t-il rester tout contre le sein maternel protecteur ?
Karim Leklou incarne François et ce n’était pas une mince affaire de réussir à faire passer l’émotion dans ce personnage falot, grassouillet.
La scène de la danse du ventre totalement décalée est surprenante !
On a vu Karim Leklou dans « La source des femmes », « Suzanne », « Réparer les vivants ».
Il n’a pas fini de nous étonner et de nous réjouir.

Lamya, interprétée par la « Divine » Oulaya Amamra, sans foi ni loi, voleuse, menteuse, prostituée à l’occasion,selon la demande.
Lamya ne roule que pour elle-même et y met tout son courage.
L’image de fin de François trempant dans sa micro piscine illustre la dimension de son ambition à lui raisonnable petit poisson tranquille …
Mais Lamya ne trempe pas dans la même eau, elle est aux manettes. Attention, danger !
On y parle « complotisme » mais le film met aussi l’accent sur un sujet important encore peu traité dans le cinéma actuel :
L’exploitation des migrants, aujourd’hui.
Sujet d’actualité, pour longtemps.
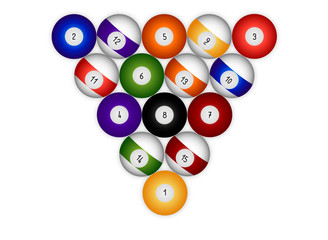
Disperser, regrouper, disperser
Jusqu’à ce que le jeu s’arrête.
Marie-No
https://youtu.be/3mpkGGic3lg
Les Rencontres de Prades, 59ème Festival
 Amis Cramés de la Bobine Bonjour,
Amis Cramés de la Bobine Bonjour,
Danièle et Henri s’y entendent mieux que personne pour convertir des cinéphiles raisonnables en inconditionnels du ciné à haute dose. Nous étions 13 cramés de la bobine (et il faut l’être) pour ce 59e superbe festival de Prades 2018 ! Un cru classé sans doute, en tous les cas, 37 projections en 8 jours !
J’en ai séché quelques-unes, mais très peu. (Dont une journée pour cause d’ascension du Canigou, avec Henri « chef de cordée » !).
Le Canigou sauf notre respect, présente en difficulté de la roupie de sansonnet à côté de cette montagne de projections qui nous attendent chaque année au festival. C’est une expérience exigeante et toujours renouvelée que d’y assister. Une excellente condition est requise. Sinon, comme moi, vous n’échapperez pas à quelques épisodes de somnolence, vous savez ça commence par une sensation de dilution de la conscience, qui conduit de la fiction du film à celle du rêve sans à-coup. Je suis chaque fois stupéfait de voir comment notre cerveau s’arrange avec ça. D’abord, vous fermez « un peu » les yeux, et les sons sont comme amplifiés, vous en êtes contant, ensuite, tout va très vite… Gare aux ronfleurs !
Deux invités pour ce festival Marion Hänsel, pour la première moitié, et Laurent Cantet pour la seconde.
Je devrais certainement ne pas m’en vanter, je ne connaissais pas Marion Hänsel.Une réalisatrice belge, au ton vif et franc. Elle dégage l’impression d’être, comme beaucoup d’artistes, une grande angoissée. Elle a la coquetterie de ne pas revoir ses films… et du coup, ne s’en souvient guère ou d’une manière déformée, et donc elle répond en confondant des plans qui auraient pu exister avec ceux qui existent. Ce qui l’intéresse, ce sont les rencontres qu’elle a faites durant ses tournages dans le monde, car c’est une grande voyageuse, elle se rappelle comment elle s’est entendue ou disputée, et puis il y a sa chère équipe, sa famille en somme. Elle a un contact chaleureux avec le public qui le lui rend bien. Elle a ses inconditionnels.
Si elle est peu explicite sur ses intentions, de film en film on retrouve des figures prégnantes. Pour ce qui me concerne, j’ai un avis plutôt contrasté, je trouve son oeuvre est inégale, mais peut-être que je me trompe. Je vais en signaler deux que j’ai beaucoup aimés.
D’abord, il y a « Si le vent soulève les sables »2006. Une histoire de migration humaine, donc une histoire de misère absolue, de bad trip (sans métaphore) et de mort. Et dans cette histoire celle sublime de Rahne et de la petite Sasha sa fille. Il faut que vous empruntiez le DVD quelque part : à la médiathèque ? Ce serait trop dommage de ne pas éprouver avec les personnages, l’errance, le soleil écrasant, la faim, la soif, la violence et la peur, bref, tout le malheur d’être humain à quelques heures de vol de notre douce France.
Le second, c’est « Between the Devil and the deep blue sea ».1995. Une ambiance. On pense un peu à cette chanson d’Axel Bauer, Cargo de Nuit. Une histoire de marin donc, une histoire d’entre deux ou de transit, comme on veut. Le marin est entre une terre et une autre, entre le port et la terre, entre hier et aujourd’hui. Là encore il y a une belle rencontre entre ce marin et Li, une petite fille chinoise. Ce marin a quelque part une femme qui l’attend, et elle attend aussi un enfant de lui. Le marin, quand il lit les lettres de cette femme, entend sa belle voix. Elle lui dit des choses simples, des choses de la vie. Il a une décision à prendre, c’est complexe un homme.
Je ne vous parlerai pas des autres films que j’ai un peu moins aimés, d’ailleurs Marie-No en parle très bien. Mais je retiens de Marion Hänsel qu’elle est travaillée par la question « des parents insuffisamment bons », des mères et des pères défaillants, par cette question de la rupture, de l’absence et de l’abandon et ses blessures. Et parfois de la violence familiale, Équilibres, son court-métrage de 12 minutes, constitue une excellente introduction à son œuvre. Comme si justement, après l’excès de ce court-métrage, elle avait ainsi trouvé un juste équilibre pour aborder ces questions.
Deuxième partie de la semaine, arrive Laurent Cantet. Accompagné de Michel Ciment. Michel Ciment, c’est une encyclopédie vivante du cinéma. Avec lui, c’est comme si vous étiez un dans un grand restaurant avec un gastronome qui ne reconnaît pas seulement les subtilités d’un plat, mais aussi la recette, les tours de main, et l’histoire…Quelqu’un qui sait de quoi il parle et en parle d’une manière à la fois simple et précise.
Et je me souviens du presque début de la première interview de Michel Ciment :
MC :– vous avez obtenu une palme d’or, ça aide pour faire des films non ?
LC :– La palme d’or ! C’est sans doute un malentendu ! Et ça n’aide pas plus que ça.
Laurent Cantet dont j’avais vu presque tous les films (Cramés obligent !) est humble, particulièrement attentif, et gentil, capable d’écouter et de répondre toujours au bon niveau. Bref, c’est le genre de gars qui nous donne l’impression de poser des questions essentielles, avec qui vous pouvez facilement échanger, c’est plus rare qu’on ne le pense.
Après l’atelier que nous connaissons bien, avec les très beaux rôles pour Marina Foïs et du jeune Matthieu Lucci, puis un gentil film Jeux de plage où l’histoire d’un père intrusif. Et surtout les Sanguinaires, que se passe-t-il lorsqu’un homme décide de passer le jour de l’an 2000 sur une île déserte, loin de la modernité et de ses connexions, avec de vieux amis . Mais les vieux amis ne sont plus exactement ce qu’ils étaient, et ça, c’est intolérable pour quelqu’un qui cultive l’illusion de ne pas changer. Bref, une quête de l’absolu qui tourne mal. Le tragique, c’est l’homme. Suit FoxFire,le gang des filles, lui aussi vu aux Cramés. Puis Retour à Ithaque, heureuse retrouvaille, une sorte de huis clos en plein air ! La petite histoire des personnages correspond à la grande histoire de Cuba, oppression, peurs, frustrations, blessures, et dignité tout de même. A Cuba qu’ils aiment en dépit de tout, qui est leur identité. Aurait-il été possible à Cuba de survivre avec des dirigeants moins paranoïaques ? Les cubains n’ont pas eu le choix, de toutes les manières.
Suit un court-métrage qui rappelle la période Devaquet, « le fameux ministre de l’enseignement supérieur, qui se fit refiler dans les mains, une patate (très) chaude » : Tous à la manif. Tous ? Vraiment ? Il ne faut que quelques images à Laurent Cantet pour faire sourire de cette imposture unanimiste. Suit Ressources humaines, que nous connaissons et qui montre une fois de plus que ce n’est pas avec de bons sentiments qu’on fait de bons films, trop d’invraisemblances, trop de jeu avec nos sentiments. Et pourtant le rôle du père, on le sent crédible. Vers le Sud, un sujet rare, comme souvent, co-scénarisé comme souvent dans les films de Cantet, par Robin Campillo, le tourisme international de consommation est une pratique de riches, souvent une plaie, à propos de consommation, ici il s’agit du tourisme « amoureux » de femmes esseulées, je n’avais jamais vu ça au cinéma. Là encore, si je peux m’autoriser ce conseil, trouvez le DVD, Charlotte Rampling exceptionnelle (c’est un pléonasme). Suit L’emploi du temps, un cadre (consultant) licencié qui continue à vivre comme s’il travaillait, le rôle et l’apparence tiennent lieu de travail. (D’ailleurs, comme c’est un curieux miroir, interprété par des acteurs, des gens pour qui le travail est un rôle).Comme ce film nous rappelle l’affaire Romand, on projette sur le film nos craintes, et comme la musique est inquiétante, on est d’autant plus inquiet. Cet antihéros n’est pas Romand, Cantet s’en défend. Juste un imposteur ? Alors pourquoi cette ambiance annonciatrice de malheur? Juste pour jouer avec nos nerfs ?
Pour finir, Entre les Murs.La palme d’Or et le bouquet, j’étais curieux de le revoir et je vais être beaucoup plus long que pour les autres parce que, je trouve que ce film condense bien des traits de Laurent Cantet, d’abord un cinéma sans acteurs professionnels, ensuite il se tient à la limite du documentaire. En fait une sorte de docufiction. Ici, la vie d’une classe de collège, (peut-être y a-t-il un biais d’échantillon, c’est une collection de cas!). Très rapidement nous sommes conduits à épouser le point de vue du professeur et nous voyons le groupe d’élèves à travers lui. Nous nous identifions, de sorte que nous approuvons ses réponses, les trouvons justes, fines etc… Nous compatissons à ses affres. Un peu comme dans l’emploi du temps, nous sommes illusionnés par nos propres clichés, et les « trucs » du film qui nous y conduisent… Deux constats : a) fini les gentils cancres rêveurs de Prévert, voici le temps des cancres affirmés, solides. b) On a l’impression qu’à l’école tout semble se passer comme si les questions de cours n’étaient plus que prétextes à éduquer sur autre chose. Nous passons de l’enseignement des disciplines (lettres, maths etc.) aux formes modernes et softs de la discipline au sens comportemental.
Michel Ciment parlait de la présence du père dans les films de Laurent Cantet. Les figures du père, dans leurs variétés, traversent en effet tous ses films et celui-ci n’y échappe pas. Qu’ajouter ? Le cinéma de Laurent Cantet résiste bien au temps, c’est un bonheur de voir et revoir ses films.
Quelques mots sur les avant-premières, elles nous promettent de beaux jours aux Cramés de la Bobine :
D’abord, il y a Contes de juillet, un diptyque de Julien Brac, il est bien connu des Cramés de la Bobine, tout le monde et lui en premier s’accordent pour dire que son cinéma est dans la veine d’Eric Rhomer. Ajoutons ce qui lui est propre : sa limpidité, son humour, sa fraîcheur, sa joie de vivre, son ton . Ses contes sont exactement le genre de film dont on sort heureux. L’idéal serait d’avoir la présence de Julien Brac au moment de la projection du film. Il ressemble à ses films.
La stoffa dei Sogni, j’en ai déjà dit deux mots dans le blog, voici un film italien que je vois pour la seconde fois, original, drôle, inventif, et que vous ne verrez pas, pourquoi ? Pas de distribution en France !
Amin de Philippe Faucon, j’avais eu l’avantage de présenter Fatima aux cramés et du même coup de voir tous les films de philippe Faucon. Celui-ci me semble moins fort que Fatima parce qu’il laisse une impression de déjà-vu ; mais c’est peut-être moins vu qu’il n’y paraît. Amin, c’est la vie et le destin d’un migrant qui tout comme Fatima est celle d’un sacrifié…Il y a quelque chose qui demeure quand on a vu ce film, la sensation d’un film délicat et de tragique à la fois, l’histoire d’une multitude d’êtres dans le monde. Précisement, tous ceux sacrifient leur vie, pour une communauté, ailleurs.
Leto de K.Serebrennikov, je n’en dirai rien, sauf que je suis sorti au bout de 10 minutes de la salle. Je n’aimais ni la musique, ni les dialogues, ni les personnages. Plus jamais ça!
…Et je garde pour la fin un bon film, (bien qu’il fût présenté le premier jour) : Woman at war, ce film Islandais de Benedikt Erlington avait avant sa sortie été repéré par Marie-No. Un film qui parle d’écologie, c’est assez rare pour être signalé et …d’activisme ou de terrorisme écologique comme on voudra. On peut le faire bêtement, on peut aussi en faire du bon cinéma, soulever des questions éthiques, montrer des systèmes de communication, activistes d’un côté, politico-médiatiques de l’autre. On peut le faire avec un scénario drôle et sur le mode de l’aventure, à la manière de Robin des Bois, sans juger, en nous laissant le soin de le faire. Si en outre pour le premier rôle on a une actrice formidable, alors ça risque bien d’être un bon film. Cette actrice existe, nous l’avons vue dans le film : Halldora Geirhardsdottir, « facile », retenons bien ce nom !
Merci à l’équipe des Ciné rencontres de Prades, pour son magnifique festival, sa convivialité et tout le bonheur qui va avec.
Georges
Vu du jardin « l’Hostalrich » l’Hôtel de Nanou et de sa mère. C’est exactement notre vue lorsque nous sifflons canon sur les tables du jardin.

Prades, dimanche 21 juillet 2018
Voilà, « Prades » qu’on se réjouit de vivre chaque année, c’est terminé …
S’est terminé en feu d’artifice avec « Leto »de Kirill Serebrennikov en avant-première. Puissant ! « Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s’échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique »
Le film sort en décembre donc pour les Cramés ça sera (peut-être) pour janvier. Alors vivement l’année prochaine et
le 60ème Festival de Prades, juillet 2019 
Marie-No
Prades, samedi 20 juillet 2018
Jeudi, vu les 4 films de la journée :



Et « L’Atelier », premier film diffusé dans le cadre de la rencontre avec Laurent Cantet si bien orchestrée par Michel Ciment, (et qu’on avait proposé aux Cramés lors de sa sortie en octobre 2017), on a commencé en beauté. J’ai revu ce film avec beaucoup d’intérêt et de plaisir.
Marina Foïs est, décidément, une actrice bouleversante et ce film illustre bien un aspect du cinéma de Laurent Cantet. Le désir de groupe, la difficulté, la volupté à s’y fondre, le renvoi à l’individualité.
Vendredi, la journée a commencé par le choix entre, soit « Le Léjà », la Syrie du Sud donc, soit une balade en montagne, dans les Pyrénées donc … Certains ont pu regretter leur choix et pourtant, présenté dans le cadre de la Carte blanche à la Cinémathèque de Toulouse, ce film syrien, objet rare , mérite d’être vu et à 9h c’est l’idéal car il faut être frais et dispos pour se laisser transporter dans ce sombre paysage minéral qu’aucun soleil ne semble pouvoir jamais éclairer, où les femmes doivent accepter d’être enterrées vivantes et les esprits d’être figés dans le temps immuable. Un film assez envoûtant, oppressant.
Aujourd’hui, Laurent Cantet matin, midi et soir.
Dans un banquet, on goûte tour à tour chaque met proposé, se délectant de l’un, davantage encore d’un autre, laissant les saveurs s’épanouir, se méler les épices, se confondre les textures …
Ici, depuis 3 jours, mis à chaque fois en appétit par Laurent Cantet et Michel Ciment, on découvre ou redécouvre chaque film, on le goûte, le savourant, s’en régalant pour la première fois, retrouvant ce plaisir dans une seconde ou troisième fois … Un festin ! Et ça continue demain !





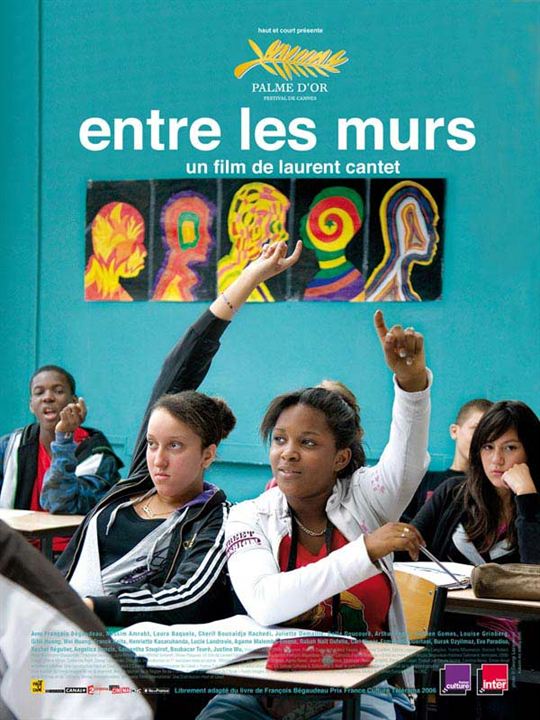


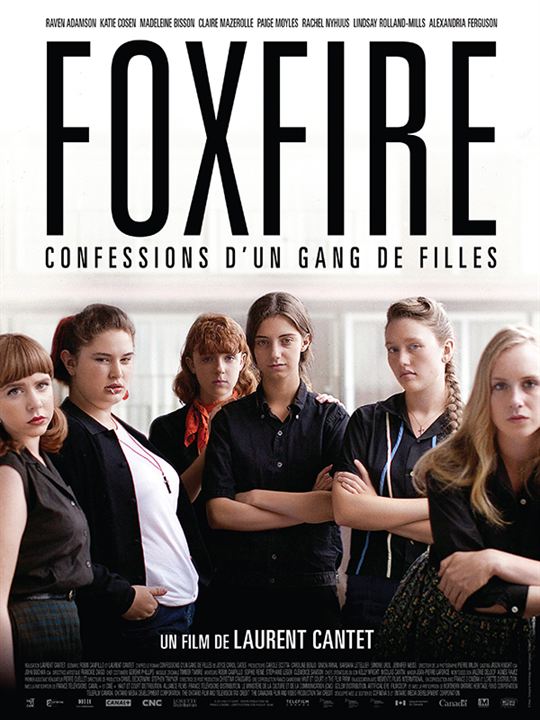




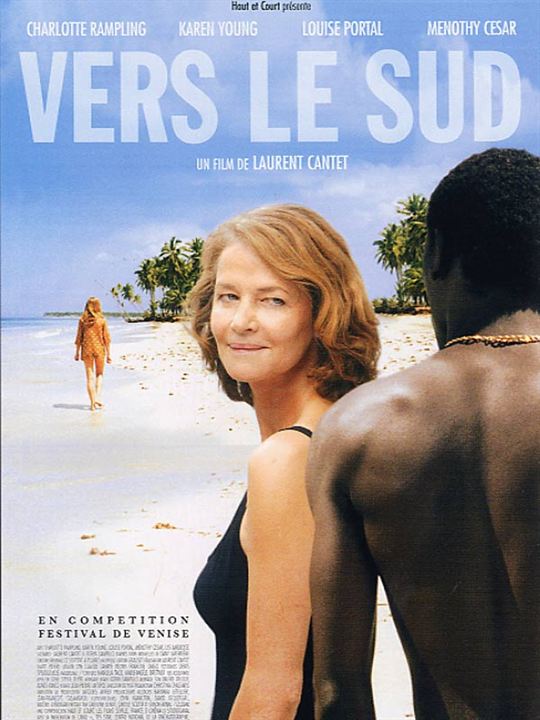





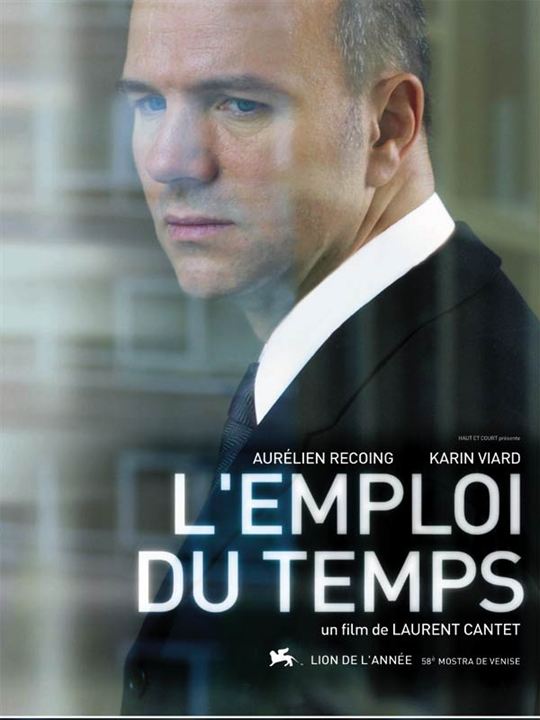
Un patchwork harmonieux cousus de fils d’or.
Marie-No
Prades, mercredi 18 juillet 2018
21h30.Je suis restée à l’Hostalrich, il me faut un petit break de temps en temps et c’est tombé sur le dernier film de Marion Hänsel projeté ici : « En amont du fleuve »(scénario original de M.Hänsel)
Mais, plus tôt dans la journée, vu deux autres de ses films
A 9h, « Between the devil and the deep blue sea », V.O. en anglais, adapté de la nouvelle « Li » de Nilos Kawadias.Le récit d’une rencontre entre Nikos,  radio grec sur un vieux cargo, dans l’expectative de son sort, en rade de Hong Kong et une petite chinoise vivant sur un sampan depuis sa naissance. Grâce à Nikos, avec Nikos, elle mettra les pieds pour la première fois de sa vie sur la terre ferme et sillonnera les rues de Hong Kong dont son grand-père lui a conté la topographie.
radio grec sur un vieux cargo, dans l’expectative de son sort, en rade de Hong Kong et une petite chinoise vivant sur un sampan depuis sa naissance. Grâce à Nikos, avec Nikos, elle mettra les pieds pour la première fois de sa vie sur la terre ferme et sillonnera les rues de Hong Kong dont son grand-père lui a conté la topographie.
Merveilleux film, une atmosphère prenante des acteurs magnifiques. Tout  comme « The Quarry » projeté à 14h, adapté du roman de Damon Galgut avec David Lynch dans le rôle principal. Elle a vraiment une patte à elle Marion Hänsel.
comme « The Quarry » projeté à 14h, adapté du roman de Damon Galgut avec David Lynch dans le rôle principal. Elle a vraiment une patte à elle Marion Hänsel.
C’est une artiste talentueuse.
Et à 17h00 Guillaume Brac s’est présenté devant nous et alors là, attention les yeux : un charme dingue, la bienveillance incarnée, la classe totale ! Il fait penser à JM.C. 
Et son film ensuite « Contes de Juillet » est un enchantement, délicat et déroutant. Programmé par les Cramés en Septembre, ça va être régalant de le revoir ! De le revoir.
Demain, on va regarder les Pyrénées de plus près, aller en Italie, au Sénégal, à la Ciotât.
Et c’est le jour où Laurent Cantet et Michel Ciment arrivent !
Beau programme !
Marie-No
Prades, mardi 17 juillet 2018
Ce matin, quelques uns sont partis faire l’ascension du Canigou ! Le temps s’y prêtait bien. Je regrette de ne pouvoir les suivre dans ces aventures.  Dire que le souffle me manquerait à 2785 m est un euphémisme !
Dire que le souffle me manquerait à 2785 m est un euphémisme !
Hier, au ciné, la journée était assez moyenne. Marion Hänsel au scénario pour les 3 films. Donc … Heureusement « La tendresse » est incarnée par Marilyn Canto, ça console un peu. L’autre « tendre », c’est Olivier Gourmet et c’est plus difficile. Il a le vent en poupe, tant mieux mais son talent est, pour moi, un brin surévalué. Faut le diriger ce garçon sinon il fait peine à voir, étonné qu’il est d’être là. Le summum étant dans « L’échange des princesses » n’en revenant pas d’être en collant et culottes bouffantes ! Olivier Gourmet, c’est possible mais à la Dardenne, sinon non.
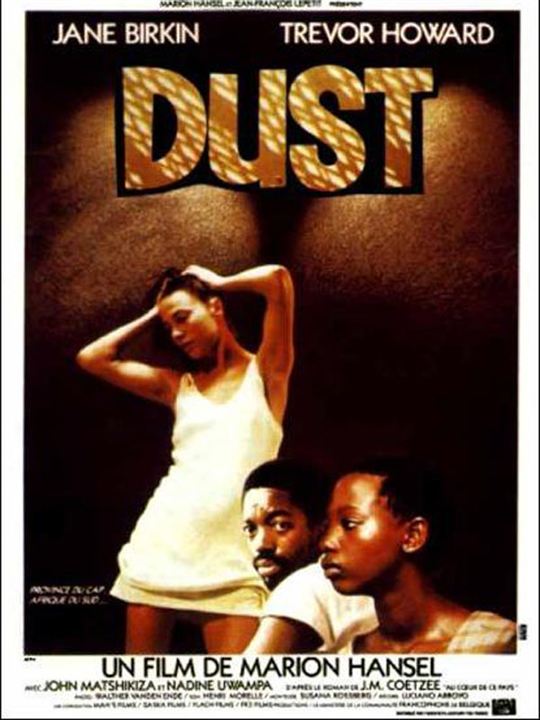 Aujourd’hui, à 9h, on a eu un très bon Hänsel, « Dust », tourné en anglais, d’après le roman « In the heart of the country »de J.M. Coetzee avec Jane Birkin dans le rôle principal, en anglais, parfaite. Une autre personne.
Aujourd’hui, à 9h, on a eu un très bon Hänsel, « Dust », tourné en anglais, d’après le roman « In the heart of the country »de J.M. Coetzee avec Jane Birkin dans le rôle principal, en anglais, parfaite. Une autre personne.
A 17h, « Les noces barbares », d’après le roman éponyme de Y. Queffélec, a été assez apprécié du public. Pour ma part, j’ai un souvenir précis de ce livre qui m’avait beaucoup marquée et j’ai trouvé que le coeur du livre, à savoir le désenchantement et le rejet, était survolé et que le film traitait surtout de l’aigreur, de la rancoeur. Je ne voyais pas ça comme ça.
21h. Une avant-première,« Nos batailles » de Guillaume Senez . Très très bien et qui me réconcilie avec Romain Duris, formidable dans le rôle de ce père débordé. De très beaux moments d’ émotion. Le film sort en octobre.  Hâte de le revoir. A Montargis.
Hâte de le revoir. A Montargis.
Il est déjà minuit et demi ! donc grand temps de dormir un peu, trier, ranger les images d’aujourd’hui et faire de la place pour celles de demain.
Bonjour à tous les Cramés et à bientôt !
Marie-No
Prades, dimanche 15 juillet 2018
Arrivés à Prades en fin de matinée et retrouvé Nanou sur qui le temps n’a pas d’emprise et l’Hostalrich, encore plus beau que l’an passé. Après un déjeuner au « 7ème Art » dehors, bien au frais, le Festival peut démarrer !
17h. Match pour les uns, 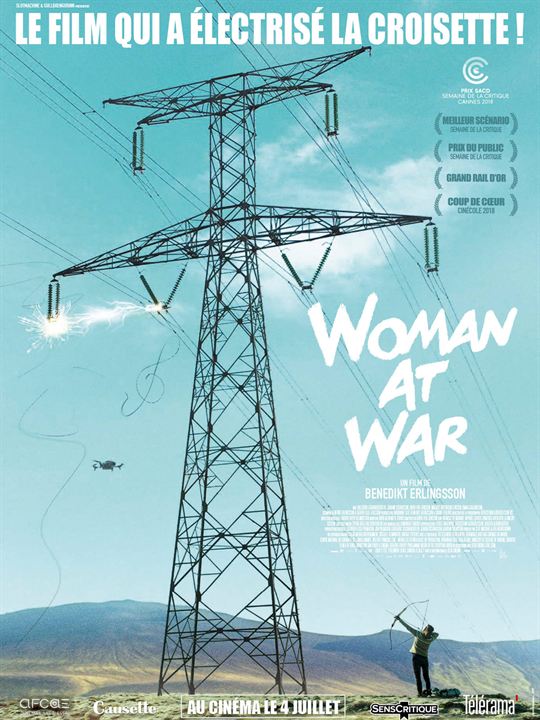 Avant-première de « Woman at war » de Benedikt Erlingsson pour
Avant-première de « Woman at war » de Benedikt Erlingsson pour
les autres dont moi. On espère vous y emmener, en Islande, à la rentrée, vous verrez comme c’est bien !
21h. « Si le vent soulève les sables » de Marion Hänsel. Je ne la connais pas beaucoup (rétrospectivement, on verra que ce premier film projeté dans le cadre de la « Rencontre avec Marion Hänsel » nous a bluffé. On sera, tout au long de ses 10 films proposés, comme dans des montagnes russes : un coup bien en haut avec les adaptations, un coup bien en bas avec les scénarii originaux. Avec « Si le vent soulève les sables », adapté du roman « Chamelle » de Marc Durin-Valois, on est en haut).
Longtemps on repensera à cette belle famille en Afrique qui part vers l’autre bout du 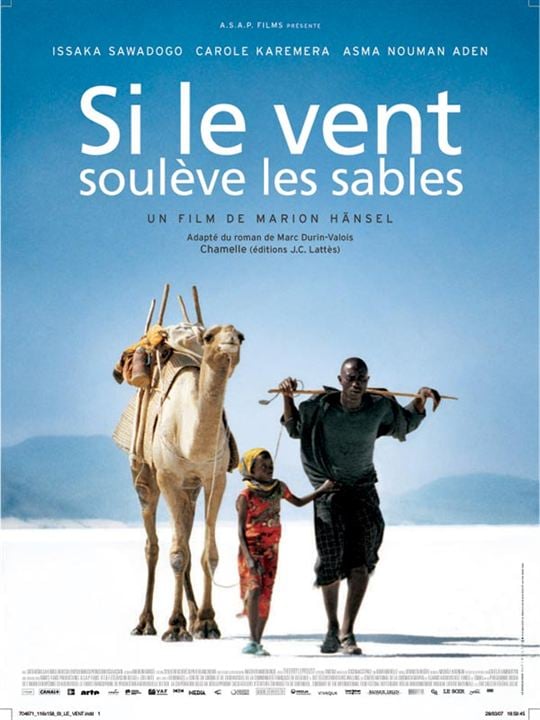 désert à la recherche de l’eau, de la vie. Longtemps on reverra la pétillante petite Shasha qui avait mis sa plus belle robe pour faire le voyage.
désert à la recherche de l’eau, de la vie. Longtemps on reverra la pétillante petite Shasha qui avait mis sa plus belle robe pour faire le voyage.
Un très beau film.
Voilà pour aujourd’hui. Demain la journée commence tôt !
Marie-No