 Grand Prix au Festival du film de Cabourg
Grand Prix au Festival du film de CabourgDu 24 au 29 janvier 2019
Distributeur : Arizona Distribution
Présenté par Mireille Lhormoy avec Émilie Maj spécialiste de la Yakoutie
Synopsis : La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le quotidien traditionnel d’un couple du Grand Nord. Jour après jour, le rythme séculaire qui ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres vacille.
Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un nouveau monde qui leur est inconnu.
un homme et une femme seuls dans l’immensité de l’hiver yakoute. Une leçon de vie.
C’est un très beau film, rare, une pépite dans l’océan de productions cinématographiques ordinaires.
Film tourné en Iakoutie région de la Fédération de Russie située au nord-est, non loin du cercle polaire ( Sakha de leur nom d’origine). Film interprété par des acteurs professionnels Iakoutes, dans ce véritable désert glacé par des températures descendant jusqu’à moins 40 degrés. Mais l’histoire racontée n’est pas celle de véritables Iakoutes qui sont traditionnellement des éleveurs de chevaux ou de rennes, mais celle d’Inuits ( peuples vivant dans les régions polaires du nord ).
Et les images de ce film évoquent tout de suite l’admirable film tourné en 1922 par l’explorateur Robert Flaherty » Nanouk l’Esquimau » qui fictionnait la vie réelle des Inuits canadiens ( un chef – d’oeuvre ).
Aga, se situe dans cette lignée de films d’exception qui révèlent l’Homme face à son destin, face à la nature, face à lui-même.
Tout est silence, blancheur des paysages glacés de l’hiver, une neige profonde et un peu chaotique, s’offre au regard, une ligne d’horizon qui se dérobe entre ciel et terre.
Cet univers silencieux et blanc est dépeint avec de larges plans-séquences, la caméra fixe enregistrant les quelques mouvements de vie, traîneau, animal, qui entrent dans la cadre, traversent le plan, et ressortent à l’autre bord du cadre. Enregistrement de la lenteur et de la rareté de la vie dans cet univers.
Au milieu de ce nulle part, se dresse une yourte artisanale, construite de perches de bois et de peaux de bêtes. Habitat traditionnel de ces peuples éleveurs nomades, qui se révèle fragile lorsque la tempête se déchaîne.
Un homme, une femme et leur chien habitent cette yourte et leur intimité nous est révélée avec de nombreux gros plans de leur visage, de leur repas frugaux, de leur corps ensommeillés, habillés encore de peaux et nous écoutons le bruit de leur respiration.
Nous suivons avec précision et lenteur la vie de ce couple dans leur vie ou survie quotidienne, la pêche et la chasse aléatoires, les parcours en traîneau, les poissons et les peaux qui sèchent dehors, leurs difficultés de tous les jours.
Mais aussi leur sérénité, calme, tendresse rentrée l’un vis à vis de l’autre, leur nécessaire solidarité. Tout est montré avec beaucoup de pudeur et de retenue. La violence est celle de la nature mais les hommes ont une grande maîtrise d’eux-mêmes.
Voir les quelques plans qui nous montrent la femme malade et la progression de la maladie jusqu’à sa mort quasi inattendue.
Ce plan presque furtif où l’on voit le corps de la femme allongée, les yeux clos, et contre-champ sur les yeux rougis et en pleurs de son compagnon.
Ici tout n’est pas expliqué, pourquoi Aga à-t-elle quitté ses parents ( photo du bonheur perdu avec leur fille) que leur a-t-elle fait de mal ? La visite du fils qui vient apporter le bois et l’essence.
Enfin il faut parler de la bande-son, magistrale, qui pendant une grande partie du film ne comprend que quelques échanges rares du couple et à l’unisson de la nature elle aussi discrète et quasi silencieuse.
Ce désert blanc et sonore est cependant de temps à autre perturbé par les bruits propres à la » civilisation urbaine et matérialiste » ceux des réacteurs des avions et de leurs lignes blanches tracées dans le ciel, le passage d’un hélicoptère ou le bruit de la moto-neige du fils.
Deux mondes co-existent, celui du film Aga, qui est celui du rêve, de la fable et d’une réalité humaine et culturelle disparue et celui de notre monde moderne. Que l’Inuit du film découvre peu à peu en allant à la recherche de sa fille qui habite bien loin et travaille dans une mine de diamant.
Plan fabuleux à la fin qui montre ce père dans ses habits de peaux avec son visage buriné isolé, minuscule, désemparé au milieu d’une énorme mine traversé de machines découvrant le monde mécanisé, minéral, urbain, dans lequel vit sa fille.
Mais sa fille pleure, elle reconnaît son père. En même temps que les retrouvailles et le pardon, elle discerne en lui, l’époux qui annonce la mort de l’épouse, qui par sa simple présence silencieuse lui dit : » tu n’as plus de mère » « et moi, je ne peux plus être là bas, je suis déraciné, mais maintenant je suis près de toi ». Tandis que nous, nous voyons l’humanité qui parcourt tous les êtres humains de tous les temps et tous les espaces.
Avec nos remerciements à Emilie Maj notre présentatrice pour sa sympathie, sa générosité et sa science durant cette belle soirée
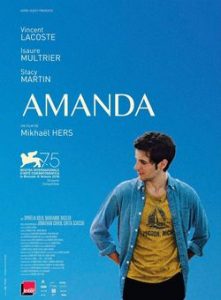 Prix Jean renoir des lycéens 2018/2019
Prix Jean renoir des lycéens 2018/2019 Du 14 au 20 novembre 2018
Du 14 au 20 novembre 2018 De la solitude contemporaine dans une grande ville
De la solitude contemporaine dans une grande ville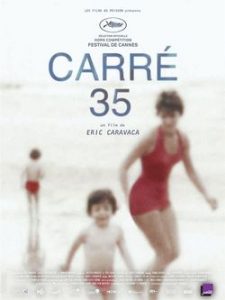 RETOUR SUR CARRE 35, UNE SI BELLE OEUVRE.
RETOUR SUR CARRE 35, UNE SI BELLE OEUVRE. Il sait de quoi il parle, lui qui à l’âge de douze ans a quitté son pays natal, l’Algérie pour une terre inconnue, la France et ses grandes villes. Il dit se souvenir des milliers de » pieds noirs » débarquant à Marseille avec juste une valise, seul héritage de plusieurs générations d’instituteurs, de petits employés, petits fonctionnaires, pour qui l’Algérie était leur patrie.
Il sait de quoi il parle, lui qui à l’âge de douze ans a quitté son pays natal, l’Algérie pour une terre inconnue, la France et ses grandes villes. Il dit se souvenir des milliers de » pieds noirs » débarquant à Marseille avec juste une valise, seul héritage de plusieurs générations d’instituteurs, de petits employés, petits fonctionnaires, pour qui l’Algérie était leur patrie. Comme tous les ans c’est un énorme plaisir de retrouver les personnes qui nous accueillent avec tant de gentillesse à l’Hostalrich et au cinéma le Lido, de prendre nos repas et de flâner dans ce jardin paradisiaque et surtout de se retrouver tous ensemble les Cramés de Montargis, autour de ces pique-niques en soirée.
Comme tous les ans c’est un énorme plaisir de retrouver les personnes qui nous accueillent avec tant de gentillesse à l’Hostalrich et au cinéma le Lido, de prendre nos repas et de flâner dans ce jardin paradisiaque et surtout de se retrouver tous ensemble les Cramés de Montargis, autour de ces pique-niques en soirée. Prix France Bleu au Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz
Prix France Bleu au Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz Animé par
Animé par  Présenté par Françoise Fouillé
Présenté par Françoise Fouillé