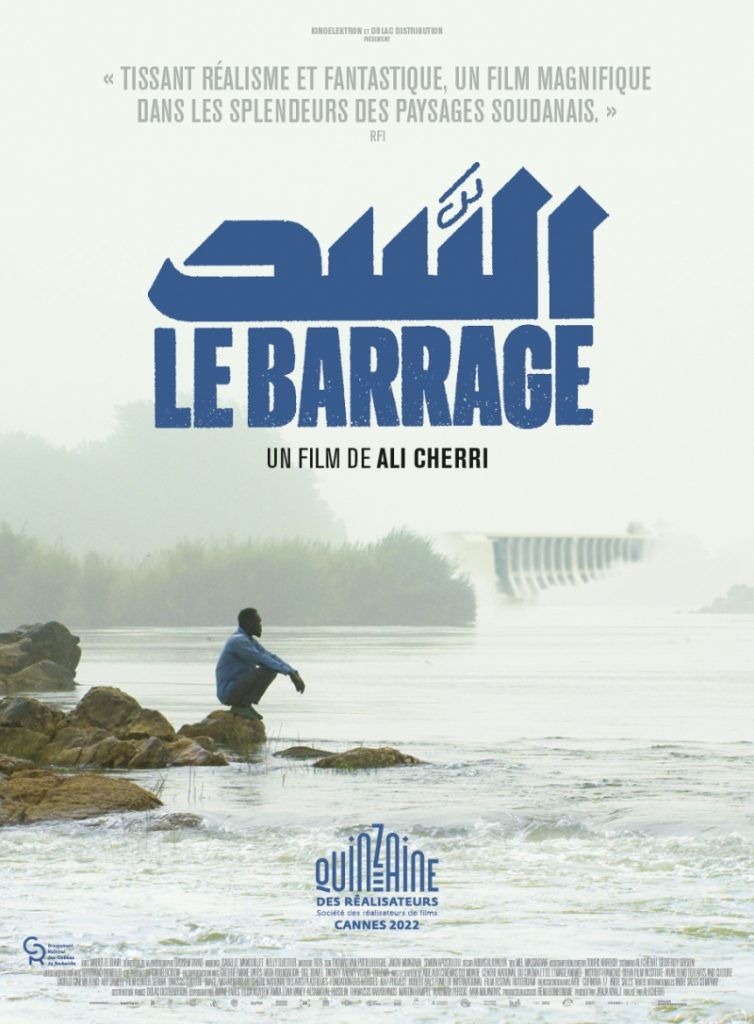Encore un très bon cru… Celui d’un cinéma naguère convalescent et qui montre toute sa vigueur retrouvée. Déjà l’an dernier nous étions sous le charme de Mia Hansen Love et de Jean-Pierre Dardenne. Cette année deux autres figures du cinéma français, celle de Michel Leclerc un réalisateur de comédies, pas que… Ce qui manque aux Cramés de la Bobine!
L’homme est sympathique, sa voix est chaleureuse, il s’exprime le plus souvent avec humour (Il cite Chris Marker, « l’humour est l’élégance du désespoir »). Il est de ces personnes qui donnent à chacun l’impression d’être un familier. Il est interviewé par Yann Tobin de la revue Positif. Y.Tobin, c’est un savant du cinéma, analyste rigoureux et qui jamais n’utilise l’autre pour se faire valoir. Bref, avec lui, on est assez loin du « Masque et la Plume » dans sa forme actuelle. On les écoute discuter et on se prend à apprécier un cinéma qu’on croyait connaître un peu mais qu’en réalité on connaissait assez mal.

Ça commence par « Le poteau rose » un court-métrage autobiographique, un film tendre ou l’autodérision et le doute de soi se conjuguent à l’émerveillement et l’amour. Mais c’est aussi l’histoire d’une rupture, d’une fin, et donc d’une perte… Mais de cette perte, il en fait une œuvre. L’art de Michel Leclerc c’est une alchimie qui transforme un malheur personnel en bonheur pour tous et c’est la clé de tous ses films.
Dans « J’invente rien » (Kad Merad et Elsa Zylberstein) où l’histoire d’un inventeur qui en voulant trouver une idée simple mais géniale, réinvente le droit à la paresse.« La vie très privée de Monsieur Sim » (Jean Pierre Bacri) nous montre encore un looser paresseux : le voyage d’un vendeur de brosses à dents un peu dépressif, qui finit par découvrir quelle personne il est. Ensuite, nous allons chez les rares et véritables grands de ce monde : « Pingouin et Goéland et leurs cinq cents petits » nous avions projeté ce film aux cramés de la Bobine. Suivent « La Lutte des Classes » où tout de même Leila Bekti et Edouard Baer nous tendent en miroir leurs contradictions. « Le nom des gens » qu’on revoit avec tant de plaisir, Sara Forestier quelle artiste ! Pour finir « télé gaucho » une incursion dans le monde fou des radios pirates (avec Sara Forestier, Felix Moati, et une fabuleuse équipe).

Et …changement de réalisateur et de style : Alice Winocour– Elle aime le style gothique vestimentaire, musical etc… Elle a un visage qu’on n’oublie pas. C’est une cinéaste importante du cinéma français, mais elle semble l’ignorer, elle est simple, sans se forcer. Aux cramés de la Bobine, nous la connaissons bien avec « Revoir Paris », et certains d’entre nous se souviennent de « Proxima ». À Prades nous revoyons une large partie de son œuvre dont trois courts-métrages. Nous ne connaissions pas « Augustine », un modèle hystérique de Charcot à la Salepetrière, enfermée jusqu’à ce qu’elle guérisse, mais cette jeune femme un jour a réussi à s’échapper, habillée en homme. Alice Winocour s’est emparée du sujet qui laissait le champ libre à la fiction. Le dernier film, c’est « Maryland », Vincent soldat de retour de mission est victime d’angoisses post-traumatiques. Pour attendre sa réintégration, il accepte un travail de garde du corps, quoi de plus banal ? Mais rien ne se passe comme prévu, nous voici embarqués dans un thriller palpitant. Il est souvent question dans ses films des traces laissés par un événement traumatique… et c’est vrai pour trois d’entre eux. Elle en connaît les variantes, elle en fait un art.
Entre différents films musicaux, Chantons sous la Pluie, LalaLand, Chercheuses d’Or, Cabaret, et des séquences de courts-métrages arrivent les films nouveaux en lice pour le prix Solveig Anspach. Nous serons attentifs à leur sortie en salle, certainement que vous serez ravi d’en voir aux séances des Cramés de la Bobine.
Tigru d’Andrei Tanase, film roumain, Véra vétérinaire a perdu son nouveau-né, et veut qu’il soit enterré selon les rituels orthodoxes, or il n’a pas reçu le baptême, au même moment, dans un zoo, un tigre s’échappe. On peut se passer de le voir.
Lullaby Alauda de Ruiz de Azua, film espagnol. Amaïa vient de mettre au monde son enfant, son mari, intermittent, accepte une mission qui l’éloigne d’elle. Le film décrit les affres d’une femme qui va de baby blues en difficultés à élever seule sa progéniture et se réfugie chez ses parents. On peut se passer de le voir.
Les damnés ne pleurent pas de Fysal Boulifa réalisateur anglais d’origine marocaine, réalisateur, scénariste. La vie d’une mère et son fils de 17 ans, né de père inconnu, au Maroc, près de Tanger. Voici une pépite qui à partir de deux personnages donne l’état d’une société. À voir absolument
Somewhere Over the Chemtrails d’Adam Koloman Rybansky film tchèque. Le film expose le cheminement du racisme et des théories de conspiration au sein d’un petit village de la République Tchèque. Un très beau sujet, inquiétant car la Tchèquie est partout. À voir absolument.
Six Weeks de Noémie Veronoka Szakonyi, réalisatrice et scénariste, film hongrois encore un premier film talentueux, une jeune sportive de haut niveau s’aperçoit très tardivement qu’elle est enceinte, elle va mettre au monde un enfant, elle songe à l’abandonner, la procédure d’abandon hongroise donne à la mère six semaines après l’abandon pour y renoncer. La jeune actrice (Katalyn Roman) dont c’est le premier film est remarquable. À voir.

Foudre- de Carmen Jaquier- Suisse, une jeune fille s’apprête à faire ses vœux, mais le décès de sa sœur aînée l’oblige à retrouver sa famille qu’elle avait quitté cinq ans plus tôt. Ce genre de sujet a le don de m’ennuyer ferme, raison pour laquelle je vous invite à en lire les critiques.
Lost Country de Vladimir Periscic Serbie, en 1996 on apprend que les résultats électoraux de l’opposition sont invalidés, nous sommes sous le régime de Milosevic. Stefan 15 ans, comme tous les élèves, souhaite participer à la protestation, mais voilà, sa mère est porte-parole du régime. C’est une mère aimante et une femme de décision. Remarquable. À voir.
Le Ravissement est le film Français de la série, un mélo comme on les aime, Lydia sage-femme accouche sa meilleure amie et se substitue à elle car elle est débordée et dépressive. La vie de Lydia hors son travail est un peu vide à l’exception d’une rencontre, un jour. Lydia c’est Hafsia Herzi, le rôle masculin c’est Alexis Manenti . À voir, c’est très bien.
Suivent deux avant premières Françaises, Le temps d’aimer de Katell Quillévéré, tout le monde a vu ces images de femmes outragées, tondues parce qu’elles avaient des relations avec les soldats allemands en 39-45, la vie de l’une de ces femmes est le sujet de ce film. Nul doute qu’il aura une belle diffusion.
Rosalie de Stéfanie Di Giusto, l’histoire de la femme à barbe avec deux acteurs en vue, Nadia Tereszkiewicz et Benoit Magimel. Quelle femme ! Ce film lui aussi aura une belle diffusion.
Nous terminons ce compte rendu en soulignant que Valery Leroy réalisatrice de courts-métrages qui a déjà une œuvre originale et drôle réalise son premier long-métrage. À suivre absolument.
Bonnes Vacances
Georges