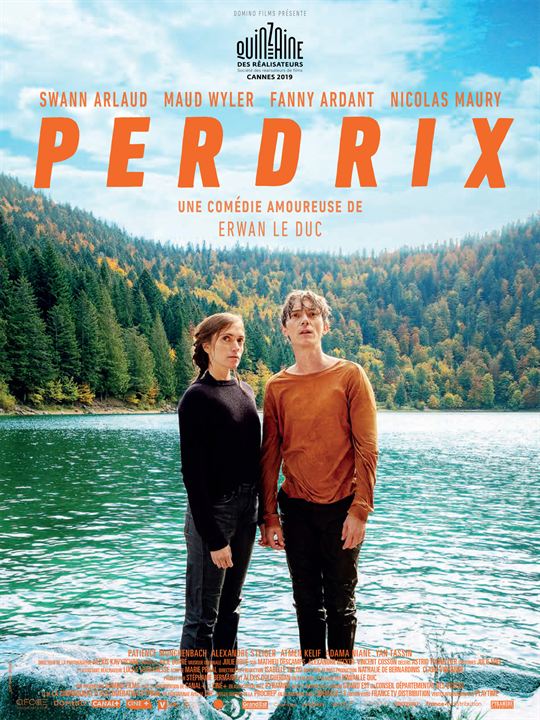Le lundi commence allègrement le 60eFestival du Cinéma de Prades, eh oui !
Avec « Vire-moi si tu peux », deuxième court métrage d’un jeune réalisateur, Camille Delamarre, c’est aussi un acteur et surtout un monteur reconnu. Ici, il bénéficie d’un sacré casting et donc d’un bon coup de pouce, avec deux acteurs principaux, Patrick Timsit et Richard Berry, c’est drôle et très bien fait. Et donc nous allons guetter son premier long-
Ensuite nous faisons la connaissance de Serge Bromberg qui a fondé Lobster, une société un peu folle, dont la mission consiste à retouver et à rénover des films disparus ou anciens, on n’imagine pas combien le hasard est généreux, comment s’agencent les coïncidences pour ceux qui cherchent, pour ce genre « d’archéologue du cinéma ». Serge Bromberg est un découvreur. Il est cabotin, mais c’est un artiste, personne n’est parfait. Ce qui est parfait c’est le travail de sa maison. Vient le ciné, le temps de voir du muet ! On regarde parfois ça avec un peu de condescendance, on n’y tient pas plus que ça, mais que la séance commence et on remise très vite nos préjugés. Ma culture cinématographique concernant Meliès, se bornait à l’image de la lune qui reçoit une fusée dans l’œil, celle qui illustre le 60èmeFestival de Prades ! Mais le film ? Eh bien nous avons eu droit à une projection colorisée, comme lors de sa première projection! Dès ses débuts, le cinéma se rêvait en couleurs. Avec Meliès, on est dans un imaginaire débridé, à l’époque de Jules Vernes, on songe à la conquête de l’espace, six savants fous alunissent, rencontrent des lunaires, (des sélénites), ces drôles d’extraterrestres ! Les trucages commencent dès les débuts du cinéma.
Autorisons-nous cet aparté, l’histoire compare souvent deux tendances, Melies, sa fantaisie et ses trucages et les Frères Lumières (l’artiste et le scientifique), pour leur mise en lumière du réel. Observons aussi que lorsqu’on regarde la galerie de portraits des fondateurs du cinéma on n’y voit que des messieurs. On oublie Alice Guy née en 1873, dont pourtant Wikipédia nous dit : « Avec La fée aux choux, qu’elle tourne en 1896, elle est la première réalisatrice de l’histoire du cinéma. Elle joue un rôle de pionnière en ayant l’idée de filmer du contenu de fiction pour faire vendre des caméras proposées par Gaumont. En 1910, elle est aussi la première femme créatrice d’une société de production de films, la Solax Co3 ». Une paille ! Mille films presque tous disparus ou mal identifiés. Pour l’essentiel Serge Bromberg et ses collègues n’en ont probablement jamais eu la restauration, car il nous apprend qu’en quelques décennies, les bobines de 35 mm en nitrate de cellulose durcissent deviennent compactes, indébobinables, avant que de se ratatiner sur elles-mêmes. (Mon explication est un peu sommaire, j’en conviens, mais ça ne change rien au résultat). Autant dire que les films que nous propose Serge Bromberg sont de purs miracles ! Sauvés, reconstitués grâce des recherches folles dans le vaste monde et à des techniques impossibles (science et patience !)
Et au total, nous avons vu quelques muets, dont quelques magnifiques Laurel et Hardy et particulièrement « Vive la Liberté » qui se déroule au sommet d’un gratte-ciel… Terreur époustouflante, et rire libérateur garanti ! Nous avons aussi vu la plus grande bataille de tarte à la crème de l’histoire du cinéma, et bien d’autres trésors.
Serge Bromberg nous quitte, il était un véritable showman, accompagnateur pianiste (très Jazzy) des films, conteur, et drôle. Alors, une petite anecdote pour finir : Serge Bromberg est dans la salle et nous discutons avec lui en petit groupe, et le piano qui devait lui permettre d’accompagner un film manquait. Alors, il nous dit : « On va sans doute me trouver un peu excessif, mais dans la mesure où j’accompagne ce film au piano, j’en ai exigé un !».
Arrive Nicolas Philibert et ses documentaires. On se souvient de l’immense succès d’Être et Avoir.
Au physique, imaginez Marilyn Monroe sur la grille de métro, maintenant, mettez à sa place Nicolas Philibert, qu’obtenez-vous ? Un homme avec tous les cheveux sans exception, dressés sur la tête.
Blague à part, c’est un homme de petite taille, un peu austère et réservé, mais qui immédiatement captive. Son visage, son timbre de voix, cette manière de parler sans jamais élever le ton, et lentement, pesant chaque mot, scrupuleux, très attentif. Lorsqu’on lui demande pourquoi, il fait du cinéma, il cite Henry James : « j’écris des livres pour savoir ce qu’il y a dedans disait-il, et moi je fais des films pour savoir ce qu’il y a dedans ».
Et je ne sais pas si c’est un effet de sélection, on a l’impression que Nicolas Philibert aime les lieux clos, les systèmes fermés, et il les filme en essayant paradoxalement, d’en savoir le moins possible sur le sujet, en gardant sa capacité d’étonnement :
« La ville Louvre ; le pays des sourds ; de Chaque instant ; La nuit tombe sur la ménagerie ; La Maison de la Radio ; La moindre des choses ; Un animal des animaux » Musée, institution de sourds, école d’infirmière, zoo, radio, asile, jardin des plantes. Pourrait-il aussi bien filmer dans un lieu mal circonscrit ? Il faut que j’en trouve un pour le voir.
Il ne fallait rien louper. Il y a une sorte de magie dans ses films : le ton, la distance, la méticulosité, et son amour des visages, pas du visage qui joue un rôle social, non, celui de l’être en tension, celui qui travaille, qui pense, qui fait. Celui dont le projet, l’action lui fait oublier qu’il existe, qu’il est en train d’exister. Le style de Nicolas Philibert a quelque chose de fascinant. Pris dans cet engrenage qu’est la succession de ses films, on voudrait que ça ne s’arrête pas, on a l’impression de comprendre, d’être avec, de partager. L’instant de la projection, on est orang-outan, sourd, journaliste ou empailleur…On est en empathie avec les personnages de ses sujets. Lors de son dernier débat, Nicolas Philipbert demandait au public qu’est-ce qu’un grand film ? Et nous y sommes allés de nos définitions malhabiles ou parfois aiguisées. Il gardait la sienne pour la fin, je n’en ai pas retenu les termes, mais je me souviens que sa définition n’était pas celle d’un film en particulier, mais celle d’un chef-d’œuvre, en substance il dit à peu près : « Quelque chose qui dépasse celui qui l’a fait, quelque chose de plus grand que l’intention de son auteur ! »… C’est ce que Nabokov disait du « Don Quichotte ! »
Mon bémol c’est « La moindre des choses » ce documentaire passionnant se passe à Laborde, institution pour personnes malades mentales. Qu’est-ce que la psychiatrie institutionnelle avait demandé N.Philibert au Docteur Jean Oury, fondateur de l’Institution, et lui de répondre laconiquement : « C’est la moindre de choses » … Séduisant, car on est invité à découvrir la chose en question.
Pourtant, je trouve que ce film ne voit pas assez la part de l’institution dans la maladie de ces braves gens, sauf un instant fugace, par un personnage du film, (François je crois), élégant, sensible, spirituel, édenté…Pourquoi les vieux et moins vieux pensionnaires n’ont plus de dents en psychiatrie, pourquoi leur rasage devient approximatif ? Comment parmi la multitude de malades, devient-on un vieux pensionnaire qu’est-ce qu’on y gagne, et surtout, qu’est-ce qu’on y perd ?
Puis vient le moment où l’on quitte Nicolas Philibert, plutôt c’est lui qui nous quitte et nous le regrettons.
Intermède, Laïla Marrakchi, avec 2 longs et un court… pour ma part, j’aurai sans doute préféré l’inverse car les affres de la jeune bourgeoisie branchée marocaine m’intéressent autant que « la boum » .
Arrive Cédric Kahn, je ne connaissais pas, je n’avais vu qu’un film de lui, et là, belle sélection et autant vous le dire tout de suite, il va succéder avec une classe folle à Nicolas Philibert. Qu’est-ce qu’on nous présente ?
« Une vie Meilleure, la Prière, Feux rouges, Roberto Succo, l’Ennui, Vie Sauvage ».Mais d’abord un mot de l’homme Cédric Kahn, il succédait bien à Philibert pour l’éthique et dans l’attention portée aux personnages et aux acteurs, aux situations et à la manière de les filmer. Mais l’homme Cédric Kahn m’apparaît plus naturel, moins construit, plus spontané et il fait de la fiction.
Il a chez lui, une sorte de méfiance pour le « psychologisme » et il feint de ne rien trop savoir des personnages, il laisse à chaque spectateur son libre jugement, il préfère de loin parler des circonstances et conditions de tournage, des acteurs qu’il a filmés. Au contact, il est simple, direct, attentif (très), et toujours le plus clair et fluide possible dans ses commentaires, il accepte les critiques les plus dures comme les plus élogieuses avec placidité et bienveillance. Cédric Kahn est son meilleur agent parce qu’il a un contact spontané et fin et peut-être son plus mauvais parce qu’il n’exprime aucune vanité d’aucune sorte, dans un monde qui n’est pas fait pour ça.
Dans cette sélection, deux films étaient inspirés de livres, l’un « feux rouges » de Simenon, et « L’ennui » de Moravia, je réunis ces deux films très différents, parce qu’il se trouve que j’ai un peu lu les auteurs. Cédric Kahn s’inspire, il ne reproduit pas, il ne craint pas de modifier les histoires. Pourtant, les Simenon et Moravia de Cedric Kahn y sont mieux que sentis, ils y sont eux-mêmes. Cedric Kahn est un cinéaste de l’ambiance, du climat. De ces films, il faut tout voir et revoir si l’on peut. « La vie sauvage » d’abord, vous savez ce marginal un peu mégalomane qui décide de soustraire ses enfants à la décision de justice et à leur mère, et les élève en fugitifs comme des Sioux. C’est presque un documentaire, c’est aussi un remarquable travail d’acteurs. A l’exemple aussi de « L’ennui », le fameux Moravia dont je parlais à l’instant, le héros fait aussi penser à « un amour de Swann » en moins soft au plan physique mais en aussi vif et douloureux sur le plan affectif… il y a des voies où il ne faut pas s’embarquer ! Un film remarquablement joué là aussi. (Charles Berling, Sophie Guillemin (quel rôle ! elle y est parfaite) et Arielle Dombasle. Mais surtout, il faut attendre avec impatience le prochain film de Cédric Kahn « Fête de famille » et ne pas le manquer, Les Cramés de la Bobine seront vigilants.
Avant de finir ce billet, déjà bien long, trois choses :
-Il y a un prix du public du Court-Métrage à Prades, et il y a une rigoureuse présélection qui aboutit à nous présenter 15 courts-métrages. Ambroise Michel, l’un des réalisateurs était présent, c’était le seul, il n’a pas gagné, mais tout de même, son « court » était bien fait et drôle. Presque tous étaient bons. Si un jour près de chez-nous, un ciné projette des courts, je serais un bon client. Nefta Foot Club a obtenu le prix, je ne sais pas comment les organisateurs ont fait pour trouver un vainqueur, pour ma part, à 80 % d’entre eux, j’ai mis la note maximum… Mais je le reconnais volontiers, Nefta est un franc moment de ciné, drôle, original et inattendu.
-En bref : Signalons deux films légèrement anciens, « Parlez-moi de vous » de Pierre Pinaud, un premier long métrage, avec dans le rôle principal, magnifique, Karine Viard, elle est en compagnie de Nicolas Duvauchelle et bien d’autres. Puis vint « Larguées, d’Eloïse lang » Camille Cottin, Camille Chamoux, Miou-Miou, ce n’est pas ce que je préfère, les bonnes actrices ne font pas nécessairement de bons films. Et deux prévisonnements : Papicha de Mounia Médour, remarquable, dans la lignée du grand « Mustang » puis Alice et le Maire de Nicolas Pariser( Avec Fabrice Lucchini et Anaïs Demoustier.) Superbes et à retenir !
-Enfin, le Festival de Prades, demeure une joie dans la vie de ses festivaliers. Pas seulement parce qu’on y reconnaît les visages amis, qu’on y apprécie les compétences, la gentillesse, le travail, les choix, mais aussi pour le style du Festival de Prades, son climat sympathique.
Et puis, l’essentiel du Festival est mono Salle…et rien que ça, rend ce festival distinct et agréable, les habitués des festivals musique, théâtre, ciné, comprendront. Décidément, Prades, cette belle petite ville touristique, avec ses 6000 habitants, demeure une grande ville de la Musique et du Cinéma.