
Quand les lumières se rallument, la dame assise devant moi se retourne, et nous nous regardons et nous remettons à rire (autour de nous, rien que des visages hilares), elle dit, On a bien fait de les restaurer ces films.
Il est d’abord heureux que « l’imbroglio juridique qui bloquait depuis de nombreuses années la ressortie des films de Pierre Etaix » ait trouvé une « fin heureuse et définitive »[1], sans quoi il n’y aurait eu pas plus de restauration que de ressortie en salle et nous aurions loupé quelque chose !
Aujourd’hui, découverte de Tant qu’on a la santé, composé de quatre courts métrages. C’est tout particulièrement le quatrième et dernier intitulé Nous n’irons plus aux bois qui fait notre bonheur. Soit, lâchés dans des champs et bosquets, trois individus ou groupes d’individus :
A = un chasseur
B = un paysan qui répare sa clôture
C = un couple de pique-niqueurs BCBG
Le comique réside dans des gags visuels ressortant de la plus pure tradition burlesque (la tentative de franchir un ruisseau sans se mouiller les pieds ; une chaussure qui flotte au fil de l’eau, son propriétaire cherchant à la récupérer sans poser par terre le pied déchaussé etc.) mais aussi (schéma utilisé à plusieurs reprises, sans qu’on s’en lasse) de l’absurde : une action de A (ou B, ou C) a des répercussions sur B (ou A, ou C) qui croit C (ou A, ou B) fautif parce que c’est lui qui apparaît alors dans son champ de vision.
Il en résulte tout naturellement qu’au sortir de la salle, me semblent parfaitement comiques des situations qui communément m’agacent (la rébellion des objets, loin de m’amuser ou de titiller mon imagination, m’exaspère m’énerve m’horripile), à savoir :
aux toilettes, le papier WC dissimulé sous une coquille métallique et dont l’extrémité, au lieu de pendre à portée de main, est collée au rouleau
l’absence de distributeur de savon, que je ne remarque qu’après m’être mouillé les mains
dans le métro, la porte fermée du tourniquet à laquelle je me heurte parce que, plongée dans mes plaisantes pensées, j’ai oublié d’insérer le ticket (que par ailleurs j’ai pensé à sortir de mon sac et que je tiens à la main) dans la fente qui en déclenche l’ouverture.

Si la musique adoucit les mœurs, le cinéma peut, un moment, rendre la vie plus légère.
Jeudi 8 juillet 2010
[1] www.lesfilmsdetaix.fr







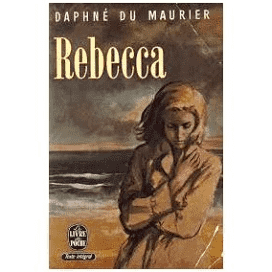


![NELLY KAPLAN [ca. 1970] French photo of film director ...](https://i.ebayimg.com/images/g/ZP0AAOSwhwRfINQZ/s-l300.jpg)







