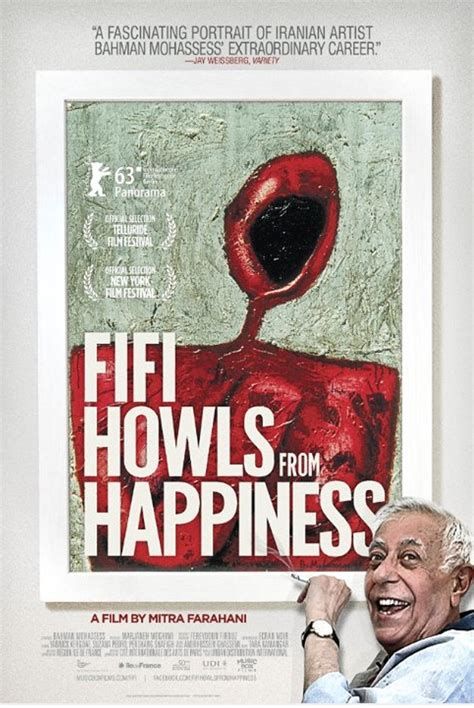Si le festival de Prades 2021 comporte peu de nouveaux longs-métrages de fiction, les courts-métrages ont été à l’honneur, au total 32 courts-métrages (dont 8 Iraniens)…
Nous avons également pu apprécier trois nouveaux documentaires :
« Du Rififi dans le tiroir » d’Anne Morin, cette femme et son époux se sont lancés dans une procédure d’adoption, seul le Mali rendait possible l’adoption. Anne Morin décide de filmer méticuleusement l’aventure de cette adoption, avec ses impasses, les affres de l’attente particulièrement dues au changement de pouvoir et à l’évolution des législations au Mali. Et son combat pour aboutir… Elle utilise parfois la fiction pour faire comprendre ce qu’elle a éprouvé. Ce documentaire comporte bien quelques longueurs, mais il est touchant et sa fin est heureuse. Le Jury Jeunes en a fait son premier prix. Anne Morin était autant émue que si elle avait reçu une palme d’or !
« Retourner à Sölöz » de Serge Avédikian en présence de… Serge Avedikian. Nous le connaissons, nous l’avons vu aux Cramés de la Bobine et pour certains d’entre nous à Prades en 2016. Chacun se souvient de son énergie et de son enthousiasme communicatif. Sölöz est un lieu de mémoire pour lui-même, la communauté Arménienne, pour les Turcs quoi qu’il en soit, et pour l’humanité. De quoi est faite cette mémoire et qui accepte de la faire sienne ?
Avant le génocide, ce village était celui de ses ancêtres, après le génocide des Turcs de Salonique y furent transplantés, Avedikian s’y est rendu 4 fois entre les années quatre-vingt et maintenant. Ce lieu ou à chaque voyage les traces matérielles des Arméniens s’effacent davantage est aussi pour Avedikian l’occasion d’échanger avec les habitants. Comment dialoguer, comment se rapprocher, garder le fil ? Ce Documentaire est à découvrir. D’ailleurs l’œuvre entière de Serge Avedikian le serait.
Et Pour finir avec les documentaires voici « Charlie Chaplin le Génie de la Liberté » d’Yves Jeuland et François Aimé, ils n’en sont pas à leur coup d’essai, ils avaient réalisé ensemble un documentaire sur Jean Gabin. Charlie Chaplin dure 2h25 et on ne voit pas passer le temps, c’est un travail superbe qui a necessité des années de travail. Aucun subterfuge, pas de fausses interviews de gens qui l’ont connu, seulement des extraits de films et de reportages. L’Homme privé Chaplin, l’Acteur Charlot, L’homme public Chaplin, tout cela est impeccablement tressé avec des commentaires bien documentés. Ce travail est un chef-d’œuvre ! S’il n’était pas possible de le présenter aux Cramés de la Bobine, il vous faudrait aller le voir où qu’il passe!
Le festival se termine par une carte blanche à Thierry Laurentin, Directeur de programmation à la Gaumont et… Cinéphile. 3 films Panique de Duvivier 1946 (Une adaptation de Monsieur Hire de Simenon), Ten de Abbas Kiarostami 2002 et The Swimmer1968 de Franck Perry… 3 chefs-d’œuvre présentés et débattus par Thierry Laurentin, et avec quelle maestria ! On ne peut souhaiter qu’une chose, que ces films superbes prennent place dans Ciné Culte !
Les ciné rencontres de Prades, sont un peu une université d’été des amateurs de cinéma. Et si l’on peut regretter l’absence de nouveautés, sa tenue qui n’a rien à envier aux années précédentes laisse augurer un excellent cru 2022.