 J’aime ce cinéma-là, certainement celui d’un réalisateur qui compte. Commençons par écouter sa musique, elle dit des choses. Dans l’ensemble ce n’est pas la mienne, elle ne me correspond pas. Pourtant dans ce film, elle apparaît évidente. Notons aussi un morceau filmé joué par un musicien, c’est L’Oru par Pétru Bracci, dans sa cellule de prison, il chante et s’accompagne de sa guitare, magnifique.
J’aime ce cinéma-là, certainement celui d’un réalisateur qui compte. Commençons par écouter sa musique, elle dit des choses. Dans l’ensemble ce n’est pas la mienne, elle ne me correspond pas. Pourtant dans ce film, elle apparaît évidente. Notons aussi un morceau filmé joué par un musicien, c’est L’Oru par Pétru Bracci, dans sa cellule de prison, il chante et s’accompagne de sa guitare, magnifique.
Cette musique dit ce que dit le film, elle indique l’intime mélange de contemporain et de tradition. Elle n’exagère rien, elle accompagne, elle est au service de l’image. On a l’illusion qu’elle forme une sorte « d’échafaudage musical » pour chaque plan.
Mais justement, venons-en aux plans, ils sont brefs et allusifs, par exemple : vue sur une cueillette des kiwis (le mois d’août) sous le ciel corse, à deux pas de la mer, puis en contrechamp, arrive une procession d’autos qui s’arrêtent non loin, puis on se rapproche des voitures, on ne comprend pas tout de suite, on va assister à une violente et méthodique scène de meurtre… Fin de séquence, un homme invite les cueilleurs de kiwi, sans doute des saisonniers, à n’avoir rien vu. Ou encore cet autre série de plans : le bar (le passeur naïf), le juge (l’innocent), la prison (gogolito). Ces plans sont comme sa musique, ils sont brefs, ils bousculent, au même rythme. Le hors-champ est l’autre musique qui accompagne le film, il est partout. Cette musique-là, est celle de chaque spectateur.
Lorsqu’on regarde une minute sur Wikipédia le travail de Thierry de Peretti, on constate qu’on a affaire à quelqu’un qui doit connaître parfaitement les ressorts de la tragédie. Ici, son unité de lieu c’est la Corse…
Sur le fond, notons en passant qu’il aime Léonardo Sciascia, ce grand écrivain sicilien. On retrouve en filigrane dans son film, quelques thèmes tels le meurtre toujours recommencé, ou celui d’une humanité qui aurait congédié le diable pour incompétence.
Mais il y a d’abord le titre, Une vie violente : impeccable — Pas « vendeur » mais honnête et rigoureux — C’est aussi le titre d’un roman de Pier Paolo Pasolini, sans aucun doute une autre référence pour T. de Peretti et pas seulement pour son roman, comme on s’en doute.
Allons à l’histoire maintenant. Stéphane, le héros tragique du film, est un personnage qui s’inspire de Thierry Montigny, un jeune homme assassiné en août 2001. Du coup, je me suis arrêté sur les coupures des journaux de l’époque. C’est curieux de lire ces vieux articles des années 1996, 2000… Ils sont forts ces journalistes. Libération, le Parisien et le Point nous restituent une sorte de film qui tient du film noir et du Far West.
Lorsque ces événements sont repris dans Une vie violente, curieusement, ce n’est plus du Far West, c’est juste noir, la vie de Stéphane est une sorte d’engrenage qui va du rêve d’un monde meilleur au cauchemar ; la violence, la méfiance, l’inquiétude, l’angoisse et la peur dégoulinent de partout. On se rend compte alors, lorsqu’on a feuilleté les journaux de l’époque, que si l’on excepte quelques transpositions, ce film est un quasi documentaire. Décidément Thierry de Peretti travaille ses films comme Léonardo Siascia travaillait ses livres, proches des faits. On y reconnaît l’Armata Corsa, les FLNC, la brise de mer, des commis de l’état (ex-ministre, agents de renseignements, élus locaux etc.) On peut mettre des noms sur certains personnages, pour ne citer qu’eux, J.M. Rossi, F. Santini, T. Montagny, D. Marcelli. Les acteurs qui incarnent ces personnages apparaissent crédibles, justes.
Je revois la scène de prison, l’ambiance y rappelle Un Prophète d’Audiard. François parle du mouvement de libération de la Corse avec Stéphane, il le forme ; sa manière d’avancer vers son but, tout en fausses nuances et en fausses hésitations, ses inflexions de voix sont convaincantes. J’imagine que Stéphane, jeune homme romantique, lecteur d’ouvrages sur l’émancipation des peuples tels ceux de Frantz Fanon, lui-même à la recherche de sa propre émancipation, ne pouvait résister à François, au charisme de François, à l’image paternelle de François, lui qui n’avait plus de père et qui sans doute, cherchait à en adopter un.
De Stéphane qui représente Thierry Montagny, T. de Peretti nous dit que s’il l’avait connu, il aurait pu devenir un ami. Dans l’article précédent, Marie-No décrit bien ce personnage. Il y a quelque chose de touchant, de sincère, chez lui. Mais, il y a aussi la demi-teinte, une zone grise. En témoigne son dialogue ambigu avec des trafiquants, il ne leur propose rien de moins que d’arbitrer intelligemment entre la chose privée (vols, trafics divers) et la cause… Il a aussi la fatuité naïve d’imaginer qu’il appartient à ceux qui comprennent les fins dernières du mouvement. T.de Peretti n’a aucune complaisance avec cet ami potentiel, il le voit à bonne distance. Avec empathie mais sans complaisance.
L’analyse solide, terre à terre, sans demi-teinte dans ce fatras violent d’actes et de mots, revient aux femmes, à la scène des femmes, elles décrivent avec humour et fatalisme ces illusions mortelles, la mécanique mimétique de la violence, de la vengeance et des morts annoncées. Ce sont elles qui résument et dénoncent, ce sont elles qui disent l’histoire telle quelle. Cette séquence respire la vérité, on en est convaincu lorsqu’on lit les témoignages lucides des mères de Dominique Marcelli ou de Thierry Montagny. Quel courage !
En fin de film on voit Stéphane marcher seul dans la rue, à découvert alors qu’il est menacé de mort, vers où ? Vers quoi ? Il se rappelle qu’à l’âge de cinq ans il a vu, gisant dans son sang sur le sol, un homme tué par balle. Il aurait aimé qu’on lui dise « ce n’est pas vrai ». L’imagination ne peut rien contre la réalité. Et la réalité du jour se l’imagine-t-il dans son horreur ? Lui qui marche ses dernières minutes, ses derniers pas vers la fin de son histoire ?
C’est fini ? Pas tout à fait, le spectateur de Une vie violente se voit transformé en une sorte de sparing-partner, bousculé par la musique du générique. Nous, aux Cramés de la Bobine, ça va, on prend le temps de discuter du film, mais pour les autres… vous ne pensiez tout de même pas vous lever et sortir comme ça, peinards !
Georges
PS : Souci du détail, les femmes fument des « Muratti », comment ont-ils fait pour retouver un paquet de Muratti ?
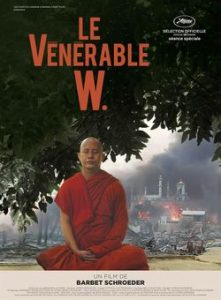 Ce film a été présenté en Séance Spéciale au Festival de Cannes 2017 Semaine du 12 au 17 octobre 2017
Ce film a été présenté en Séance Spéciale au Festival de Cannes 2017 Semaine du 12 au 17 octobre 2017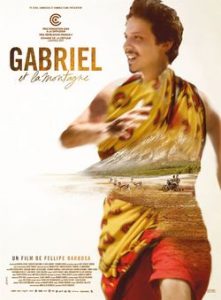
 Nominé au Festival d’Angoulême et de Cannes
Nominé au Festival d’Angoulême et de Cannes