 3 prix au Festival de Valenciennes 2017
3 prix au Festival de Valenciennes 2017
Du 29 juin au 4 juillet
En Présence du réalisateur Chad Chenouga
Film français (mai 2017, 1h38) de Chad Chenouga avec Khaled Alouach, Yolande Moreau et Laurent Xu
Distributeur : Ad Vitam
Synopsis : Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…
« Deux choses en préalable ».
-Merci à Françoise pour la présentation de Chad Chenouga, de nous avoir signalé 17 rue bleue, le premier film de Chad Chenouga novembre 2001. Comme nous avons aimé « De toutes mes forces » on cherchera à mieux connaître ce réalisateur en se procurant ce film coûte que coûte.
-Et puis, Chad Chenouga débattant sur son film a assuré la réussite de la clotûre de notre saison des Cramés de la Bobine, le public a été conquis par son authenticité, sa sympathie, la qualité de ses réponses à nos questions. Il y a des moments comme ça !
Maintenant, un mot sur le film, ou plutôt sur ce que j’en ai noté.
Nassim est orphelin, ce n’est pas un thème rare, cinétrafic en dénombre 186, des misérables en passant par Tarzan… et je me souviens de « l’incompris » de Luigi Comencini, cet enfant auquel son père déniait tout chagrin. Ici, l’orphelin c’est Nassim (Khaled Alouach) dont la mère est morte d’une overdose. Il l’a vue gisante, couchée face contre sol, morte. C’est lui qui allait chercher ses médicaments psychotropes à la pharmacie. Il ne peut pas s’autoriser à exprimer ouvertement son chagrin, il lui faudrait alors parler d’elle aux autres, vous imaginez ? On se souvient fugacement de « Fais de beaux rêves » de Marco Bellocchio, la mort par suicide de la mère provoque chez Massimo un sentiment d’abandon, de culpabilité, de honte. Egale douleur pour Nassim et quant à la honte, c’est aussi celle de ne pas être recueilli par sa tante, de devenir une sorte de paria. Il est alors placé dans un foyer d’accueil. Ainsi commence le parcours de Nassim responsable de son présent et de son avenir. Le décor est planté, comment Nassim va-t-il s’y prendre ?
Parmi ce que Chad Chenouga nous donne à voir, j’ai remarqué la manière dont le jeune adolescent met rapidement en place des stratégies d’isolation de ses différentes situations de vie. Il y a son monde psychique marqué par son amour pour sa mère et de son deuil ; il y a aussi le monde du lycée qui représente l’idéal social de Nassim ; et enfin le monde du foyer d’accueil pour orphelin qui représente sa vie quotidienne et un stigmate. Trois entités, trois mondes qui de son point de vue, ne sont pas conciliables, ne doivent pas correspondre, ce serait dangereux. Cela exige habileté et subterfuges (voir la scène sur subterfuge)
Lorsque par inadvertance, ces mondes se recoupent, tout se dérègle pour Nassim, voici quelques illustrations parmi bien d’autres :
-Accepter de dormir chez les parents de sa petite amie au lieu de rentrer au foyer, transforme le carosse en citrouille, aboutit à des mesures de rétorsion de la directrice du foyer. (Sorties, téléphones, etc.)
-Offrir à sa petite amie les boucles d’oreilles de maman, induisent l’inhibition sexuelle de Nassim.
-Laisser un livre tamponné par le foyer chez sa petite amie aboutit à ce qu’elle découvre le « pot aux roses » et que leur relation en soit brisée.
Tout conforte donc Nassim dans son « système » protecteur d’évitement, de cloisonnement et de contrôle, où le souci de paraître prime. Cet exercice exige de l’habileté, du style. Et à propos de style, regardons Nassim, les vêtements de Nassim, il porte de belles chemises, ce n’est pas si fréquent à son âge en 2017. Il porte aussi un remarquable foulard bleu . (Notons en passant un très beau plan de Nassim sur fond bleu). La « vêture » de Nassim (comme on dit au Foyer) ne ressemble qu’à lui-même, elle est subtilement hors des codes vestimentaires des milieux qu’il fréquente. Il est élégant. Au demeurant, c’est un garçon comme les autres, bien de son âge, à l’aise avec ses nombreux potes et les filles.
Les personnages clés qui jalonnent sa vie sont principalement des femmes. Sa mère (petit rôle essentiel et impeccable de Zineb Trici, pâle, maladive) ; Sa (trop curieuse) petite amie ; Madame Cousin, la patiente Directrice à la tendresse rentrée, (Yolande Moreau) ; la déterminée Zawadi (Jisca Kalvanda, vous vous souvenez de « Divines » ?) ; ou encore Mina pour son « don de soi », cette jeune fille « ensinte » qui n’est pas sans rappeler le personnage d’ Elodie Bouchez dans « la faute à Voltaire » d’Abdellatif Kechiche.
Singulièrement, en même temps qu’il nous livre le monde compartimenté et douloureux de Nassim, Chad Chenouga montre aussi la possibilité d’un monde ouvert et sa patte de réalisateur nous fait sentir la tension, la volonté de « devenir » de Nassim. En ce sens, « De toutes mes forces » est un titre parfait.
Autres remarques :
Chad Chenouga nous a expliqué comment il a fait travailler ses acteurs…au bout c’est une réussite. Bien sûr, nous sommes nombreux à aimer Yolande Moreau, ici elle est une directrice de foyer lucide et clémente, la femme qu’elle représente derrière sa fonction demeure sensible, empathique. Quant aux jeunes, nous leur souhaitons un bel avenir. Pour ma part, je suivrai plus particulièrement Khaled qui commence sa carrière avec ce rôle en or et qui promet, et Jisca cette jeune actrice énergique, débordante de vie et de spontanéité, j’anticipe bien ce qu’ils nous réservent.
J’ajouterai que cette histoire, trois fois celle de Chad, puisqu’il l’a vécue, écrite et tournée nous apparaît sincère et émouvante. Et je suis d’accord avec Eliane pour noter ce que ce film doit à son cadrage, à ses plans qui parfois se resserrent sur Nassim marquant son enfermement, et à son montage rigoureux et rythmé.
Encore merci Monsieur Chad Chenouga, et à bientôt pour votre prochain film.
 Grand Prix au Festival International du Film d’Amiens
Grand Prix au Festival International du Film d’Amiens Film français (mars 2017, 1h36) de Olivier Peyon avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia et Maria Dupláa
Film français (mars 2017, 1h36) de Olivier Peyon avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia et Maria Dupláa CITOYEN D’HONNEUR
CITOYEN D’HONNEUR Animé par
Animé par  Film français (février 2017, 1h16) de Dan Uzan
Film français (février 2017, 1h16) de Dan Uzan Prix Venezia Classici du meilleur documentaire à la Mostra de Venise 2016
Prix Venezia Classici du meilleur documentaire à la Mostra de Venise 2016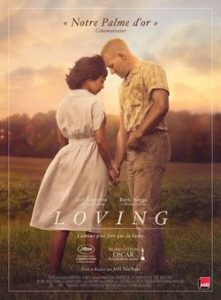 nominé au Festival de Cannes 2016 et aux Golden Globes 2017
nominé au Festival de Cannes 2016 et aux Golden Globes 2017