On ne dira jamais assez de bien de Viva Il Cinéma !
Heureux cette année encore d’y avoir assisté, et de vous faire partager en quelques notes cette bonne expérience
Come a Gatto in Tangenziale (comme un chat sur le périphérique)2018. De Ricardo Milani :
Film d’ouverture une bonne idée, que se passe-t-il lorsqu’un bourgeois voit sa jeune fille s’enticher d’un jeune pauvre qui habite dans un quartier pourri et réciproquement que se passe-t-il quand une ex-caissière s’aperçoit que son fils fréquente une petite bourgeoise ?
A la fin du spectacle, la salle immense a applaudi, et une dame a hurlé : c’est une navet ! un grand moment de solitude. Ce n’est pourtant pas ce qui lui donne tort. Ce film brasse des vieux clichés, il est peu drôle … C’est mal parti pour ce festival. note : (*)
les confessions un film de Roberto Ando 2016 :
Un moine Chartreux est invité à un sommet secret de dirigeants politiques du G8, par le patron du FMI (Daniel Auteuil) qui meurt brutalement. Voici un film qui a la forme d’un thriller. Le moine, c’est Toni Servillo un homme silencieux, entre Guillaume Baskerville (le moine du nom de la rose) et Saint François. C’est aussi un discours sur le pouvoir et l’argent, sur la corruption et la violence qui rappelle les meilleurs romans de Sciascia. Et là, nous sommes dans le festival, avec déjà le regret de ne pas avoir vu ce film au moment de sa sortie. Note (***)
Un’giorno all’improvviso (à L’improviste) de Ciro D’Emilio2018 :
avec deux acteurs exceptionnels, la très connue Anna Foglietta et un jeune premier rôle Giampero De Concilio. Un jeune homme de 17 ans à pour projet de devenir un footballeur, il travaille dans une station-service et vit avec sa mère qui est particulièrement instable et fragile ! Non seulement c’est bien joué, mais le scénario, la prise de vue, le rythme, la tension, tout est remarquable dans ce film, jusqu’à l’inquiétude sourde, l’expectation anxieuse qu’il procure. Le jury de Tours ne s’y est pas trompé qui a remis au réalisateur le prix du meilleur film et c’est un premier film ! Certaines scènes et répliques deviendront anthologiques. Un regret bien annexe ! Le prix : une statuette c’est le Monstre de Tours, une sorte de Goldorack abominable, probablement réalisé avec une photocopieuse 3D. Note(****)
Une storia senza nome (une histoire sans nom) de Roberto Ando 2018 :
la encore dans ce film on sent l’influence de Sciascia, avec l’humour en plus pour ce thriller complexe et enlevé. Valéria (Michaela Ramazzotti) est « nègre » d’un scénariste en mal d’inspiration. Un homme mystérieux (Rénato Carpentièri) la conseille dans l’élaboration d’un scénario particulier qui concerne le vol d’un tableau du Caravage. L’histoire va se corser car cette histoire est vraie ! Doublement vraie car elle s’inspire d’un fait réel. Note : (***)
L’Hospite (L’invité) de Ducio Chiarini 2018 :
Guido 38 ans, professeur de lettres mène une vie tranquille avec Chiara jusqu’au jour où elle a envie d’ailleurs, d’autre chose. Guido va au gré de l’hospitalité d’amis dont il découvre les errements. Curieusement, je pensais à l’homme fidèle pour la passivité masculine de Guido aidante. Note : (**)
Menocchio de Alberto Fusalo 2018 :
biopic d’un personnage pauvre au 16èmesiècle, accusé d’héresie, jugé par un tribunal inquisitorial, repenti ?
Un film d’une force inouïe. Un homme, simple meunier, mais qui sait lire et écrire face à la machinerie inquisitoriale qui lui tombe dessus. Filmé à bout portant, avec des clairs-obscurs, et le plus souvent des obscurs, des visages du Caravage, vous voyez, le crucifiement de Saint Pierre et les sons qui se détachent, comme arrachés aux choses et aux êtres… C’est à mon goût un chef-d’œuvre. Le jury jeuneà notre grande et heureuse surprise lui a descerné son prix. Jury jeune composé cette fois exclusivement de jeunes filles, venus d’écoles de l’image, de l’hôtellerie etc. Elles sont fortes les filles ! Note : (****)
Un Ragazzo d’Oro (un garçon en or) de Pupi Avati 2014 :
Histoire d’un jeune homme qui se pensant détesté de son père, réalisateur médiocre, découvre une réalité qui contredit ses certitudes. Parmi les actrices il y a Sharon Stone dont Pupi Avati présent parmi nous et dernier des Mohicans des grandes heures du cinéma italien nous dit les travers de star capricieuse. Il fallait voir ce film pour assister au numéro de Pupi Avati, ce grand nom du cinéma italien. (il a fait tourner de grands acteurs tel Ugo Tognasi). Rien que pour ça donc… et seulement pour ça. Note : (**)
Capri Révolution de Maria Martone 2018 :
L’Italie se prépare à la guerre. « L’Ile de Capri semble un peu à l’abri des tumultes du monde. C’est là que vit une communauté de jeunes venus d’Europe du Nord »ainsi commence le synopsis. Mal assis au cinéma Thélème, impossible de bouger ses genoux, douleur dans le dos, le film dure 2 heures, impossible de partir sans déranger 12 personnes… On dit qu’en vieillissant, on a l’impression d’accélération du temps. Cela n’est pas toujours vrai ! Note : (*)
I Villani (les rustres) de Danile Michel :
Un documentaire ! 5 ans de travail « Ils sont maraîchers, éleveurs, pêcheurs, ils ont choisi de travailler à la manière de leurs ancêtres. Ils ont une passion vitale de leur métier et un l’amour de leur terroir. Ils produisent la matière première d’une gastronomie menacée d’extinction ».Il faut voir ces femmes et hommes, regarder les paysages où ils vivent, entendre ce qu’ils nous disent. Salle comble 500 personnes environ. Standing- ovation, un tonnerre d’aplaudissement ! Nul n’aspire à vivre au 19èmesiècle, mais on sent à l’occasion du débat très riche et varié, que nous sommes entrés dans une critique intuitive d’un modèle économique qui détruit plus qu’il ne créé, aculture plus qu’il ne cultive. Qui va jusqu’à laisser s’éteindre la langue et les mots pour parler des choses. La réception de ce documentaire superbement filmé, à caractère anthropologique montre une attente sociale une attente de civilisation, pourrait-on dire et en même temps une aspiration, une adhésion du public pour ce cinéma. Note : (****)
Sono Tornato (je suis de retour) un film de Luca Miniero 2018 :
Une farce ! Musolini revient, il est là en Italie en 2018, il voit le monde. Premières images, il est persuadé que les abyssins ont gagné la guerre ! Revenu à la réalité, le Duce apprend vite, il voit les sous Duce qui lui ont succédé, et il veut savoir comment les Italiens vivent aujourd’hui, il entame un tour de la péninsule accompagné d’un journaliste, et il y a de bonnes possibilités pour lui. Désopilant et inquiétant à la fois ! Un film à voir pour sa drôlerie et pour la manière dont il montre la réalité et (par la même occasion) la téléréalité, d’aujourd’hui. Ajoutons que par moments ce Mussolini est filmé face à des figurants involontaires et les réactions de foule méritent d’être vues. Ça c’est l’Italie, être drôle et grave, et c’est l’une des mille raisons pour laquelle nous aimons son cinéma. Est-ce qu’un réalisateur français aurait eu l’idée de nous montrer Pétain avec dérision ? Jamais ! Note: (****)
Nous quittons le festival sur ces dernières images… Un très bon cru, même si parfois le très bon voisine avec le moins bon. Il nous reste qu’à espérer qu’il vous sera possible de voir les meilleurs à l’occasion de notre WE du cinéma italien.

 Festival
Festival  Du 20 au 25 décembre 2018
Du 20 au 25 décembre 2018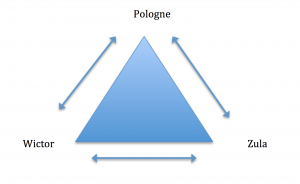
 Prix du scénario au Festival de Cannes 2018
Prix du scénario au Festival de Cannes 2018 Du 6 au 11 décembre 2018
Du 6 au 11 décembre 2018 Du 29 novembre au 4 décembre2018
Du 29 novembre au 4 décembre2018 Mademoiselle de Joncquières, (la catin habillée en dévote ): Le marquis aime cette dévote parce qu’elle lui résiste. Et, elle lui résistera parcequ’elle ne veut pas le tromper sur ce qu’elle est !
Mademoiselle de Joncquières, (la catin habillée en dévote ): Le marquis aime cette dévote parce qu’elle lui résiste. Et, elle lui résistera parcequ’elle ne veut pas le tromper sur ce qu’elle est ! Présenté par
Présenté par  Présenté par
Présenté par  Du 14 au 20 novembre 2018
Du 14 au 20 novembre 2018 Film français (octobre 2018, 1h31) de Philippe Faucon avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye
Film français (octobre 2018, 1h31) de Philippe Faucon avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye