 Prix du jury international au Festival de la Roche sur Yon 2017, Oscar 2018 du meilleur scénario adapté, et Meilleur scénario adapté aux BAFTA 2018Soirée débat mardi 1er mai à 20h30
Prix du jury international au Festival de la Roche sur Yon 2017, Oscar 2018 du meilleur scénario adapté, et Meilleur scénario adapté aux BAFTA 2018Soirée débat mardi 1er mai à 20h30Film italien (vo, février 2018, 2h11) de Luca Guadagnino
Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel et Victoire Du Bois
Distributeur : Sony Pictures
Présenté par Pauline Desiderio
Le film nous entraîne, sans qu’on le réalise vraiment, dans cet été 1983. Tout à coup, on est en Italie, il y a 35 ans, au cœur d’une maison chaleureuse, avec une famille rêvée dans un décor paradisiaque.
Quelque part en Italie, Élio s’incarne plus vrai que nature sous les traits de Timothée Chalamet. Il vide sa chambre avant d’aller à la fenêtre jeter un coup d’œil à Oliver : «L’usurpateur», brillamment interprété par Armie Hammer. Celui-ci viendra, le temps d’un été, lui voler son lit, son cœur, et laissera une marque indélébile dans sa vie. Il sera le premier, peut-être pas le dernier, mais le seul à avoir autant compté. Mais à ce moment du film, ni lui, ni Oliver, ni nous, ne le savent.
Pourtant, dès ses deux premiers mots d’Élio, la salle de cinéma, nos voisins, la fiction volent en éclat. Timothée Chalamet disparaît. Définitivement. Pour le rencontrer, le voir, il faudra regarder des interviews et se laisser surprendre à réaliser que lui et son personnage ne font pas qu’un, qu’ils sont bien différents, qu’il existe. Parce que pendant deux heures, la seule personne qui vit à nos yeux, qui crève l’écran, qui respire, joue du piano et de la guitare, nous enchante de ses mots en anglais, italien ou français. C’est ce jeune Élio, intelligent, vif et cultivé.
Il faut dire que depuis ses dix-sept ans, Timothée Chalamet a un peu grandi avec le projet de ce film.
L’histoire de ce film, c’est une histoire de coup de foudre, ou plutôt d’une multitude de coups de cœur. Celui d’abord d’André Aciman pour les personnages de son premier roman, le poussant à écrire plus vite qu’il ne l’avait jamais fait, pris dans l’urgence débordante d’un Élio alors âgé qui doit raconter l’été de ses dix-sept ans, et surtout cette aventure qui l’a, à jamais, changé.
C’est par la suite le coup de cœur de milliers de lecteurs , en 2007 aux États-Unis, dans le monde, et en France, sous le nom de Plus Tard ou Jamais, qui saluent le film pour son érotisme brut et son impact émotionnel. Il touche particulièrement deux de ses lecteurs : Peter Spears et Howard Rosenman, qui en achètent les droits, avant même la sortie du roman, ayant la chance d’avoir découvert le livre en avant-première. Le premier expliquera ce choix :
«Il fait vibrer la corde sensible de ceux qui le lisent parce qu’il évoque non seulement le premier amour, mais également l’empreinte indélébile qu’il laisse et la douleur qui lui est associée. Ce que tout le monde peut comprendre, indépendamment de son âge ou de son orientation sexuelle. »
Le projet va alors mettre huit ans à voir le jour, ils contactent des réalisateurs et des acteurs, sans réussir à stabiliser une équipe claire. Ils se tournent finalement en 2008 vers l’actuel réalisateur : Luca Guadagnino qui leur semble garant de retranscrire une authenticité italienne dans le film. Mais le réalisateur qui travaille alors à son long-métrage : Amore, décline l’offre, acceptant cependant de repérer les lieux de tournage. La réalisation est confiée en 2014 à James Ivory, mais très vite Luca Guadagnino le rejoint à l’écriture.
Le scénario fini, malgré une production internationale (Americano-Intaliano-Franco-Brésilienne), le budget du film doit être revu à la baisse afin d’être divisé par trois. C’est alors que James Ivory est invité à quitter le projet, il sera crédité seul au scénario, alors que Luca Guadagnino en assurera la réalisation. Des changements sont alors opérés.
La Lombardie remplacera la Ligurie côtière du livre. Le réalisateur tourne tout près de chez lui, dans la ville de Créma, ce qui lui permet de rentrer chaque soir à la maison. Le lieu accueillera 5 semaines avant le début du film Timothée Chalamet pour y consolider son jeu du piano et de la guitare (les scènes musicales ne sont pas doublées, et c’est un véritable régal de le voir s’exercer à l’écran) et y apprendre l’italien.
Les scènes de nus explicites sont retirées du scénario, ce qui est pour James Ivory un véritable scandale. Il dénonce une censure puritaine.
La voix off, reprenant l’idée du livre d’un Élio vieux qui raconte à posteriori cette histoire est supprimée. L’émotion est donnée sans le filtre de la description, ce qui fera dire à l’auteur du livre, Aciman « Waouh, ils ont dépassé le livre ».
Le réalisateur ne veut aucun filtre entre la caméra et l’émotion des personnages, et c’est là, la grande réussite du film. Il impose alors à son directeur de la photographie de n’utiliser qu’un objectif à focale fixe, en pellicule de 35 mm. Il explique :
« J’aime les limites. (…) Je ne voulais pas que la technologie interfère avec la trame émotionnelle du film. »
Le résultat est saisissant, certaines scènes sont floues, d’autres ont un cadrage parfois tranchant tant la caméra semble proche de son sujet. Le charnel prend le dessus sur l’image, ajouté à la prise de son et à la performance d’acteurs, le spectateur peut sentir les corps vibrer, les peaux s’appeler, les souffles se retenir. Il rentre dans la peau des personnages tant la photographie rend forte l’empathie. Lorsque Oliver prend par exemple le train, disant « Adieu » à Élio, on voit la mâchoire du jeune homme se déformer tant l’air semble déjà lui manquer, et la douleur nous prend au même endroit.
La performance des acteurs rend alors absolument bouleversant le film, Élio a su s’effacer totalement dans son personnage, en épouser l’intelligence, la bonté, la souffrance. Il a beaucoup influencé le scénario. On doit notamment à l’acteur Franco-Américain la pénétration du français dans le film et l’origine hexagonale d’une partie du Casting ( Amira Casar et Esther Garrel).
L’aspect polyglotte déjà présent dans le livre, se renforce alors d’une langue additionnelle à l’anglais et l’italien. Le grec ancien et l’allemand s’ajoutent à cet univers multiculturel ouvert sur le monde et sur le temps, dans une espèce d’hédonisme voire d’épicurisme éternel, où la jouissance de la nature, du savoir, de la culture et de l’autre semblent la seule chose qui compte. Les références artistiques, littéraires, musicales, philosophiques abreuvent le film sans jamais être gratuite, pompeuse ou élitiste.
À l’image du personnage d’Oliver, venu des États-Unis pour passer l’été dans la maison d’un chercheur Italien, il profite du cadre sublime pour, à la fois, finir la rédaction d’un texte sur Héraclite, jouir de la fraîcheur de l’eau et de la nature, enchaîner les parties de Poker, devenant ainsi magiquement ami avec les vieux du village, et se laissant aller au plaisir charnel féminin ou masculin, quitte à tomber amoureux et se laisser prendre au piège des sentiments sachant qu’il doit partir car sa vie est ailleurs. Armie Hammer s’incarne parfaitement dans cet éternel étudiant, acceptant de redevenir un adolescent pour les quelques semaines de cet été, avant de se marier et devenir définitivement adulte. Cet été-là, il répondra au nom d’Élio, et Élio répondra à son nom.
Quand
Quant à la fin du film, il appellera le jeune homme pour lui annoncer, après des mois sans lui avoir donné de nouvelles, qu’il se marie, son amant répétera ce mantra « Élio, Élio, Élio, Élio », jusqu’à ce qu’Oliver l’appelle à son tour « Oliver » reprenant alors le jeu de leur amour estival, trace de la marque indélébile de leur histoire.
Mais, Call me by your name, c’est aussi un très bel hommage au père, Aciman, l’auteur du roman raconte qu’il a eu des parents géniaux, et qu’il est sûr qu’à pareille situation, son père aurait dit mot pour mot, ce que M. Perlman dit à son fils pour le consoler. Incarner par le fabuleux Michael Stuhlbarg, le personnage fait alors un éloge sublime de la douleur. La douleur n’est alors plus à percevoir comme négative parce qu’elle est la trace de l’expérience incroyable qui a été traversée. Il faut la cajoler, car sinon, on arrache avec elle tout ce qu’il y a pu avoir de bon, comme aime le résumer Timothée Chalamet.
Durant tout le film, accompagné de tous les autres personnages allant dans le même sens que lui, Michael Stuhlbarg incarne la bonté à l’état pur, cette bonté qui n’évitera pas la souffrance, mais qui saura la consoler quand elle arrivera, une bonté qui consiste à profiter pleinement des choses qui arrivent, car la force de ce que chacun ressent doit être chérie et non jugée. Une véritable leçon de vie. Il est le père, comme le dit Luca Guadagnino que tous rêveraient d’avoir.
Mais c’est aussi un hommage que Luca Guadagnino dit livrer à ses pères de Cinéma : Renoir, Rivette, Rohmer et Bertolucci. Il glisse aussi dans la bouche d’Esther Garell les mots de son père : « Amis pour la vie. »
C’est pour finir, le coup de cœur de milliers de spectateurs qui se sont surpris à tomber amoureux, comme quand ils avaient dix-sept ans, revivant toutes les émotions de leur première histoire d’amour ; comme s’ils avaient dix-sept ans sentant leurs poils se dresser comme ceux d’Élio, leur cœur se serrer de le voir souffrir de l’attente, le souffle manquer, et finalement les larmes monter comme celle de ce fabuleux acteur, laissant l’émotion à nouveau le déborder sur la sublime musique de Sufjan Stevens : Visions of Gideon.
Je fais partie de ces spectateurs qui n’ont pas tenté d’intellectualiser « cet univers trop beau », l’âge ou le genre des personnages mais qui se sont laissés envahir par son flux d’émotions brutes, d’une sensibilité et d’une justesse extrême, et par la beauté de ses personnages : ces deux jeunes amoureux prêts à tout pour vivre ces quelques semaines comme une magnifique parenthèse, les parents d’Élio qui choisissent de fermer les yeux et apporter des mots et des gestes réconfortants le moment venu pour ne rien abîmer, et Marzia, qui à l’image de Nathalie dans Les Enfants du Paradis– ce qui fait du personnage interprété par Maria Casares le plus beau protagoniste de Marcel Carné – a confiance, terriblement confiance, parce qu’elle, elle restera pour partager la petite vie de tous les jours, la vie simple et belle qu’Oliver va lui aussi retrouver, avec sa future femme. (Comme semble le dessiner la suite, au prochain épisode).
J’espère que vous vous êtes laissé chavirer par cette sublime histoire d’amour, car comme le disait Prévert : « Les seuls films contre la guerre sont les films d’amour ». Se montrer sensible à une telle histoire serait alors, peut-être, un petit acte de résistance face aux discriminations et à certaines barbaries contemporaines.

 Prix spécial du jury international et de la meilleure réalisatrice au Festival de Locarno
Prix spécial du jury international et de la meilleure réalisatrice au Festival de Locarno Prix spécial du jury international et de la meilleure réalisatrice au Festival de LocarnoDu 7 au 12 juin 2018Soirée débat mardi 12 juin à 20h30
Prix spécial du jury international et de la meilleure réalisatrice au Festival de LocarnoDu 7 au 12 juin 2018Soirée débat mardi 12 juin à 20h30 Nominé à la Mostra de Venise et au Festival du film policier de Beaune
Nominé à la Mostra de Venise et au Festival du film policier de Beaune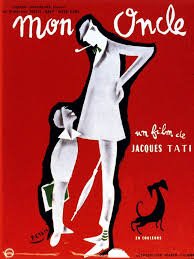
 Présenté par Marie-Noël VilainDu 17 au 22 mai 2018Soirée débat mardi 22 mai à 20hFilm français (mars 2018, 2h55) de Abdellatif Kechiche avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Chardard et Hafsia Herzi
Présenté par Marie-Noël VilainDu 17 au 22 mai 2018Soirée débat mardi 22 mai à 20hFilm français (mars 2018, 2h55) de Abdellatif Kechiche avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Chardard et Hafsia Herzi Du 17 au 22 mai 2018
Du 17 au 22 mai 2018 Prix du jury international au Festival de la Roche sur Yon 2017, Oscar 2018 du meilleur scénario adapté, et Meilleur scénario adapté aux BAFTA 2018
Prix du jury international au Festival de la Roche sur Yon 2017, Oscar 2018 du meilleur scénario adapté, et Meilleur scénario adapté aux BAFTA 2018 Avec la participation d’Amnesty International
Avec la participation d’Amnesty International