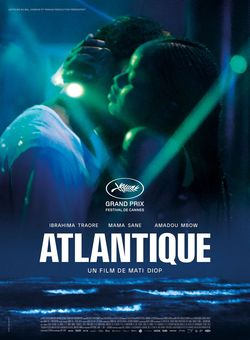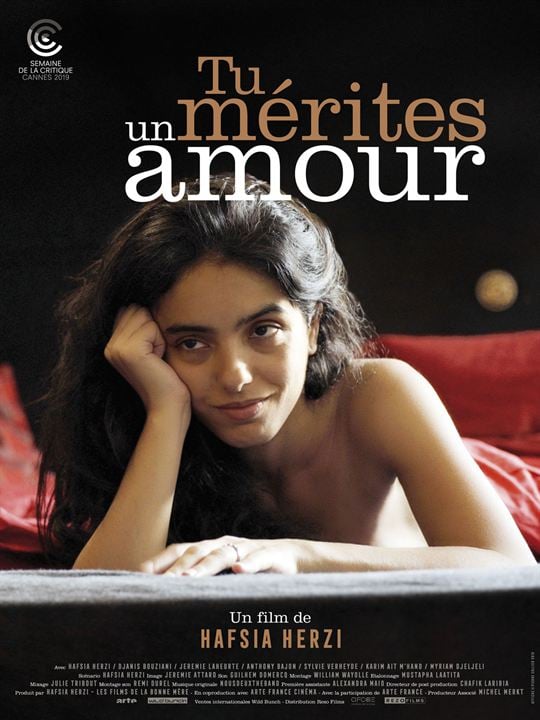Titre original : Il Traditore
Film italien (octobre 2019, 2h31) de Marco Bellocchio avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido et Fabrizio Ferracane
Présenté par Georges Joniaux
Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l’histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.
D’abord, il y a le style magnifique de Marco Bellochio, la beauté de son cinéma, son souffle. Chez lui, il n’y a pas d’images pour l’image, elles sont au service du sens. Ses scénarios sont rigoureux, pour ce film les coscénaristes sont au nombre de 3, dont deux sont des experts de la Mafia. (L’un romancier et l’autre historien).
J’ai eu l’avantage de voir ce film deux fois, mais pour les esprits lents dont je suis, trois auraient été mieux, car il me vient quelques conclusions que je vais vous soumettre tout à l’heure et que tout de même, j’aurai mieux fait d’avoir au moment de la présentation !
Comme j’ai eu l’occasion de le dire, ce film comporte des reconstitutions quasi documentaires, tels le maxiprocès de Palerme ou les crimes mafieux, d’autres scènes sont plus romanesques, elles servent à préciser des rapports aux personnes ou au monde, par exemple l’échange de cigarettes entre Falcone et Buscetta n’a pas existé, mais cet artifice permet de signifier la naissance d’une estime réciproque (réciproque mais nous le verrons, pas de même nature). Où encore la citation de Butor, qui est fictive mais qui permet de souligner l’importance du non verbal et du regard dans la Mafia.
Je me propose de rapprocher certains éléments du film avec des données biographiques que je connais concernant Tommaso Buscetta(magistralement interprété par Pierfrancesco Favino,) afin de cerner la nature du rapport de ces deux personnages Buscetta /Falcone.
On est d’abord saisi par « l’extradition » du Brésil de Tommaso Buscetta qui se fait en toute sérénité, sans contention, en classe affaires et donc il débarque de l’avion avec une couverture sur les avant-bras pour cacher… L’absence de menottes.
Revenons en arrière dans la vie de Buscetta, avant la partie filmée : Il est le 17ème et dernier enfant d’une famille de braves gens, le père est miroitier, évolue dans les quartiers pauvres de Palerme. Il commence par des petits larcins et adolescent, comme beaucoup de jeune, en 1943, il participe à l’aide du débarquement allié. Plus tard, il rencontre la famille Bontate plutôt spécialisée dans le trafic de cigarettes. Ensuite, comme tout bon Sicilien, il part découvrir le vaste monde. En 1949 il est au Brésil, il y retourne en 1956. Le reste du temps, la rue et la prison seront ses écoles. Il est intelligent, il a aussi une faculté remarquable à se fondre dans différents milieux, il parle l’italien, le dialecte sicilien, l’espagnol, le portugais, l’anglais, et je peux faire des oublis.
En 1957, un certain Giuseppe Bonano dit Joe Bananas, arrive des USA à Rome, il est lié à la mafia sicilienne de New York de Luchi Luciano, il y est accueilli par le ministre du commerce italien. Ensuite, il se rend à Palerme, il y rencontre les mafieux, entre autre Buscetta qu’il connaît bien. Ce Joe Bananas cherche des débouchés nouveaux pour son transport international, Cuba vient de tomber aux mains de Fidèle Castro. A Bananas, la mafia de Palerme lui doit pour une large part, l’intensification du trafic d’héroïne, et l’organisation dans sa forme pyramidale de la Cosa-Nostra, avec ses conseils, ses cantons, ses régulations. À partir de 1962, nouveaux débouchés, nouvelles convoitises, une guerre se déclenche entre deux familles mafieuses, les Greco et les La Barbera, elle fait moult morts (environ 2000). Dans ce contexte, en 1966 Buscetta file à New-York pour y « ouvrir une Pizzeria ». En 1968, il est condamné en Italie par contumace pour un double meurtre. Il est arrêté à New-York, mais l’administration italienne, (sans doute distraite, ne réclame pas son extradition !). Il part au Brésil d’où il finit tout de même par être extradé et emprisonné en Italie. En 1980 bénéficiant d’une permission pour bonne conduite, il fugue, repart au Brésil, échappant du même coup à une nouvelle guerre entre les clans palermitains et le clan Corléonesi dirigé par Toto Riina. (Extrait de CV : premier assassinat à 19 ans, suivent 40 autres et 110 commandités).
En 1982 Toto Riina fait assassiner le Général Delachiesa qui avait décidé d’en finir avec la mafia, (sans doute était-ce réciproque).
En 1983, Buscetta est de nouveau « extradé » et là commence le corps du film. Lorsqu’on lit son parcours, les heureuses conjonctions de sa vie de mafieux, on a le sentiment qu’il est né sous une bonne étoile… Voilà un homme qu’on oublie d’arrêter et qui quand on l’arrête pour ses crimes, peut bénéficier de permission, se sauver…et voyager. Mais entre-temps, durant cette guerre mafieuse, Toto Riina a fait assassiner le fils Bontate, Stefano, son ami ; deux enfants de Buscetta ; son frère ; son beau-frère ; son neveu.
Le juge Falcone attend Buscetta, ces deux hommes ne sont pas de même milieu, mais ils ont en commun d’être tous deux de Palerme. Ils vont se jauger, et se juger puis s’estimer. Très vite Buscetta instaure des règles d’échange, « ne me parlez pas de mon passé », « je n’ai jamais fait de trafic de drogue », « je suis un simple soldat ». Et surtout « Je ne suis pas un repenti, je suis un homme d’honneur »… Et la Cosa-Nostra a trahi, elle tue les femmes, les enfants et les juges ».
Falcone ne peut lui donner tort sur ce dernier point, en 1979, les juges Cesare Terranova puis plus tard, Rocco Chinicci ont été assassinés. Et le film fait apparaître en filigrane les qualités du juge Falcone. Moyennant ces concessions, avec patience et complicité, il va pouvoir mettre en accusation 474 mafieux, obtenir 360 condamnations et occasionner 2265 années de prison.
Mais à la fin on meurt et puis basta ! dit le juge Falcone, conscient que sa mission était plus grande que sa vie. Et il sera assassiné par 600 kg de TNT placés sur son chemin, sous l’autoroute, le 19 juillet 1992. Il le sera sur ordre de Toto Riina qui a échappé au Maxi procès de Palerme. Dans sa folie furieuse, à peine deux mois plus tard, ce mafieux fera assassiner le juge intègre Paolo Borsellino et d’autres personnes de renom mais moins cleans, prêtre, hommes de lois et politiciens, tous en lien avec la Mafia. Arrêté en 1993, ce petit homme de 1m58, qui a épousé son institutrice, fidèle, aimant la vie familiale, sans charisme, humble, croyant, et bien élevé, mais qui étrangle et torture sans état d’âme, aime l’argent sans limite, et par n’importe quel moyen, va enfin pouvoir aller en prison jusqu’à sa mort. Buscetta témoignera contre lui.
En dépit de la mort du juge Falcone et en son honneur, Buscetta témoignera contre l’ex Président du conseil Giulio Andreotti soupçonné de complicité avec la Mafia. Lors de sa déposition, comme il tient ses informations contre l’accusé par ouïe-dire, comme il n’a plus le statut de mafieux d’honneur que Falcone lui prêtait, il sera disqualifié. Andreotti est trop grand pour lui dans cette hiérarchie sordide.
Dans ce film, il y a une histoire dans l’histoire. Celle de l’homme à l’enfant. Celle d’un homme condamné à mort par la mafia, et que Buscetta devait exécuter. Le devinant, il se couvre en tenant son enfant contre son cœur. Dès lors toute sa vie jusqu’au mariage de son fils, il l’utilisera comme bouclier. Mais au départ du fils, Buschetta surgit de l’ombre…deux coups de feu.
Cette scène de meurtre de cet homme à l’enfant qui est présentée à la fin du film est essentielle. D’abord, c’est un meurtre. Mais c’est aussi un meutre honorable. On ne tue pas un père devant son enfant ! C’est une fable, une légende ! Aucun chef mafieux, qui ordonnerait une exécution ne tolérerait que l’exécution attende 15ans. Donc en racontant cette histoire, Buscetta invente. Si Bellochio filme cette scène qui repose sur l’allégation de Buscetta ce n’est pas pour faire beau dans le film. C’est comme si Buscetta nous disait : « je suis un meurtrier, mais tout de même, j’ai une conscience et de l’honneur » et c’est ce besoin de légitimité et de reconnaissance que le juge Falcone remarquera avant même de le rencontrer.
Ce que suggère Bellochio, c’est que de même qu’on peut douter que Buscetta soit un tueur raisonnable, on peut douter qu’il soit allé au Brésil ou à NYC juste pour le tourisme, mais que peut-être le trafic d’héroïne y est pour quelque chose… Il y a chez Buscetta un besoin constant de justification morale.
Le juge Falcone a compris cela avant de le voir. Son témoin, a besoin de sa recouvrer sa dignité perdue, besoin de manifestations d’estime, besoin de reconnaissance. Alors la procédure d’extradition en Classe Affaires participe déjà de tout cela.
Le juge va apprendre à connaître en lui un homme intelligent, solide, ferme et cohérent, qui a toutes les qualités pour devenir sa pièce maitresse. Il a deux objectifs premiers, inspirer confiance (les regards, la cigarette, le respect du silence, la sobriété) et réparer cet homme, il accepte donc les termes qui feront de Buscetta non pas un repenti ordinaire, un simple traitre, mais un homme d’honneur. Il l’aide à reconsidérer son jugement sur la traîtrise. Le traître, c’est Giuseppe Calo et consorts et non lui car lui, il est fidèle à la vraie tradition mafieuse.
Mais il fait mieux que ça, il aide Buscetta à se débarrasser de ses ennemis mieux qu’il n’aurait pu le faire avec un revolver. En ce sens ce film sur la vie de Buscetta serait aussi et surtout un film sur la sagacité du Doctor Giovani Falcone, et son courage aussi.
Au vu de ses éléments, très parcelaires, j’en conviens, on peut s’interroger sur « les coups de chance de Buscetta», qui au total l’ont toujours préservé du pire, et jusqu’à la fin de sa vie.