Le Cinéma permet de penser à autre chose et les chaines Ciné sont bien commodes pour revoir des films et aussi quand les salles sont fermées.
J’ai donc revu à la télé « La Haine » de Mathieu Kassovitz, 22 ans après sa sortie.
Le monde a changé. Moi aussi. Plus Vinz, Hubert, Saïd et les autres qu’à l’époque. Leur appel au secours m’a déchiré les tympans.
A l’époque, cette cité de banlieue, qui paraît, d’ailleurs, aujourd’hui, bien proprette, bien calme, était un autre monde que le spectateur lamda regardait à travers le prisme de la « normalité ». Ce monde là existait, faisait peur, mais on n’y pensait pas souvent. C’était autre part. Pourtant, fatalement, progressivement, inexorablement, naturellement, il fallait bien qu’il déborde !
Quand on regarde le film aujourd’hui, on voit que tous les éléments étaient déjà là.
L’affiche publicitaire géante montrant un paysage idyllique « Le monde est à vous » qui nargue Vinz, Benoit, Saïd chaque jour. Jusqu’au jour où ils décident qu’il allait l’être, à eux, ce monde, qu’ils allaient le forcer à l’être. Et ils corrigent le slogan en « Le monde est à NOUS »
La police et son petit chef qui « forme » une nouvelle recrue aux méthodes du passage à tabac. Pour rien. Pour le fun.
Les échanges entre mecs sur « les soeurs », et avec elles, pas voilées mais pas en jupe, sur leur place et leurs devoirs.
Les armes si faciles à se procurer et qui les hissent au rang de caïd.
La dissonance entre la ville et la banlieue par exemple dans la galerie d’art avec l’expo pseudo Jeff Koons, champagne, petits fours et jeunes demoiselles, deux mondes qui n’ont pas les mêmes codes, ne parlent pas la même langue. Sauf celle de la pub « tu te prends pour la meuf de Wonderbra ? »
Une parenthèse en ce qui concerne la langue. Le film est quasi totalement en verlan et, surtout, la prise de son est, je trouve, très approximative. J’ai vieilli mais je pense qu’à l’époque, je ne devais déjà capter qu’un mot sur deux … La solution on l’a, à la maison. Il suffit de mettre en version malentendant pour avoir les sous-titres ! épatant ! on saisit tout !
Vinz, Saïd, Benoît et les autres sont nés et vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien …
Ils savent qu’ils finiront par tomber et que la chute fera très mal.
Ces trois jeunes adultes issus de la cité sont pourtant, à la base, très différents. Vinz, écorché vif, devenu incontrôlable, Benoît, responsable, raisonnable, Saïd, vif comme l’éclair, dégourdi. Mais leurs parcours, pas le choix, se rejoignent. Forcément. Personne ne les regarde comme des individus. Mis dans le même sac, ils s’endurcissent, s’arment, se protègent et en ressortent avec la haine.
Trop de monde est resté dans « l’escalator », se contentant d’être portés par le système. Etait-il encore temps, il y a vingt ans, de prendre l’escalier ?
Heureusement, l’Art aussi a débordé ! Des artistes ont émergés et émergent de partout dans le domaine de la musique, du spectacle, de la peinture, de la littérature, des arts graphiques, du cinéma …
Les Arts se propagent, apaisent et finiront bien par confédérer.
Le film de Mathieu Kassovitz (28 ans) , en noir et blanc, reste, vingt ans après, fulgurant par son rythme, sa mise en scène, ses acteurs qui, à l’époque, étaient jeunes et peu connus : Vincent Cassel (29 ans), Saïd Tadmaoui (22 ans), Hubert Kaoudé (25 ans), Benoît Magimel (19 ans), Karine Viard (29 ans), Valeria Bruni-Tedeschi (29 ans), Vincent Lindon (36 ans), Zinedine Soualem (38 ans).
Deux, seulement, étaient originaires de « la banlieue ».
Marie-Noël
 C’est l’histoire d’un vieux réalisateur, Rey (!) (Mathieu Amalric), séducteur invétéré, qui, accompagné de son actrice Isabelle (Jeanne Balibar), présente son dernier film, un soir , dans une des salles d’un multiplex. Il s’échappe pour monter « cueillir » une jeune sylphide, Laura (Julia Roy) qu’il a repéré, créatrice de spectacles modernes dans une autre salle de ce même lieu. Elle le suit, tout en le précédant, dans les longs couloirs et on se laisserait bien entraîner dans un marivaudage. Las !
C’est l’histoire d’un vieux réalisateur, Rey (!) (Mathieu Amalric), séducteur invétéré, qui, accompagné de son actrice Isabelle (Jeanne Balibar), présente son dernier film, un soir , dans une des salles d’un multiplex. Il s’échappe pour monter « cueillir » une jeune sylphide, Laura (Julia Roy) qu’il a repéré, créatrice de spectacles modernes dans une autre salle de ce même lieu. Elle le suit, tout en le précédant, dans les longs couloirs et on se laisserait bien entraîner dans un marivaudage. Las !
 3 prix au Festival de Valenciennes2017
3 prix au Festival de Valenciennes2017 Une question que je poserais à Chad Chenouga si le débat avait lieu le lendemain matin (ce qui, pour moi, serait idéal) : est-ce toujours la même photo dans le cadre ? Au fur et à mesure que Nassim avance dans son deuil, on voit le sourire de sa mère se transformer, se défaire et finir par disparaître. Privée de ses excuses pour mieux être pardonnée.
Une question que je poserais à Chad Chenouga si le débat avait lieu le lendemain matin (ce qui, pour moi, serait idéal) : est-ce toujours la même photo dans le cadre ? Au fur et à mesure que Nassim avance dans son deuil, on voit le sourire de sa mère se transformer, se défaire et finir par disparaître. Privée de ses excuses pour mieux être pardonnée.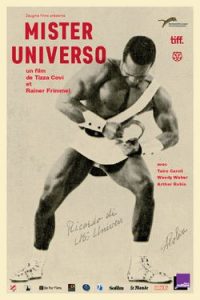 Primé en 2016 aux festivals de Marrakech et de LocarnoDu 22 au 27 juin 2017Soirée-débat mardi 27 à 20h30
Primé en 2016 aux festivals de Marrakech et de LocarnoDu 22 au 27 juin 2017Soirée-débat mardi 27 à 20h30
 Ours d’argent à la Berlinale 2017Du 1er au 6 juin 2017Soirée-débat mardi 6 à 20h30
Ours d’argent à la Berlinale 2017Du 1er au 6 juin 2017Soirée-débat mardi 6 à 20h30
 Soirée-débat dimanche 28 à 20h30Présenté par Henri Fabre
Soirée-débat dimanche 28 à 20h30Présenté par Henri Fabre