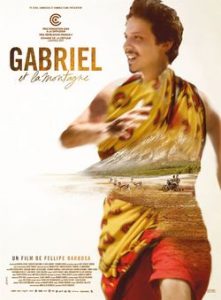7 nominations au Festival de Cannes 2017
7 nominations au Festival de Cannes 2017Film franco-algérien (vo, novembre 2017, 1h53) de Karim Moussaoui avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou et Mehdi Ramdani
Distributeur : Ad Vitam
Présenté par Georges Joniaux
Synopsis : Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans les vies d’un riche promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune femme tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois histoires qui nous plongent dans l’âme humaine de la société arabe contemporaine.
Hier, avec « En attendant les Hirondelles », nous avons vu du très bon cinéma. Un film promesse, qui nous invite à voir le prochain film de Karim Massaoui, un film qui donne également envie de voir d’autres films algériens.
Les cinéphiles comme les lecteurs, les amateurs d’art, de vin, ou que sais-je, sont avisés lorsqu’ils regardent ce qui se fait dans le monde. Nous avons cette chance aux Cramés de la Bobine d’avoir cette fenêtre ouverte. Et l’Algérie d’hier soir nous semblait comme un village, à la fois proche et lointain, nous avions l’impression de connaître ces gens. Lors du débat, il me semble que nous avons remarqué l’intervention de Laurence sur la forme du film, qui expose sa manière d’avancer par touches légères, celle d’Henri sur cette faiblesse, défaillance des hommes dans l’histoire, argument repris par Françoise qui l’interprète comme l’instabilité, l’absence de fiabilité des institutions qui laisserait ces hommes seuls face à eux-mêmes.
C’est sur ce thème que je souhaite mettre mon grain de sel. Regardons ces hommes.
Regardons d’abord Mourad (Mohammed Djouhri), ce beau personnage naviguant entre son ex-femme, son fiston encore un peu immature, et sa jeune et belle ex-future femme. Vous avez vu le casting, Karim Massaoui a choisi un homme d’aspect solide et vieillissant. Un entrepreneur qui évoluait naguère dans une corruption ordinaire qui brutalement change de braquet et le dépasse. Tout va bien pour lui jusqu’à l’incident : Il fait nuit, on est dans un quartier neuf d’Alger, on entend un bruit sourd, comme un râle, en fait il y a derrière un mur, sur une place déserte, deux hommes qui en rossent un troisième. Mourad se cache, son téléphone sonne, il se cache davantage, il a peur. Sans doute ce bruit fait fuir les agresseurs. (Cette scène au moment où la voiture des agresseurs démarre, fait penser à une scène de guerre).Alors Mourad s’approche à distance respectueuse, au sol, un homme git et râle. Comme dans la chute de Camus, il reprend son chemin. Ne pas voir va ensuite lui causer des soucis concrets, d’abord avec sa vieille femme puis sa jeune maîtresse et comme on le verra la séquence 3, sa cataracte commence à lui poser question. Ne pas voir quand il le faut, lui trouble la vue… et le cerveau… qu’il pense cancéreux. La remarque de Françoise prend toute sa pertinence, à qui se fier ? Mais pas seulement. Revenons à cette fameuse séquence, il y a un plan où il boit un verre à côté d’un homme médecin neurologue Dahman, (Assan Kachach). Qu’est-ce qui unit ces deux hommes, pas grand-chose, une coïncidence . On sait à ce moment du film que Dahman a été concerné de près par le terrorisme. Ces deux hommes ont l’âge d’avoir pris de front la période des années 90. La question de Mourad, c’est que sa lâcheté du moment est composée d’une matière complexe, de mauvaises anticipations comme le signale Françoise, et tout autant d’un passé où il a bien dû se cacher, avoir peur, refusé de voir. La « lâcheté de Mourad »semble construite plus qu’instinctive, la prudence et la peur reprennent la place d’autrefois, vous voyez, un peu comme quand on a fait une boule avec du papier cellophane de chez la fleuriste, qu’on la presse dans la main et qu’on la relâche.
Alors un mot sur Dahman, (Assan Kachach) le neurologue. Là encore, quel casting. Dommage, quand je vais le revoir, je ne me rappellerai plus son nom et je vais me dire, tiens ! C’est le neurologue ! Cet homme de belle allure est amené à se rendre dans un bidonville, dans les conditions que vous connaissez. Il y retrouve une petite dame réprouvée, au regard pénétrant, à l’allure résolue, en d’autres circonstances, elle aurait pu être à sa place. Elle lui propose de se souvenir d’elle. Ce qu’il refuse d’abord, par déni sans doute. Mais il devra admettre que dans le passé, lui, le médecin, otage d’un moment, l’a vue au moment ou les terroristes l’ont emmenée dans une cabane pour la violer. Et qu’il n’a rien fait. Dahman n’est pas coupable, que pouvait-il ? Pas coupable mais concerné. Du moins, il aurait dû l’être. Mais tout dans sa vie autorisait la résilience. Ce passage montre que cet homme n’est aucunement résilient. Il a construit sa réussite sur une sorte de scotomisation*(1) du passé(quelque chose qui est là mais qu’on ne voit pas) , et sa réussite sociale est comme une gomme à effacer. Mais à son tour cette réussite s’efface devant un passé à partager. Et l’occasion lui est donnée d’avoir à réparer quelque chose. Est-ce à lui de le faire, pas plus qu’il lui revenait de voir un viol. Mais on sent qu’il va le faire parce que ce passé est aussi une possibilité de partage. De faire un présent (aux deux sens du terme) acceptable après un passé qui ne l’était pas.
Du coup, il nous reste Djalil (Mehdi Ramdani). Le jeune homme qui ne rit pas -Intense le garçon, vous avez vu? – Lui porte une liberté, il est comme cette musique du film, il est à la fois la musique de Rina Raï et parfois comme Mourad, celle plus sombre plus résignée d’une messe de Bach interprétée par Alfred Deller. Peut-être est-il aussi une promesse, celle du groupe musical « Kusturicien » qui clôt la 2ème partie. L’espoir et la résignation. À lui on peut dédier cet extrait d’une interview de Karim Massaoui : « En Algérie, les ancêtres sont encore sacralisés, ils sont très présents, avec leur base morale, leurs codes de conduite, ils sont là, ils nous surveillent et ils exercent une sorte de chantage occulte qui se rappelle sans cesse à nous : si on trahit leur mémoire, on sera bannis ».
Et terminer ce commentaire sur ce film rhizome par cet extrait musical.
Raina Rai, Ya Zina Diri Latay – راينا راي , يازينة – YouTube
*(1)Scotome : Le terme scotome désigne une lacune immobile dans le champ visuel (étendue perçue par le regard quand celui-ci reste immobile) due à l’absence de perception dans une zone de la rétine.
PS (et « repentir ») : Jamais musique de film n’est innocente. La prochaine fois je ferais très attention, ici elle vaudrait à elle seule un article , et surtout aurait du être davantage soulignée lors de la présentation du film, le choix de la musique Raï doit nous rappeler que les extrémistes religieux ont aussi assassiné cet élan de création culturel universel, une musique de toute beauté… et physiquement, certains de ses représentants. Le choix de cette musique dans le film n’est donc pas innocent. Il faudrait-alors ré-écouter toute la bande musicale.
 Soirée-débat lundi 15 à 20h30
Soirée-débat lundi 15 à 20h30 Du 4 au 9 janvier 2018
Du 4 au 9 janvier 2018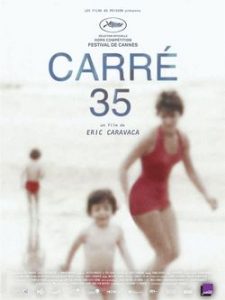 Film français (novembre 2017, 1h07) de Eric Caravaca
Film français (novembre 2017, 1h07) de Eric Caravaca Primé au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2017
Primé au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2017 Des frères Coen, comme beaucoup d’entre nous, j’ai vu certains de leurs films plusieurs fois, sur grand écran et à la télé. Mais un festival, un grand écran dans une belle salle, c’est autre chose vraiment. Ajoutons, voir ces fims à la suite, présentés, commentés, éclairés par Thomas Sotinel, critique de cinéma au journal Le Monde, pour le public des cramés de la Bobine à Montargis et pour l’amour du cinéma, c’est inespéré.
Des frères Coen, comme beaucoup d’entre nous, j’ai vu certains de leurs films plusieurs fois, sur grand écran et à la télé. Mais un festival, un grand écran dans une belle salle, c’est autre chose vraiment. Ajoutons, voir ces fims à la suite, présentés, commentés, éclairés par Thomas Sotinel, critique de cinéma au journal Le Monde, pour le public des cramés de la Bobine à Montargis et pour l’amour du cinéma, c’est inespéré.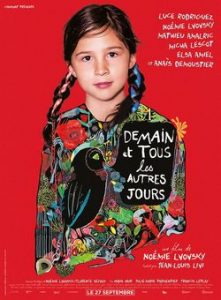 Du 2 au 7 novembre 2017
Du 2 au 7 novembre 2017 J’aime ce cinéma-là, certainement celui d’un réalisateur qui compte. Commençons par écouter sa musique, elle dit des choses. Dans l’ensemble ce n’est pas la mienne, elle ne me correspond pas. Pourtant dans ce film, elle apparaît évidente. Notons aussi un morceau filmé joué par un musicien, c’est L’Oru par Pétru Bracci, dans sa cellule de prison, il chante et s’accompagne de sa guitare, magnifique.
J’aime ce cinéma-là, certainement celui d’un réalisateur qui compte. Commençons par écouter sa musique, elle dit des choses. Dans l’ensemble ce n’est pas la mienne, elle ne me correspond pas. Pourtant dans ce film, elle apparaît évidente. Notons aussi un morceau filmé joué par un musicien, c’est L’Oru par Pétru Bracci, dans sa cellule de prison, il chante et s’accompagne de sa guitare, magnifique.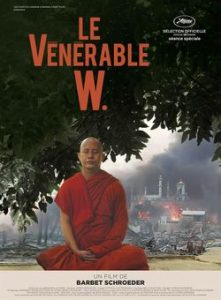 Ce film a été présenté en Séance Spéciale au Festival de Cannes 2017 Semaine du 12 au 17 octobre 2017
Ce film a été présenté en Séance Spéciale au Festival de Cannes 2017 Semaine du 12 au 17 octobre 2017